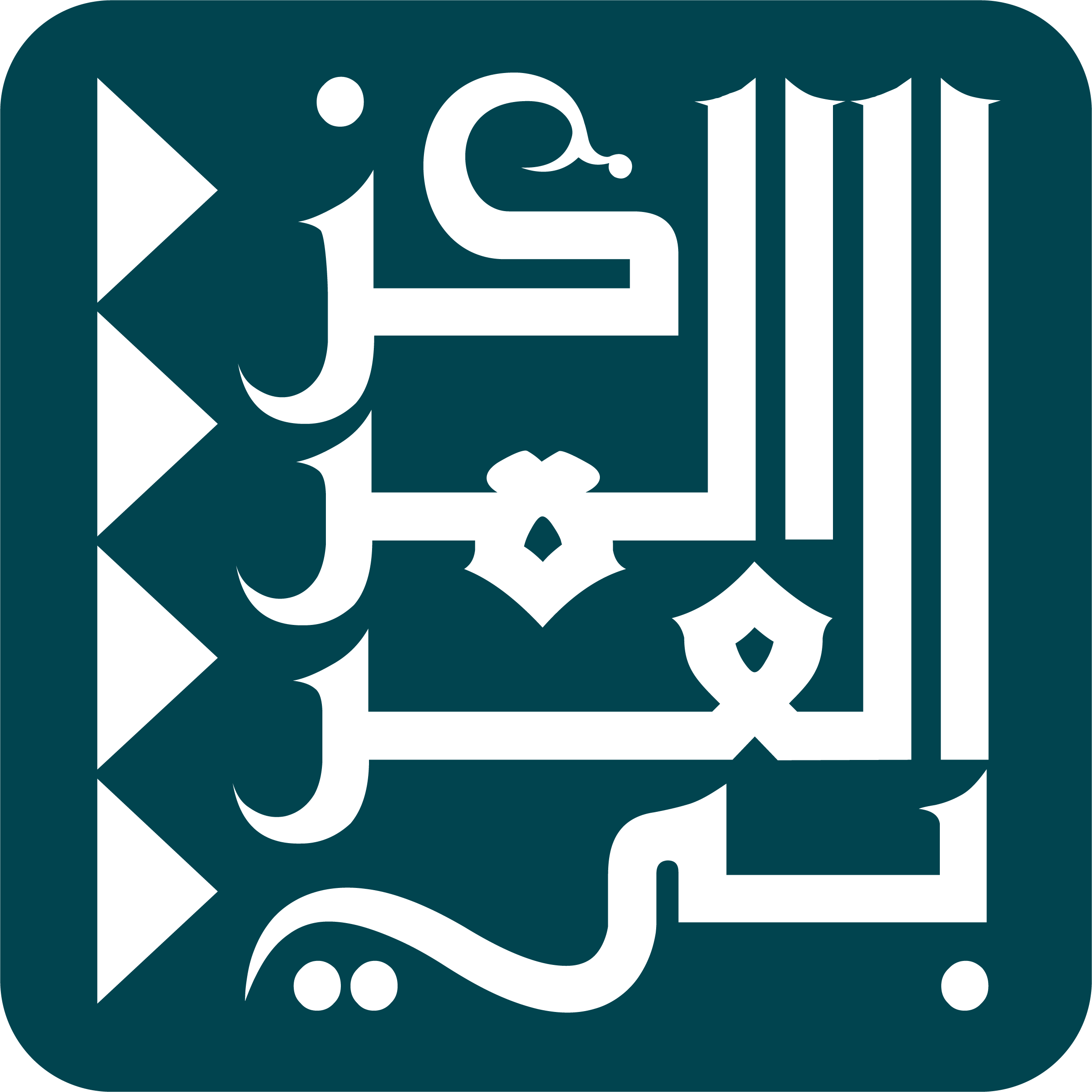Entretien avec Asef Bayat à propos de son ouvrage : Revolutionary life: The everyday of the Arab Spring
Propos recueillis par Isabel Ruck[1] et Yasmine Ben Ammar[2]
Peu de chercheurs se sont intéressés au quotidien des révolutionnaires dans l’analyse des printemps arabes. Et pourtant, ce sont les jeunes, les pauvres des villes et des villages, les femmes et les minorités sociales qui sont à la base des mouvements révolutionnaires qu’a connu le monde arabe depuis 2011. Comment la mobilisation, certes à des degrés divers, a façonné le printemps arabe ? Quel est leur récit du quotidien révolutionnaire ? Et qu’est-ce que cela apporte à la compréhension des printemps arabes en général ?
Nous avons posé ces questions à Asef Bayat, professeur de sociologie et titulaire de la chaire Catherine et Bruce Bastian d’études mondiales et transnationales au département de sociologie de l’université de l’Illinois.
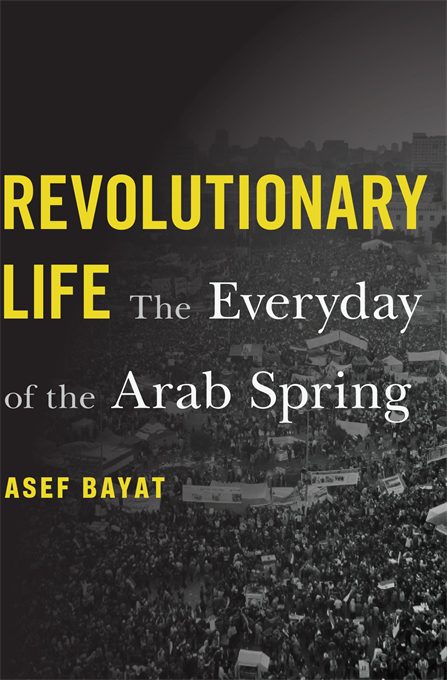
Asef Bayat, Revolutionary Life:The Everyday of the Arab Spring, Harvard University Press, 2021, 336 p.
I.R. & Y.B.A. : Après la publication de votre ouvrage Revolution without revolutionaries en 2017, dans lequel vous observez déjà les changements limités dans les structures du pouvoir provoqués par les révolutions arabes, vous signez ce nouvel ouvrage qui s’intéresse davantage à la vie révolutionnaire. Pourquoi avez-vous voulu raconter le quotidien des gens mobilisés ? Qu’est-ce que cela nous apprend sur le mouvement révolutionnaire en tant que tel ?
Asef Bayat : La plupart des récits de la révolution portent sur les dirigeants, les agents du régime, les élites et les institutions de l’État. Ces éléments sont en effet très importants et méritent l’attention. Mais en réalité, l’épine dorsale de toute révolution, ce sont les gens ordinaires : les pauvres des villes et des campagnes, les jeunes marginalisés, les femmes et les minorités sociales. Je voulais souligner le rôle que ces gens ordinaires ont joué dans la réalisation de la révolution. Par conséquent, l’histoire de la révolution n’est pas seulement ce qui s’est passé au sommet ; c’est aussi le récit de ce qui s’est passé sur le terrain, à la base, dans la vie quotidienne.
Cette perspective « d’en bas » offre une occasion inestimable d’examiner et, espérons-le, de théoriser la relation particulière que chaque groupe social entretient avec la révolution. Il existe un grand nombre de travaux sur les classes sociales (comme le prolétariat, la classe moyenne ou la paysannerie) et leur rôle dans la transformation révolutionnaire. Mais je voulais explorer la place des groupes sociaux subalternes comme les femmes, les pauvres ou les jeunes dans la révolution. Je voulais examiner les contours de leur implication, leur mobilisation et leur démobilisation, leur autonomisation et leur effacement, leur voix et leur sortie pendant un épisode révolutionnaire. Enfin, je voulais également démontrer que cette perspective sociale et quotidienne révèle la complexité de la signification même de la révolution ; elle complique les discussions sur le « succès » et l’« échec », ou encore la « fin» et la « continuité» de la révolution.
I.R. & Y.B.A. : Bien que vous rappeliez à votre lecteur que le printemps arabe a déclenché une série de révolutions dans plusieurs pays, votre analyse se focalise essentiellement sur la Tunisie et l’Égypte. Pourquoi avoir choisi d’examiner le printemps arabe à travers les exemples tunisien et égyptien ? Qu’est-ce que la comparaison entre ces deux pays apporte à l’examen des effets des révolutions sur les sociétés arabes ?
Asef Bayat : Permettez-moi de dire que j’aurais souhaité avoir la possibilité pratique d’étudier plusieurs expériences révolutionnaires (notamment la Syrie, la Libye, le Yémen, le Bahreïn et d’autres) avec la même profondeur, la même ampleur et le même travail de terrain que pour mon étude des cas tunisiens et égyptiens. Mais cela n’était tout simplement pas possible, étant donné les contraintes que nous avons habituellement en termes de travail, de responsabilité et de temps.
Contrairement à la Tunisie et à l’Égypte, où j’ai pu effectuer un travail de terrain approfondi au cours d’une demi-douzaine de voyages, je pouvais seulement suivre à distance les révolutions en Syrie, au Yémen, en Libye et au Bahreïn. Par conséquent, je me suis concentré spécifiquement sur les cas tunisien et égyptien dans mon étude. Mais au-delà des considérations logistiques et d’accès au terrain, il y avait aussi d’autres raisons qui ont motivé mon choix.
La Tunisie a été le fer de lance des révolutions arabes qui se sont répandues dans la région comme une traînée de poudre. Il était donc crucial pour moi de comprendre et d’examiner attentivement cette première expérience révolutionnaire dans la région. Et bien sûr, je m’attendais déjà à ce que cet « incident révolutionnaire » dans un pays comme la Tunisie, affecte – et dans des directions souvent différentes – d’autres pays de la région, comme cela a été ensuite le cas avec l’Égypte.
Je connaissais bien l’Égypte, j’y avait vécu et travaillé pendant près de dix-sept ans avant la révolution. L’Égypte était, pour ainsi dire, ma maison. J’avais étudié les changements sociaux, politiques et religieux de ce pays depuis les années 1980. Il était donc important pour moi de comprendre sa révolution du 25 janvier.
Par ailleurs, la Tunisie et l’Égypte sont aussi les deux premières révolutions arabes qui ont conduit à la chute de leurs dictateurs. Enfin, la comparaison entre l’expérience tunisienne et égyptienne était également intéressante dans la mesure où l’une était considérée comme un « échec » (l’Égypte après le coup d’État) et l’autre comme un « succès » (la Tunisie et sa démocratie électorale). Il était important pour moi de montrer dans quelle mesure cette différence évidente entre les deux cas, découlait aussi de trajectoires révolutionnaires propres à chaque pays.
I.R. & Y.B.A. : Selon vous, le printemps arabe serait un cas paradigmatique de « refolution », une révolution qui engendre une réforme plutôt qu’un changement radical. Pouvez-vous revenir sur les distinctions que vous faites entre « révolution », « mouvement révolutionnaire » et « refolution » ? Pourquoi estimez-vous que ce dernier concept soit plus adapté au contexte tunisien et égyptien ?
Asef Bayat : Oui, dans mon précédent livre, Revolution without Revolutionaries, j’ai essayé de montrer que, dans un sens historique plus large, le printemps arabe représentait une nouvelle génération de révolutions du XXIe siècle, riches en « mouvement » ou en mobilisation révolutionnaire, mais assez pauvres en termes de « changement » ou de transformation significative de la structure du pouvoir politique. Autrement dit, il s’agissait de « refolution », c’est-à-dire de mouvements révolutionnaires qui ont émergé pour contraindre les régimes en place à se réformer, plutôt que de les remplacer ou d’intervenir pour les transformer. Le résultat a été que les régimes en place, comme en Égypte ou même en Tunisie, ont largement résisté à une transformation significative, expliquant ainsi l’absence de réforme de la culture autoritaire, des médias, de l’idéologie économique et des institutions clés des anciens États (comme les services de renseignement, l’armée, les réseaux de patronage, etc.). Pour le dire rapidement, il n’y a pas eu de grande rupture avec l’ancien ordre social, économique et politique. Même si les dictateurs individuels comme Ben Ali, Hosni Mubarak ou Ali Saleh sont partis, leurs régimes sont largement restés. Cette situation est différente de celle d’une révolution, où la mobilisation révolutionnaire entraîne la transformation de l’État, de l’idéologie et du mode de gouvernance en place, ce qui ouvre ensuite la voie à un éventuel changement de société.
I.R. & Y.B.A. : Dans cet ouvrage, vous vous intéressez principalement aux effets de ces refolutions sur les populations subalternes parmi lesquelles vous comptez les pauvres, les jeunes marginalisés, les femmes et les minorités sociales. Ces groupes ont tous souffert, à différents degrés, de la répression politique, de la marginalisation économique et de la surveillance religieuse et morale. Comment ont-ils réussi à s’organiser dans ces conditions ? Quelles sont les stratégies qu’ils ont mis en place et avec quels moyens ?
Asef Bayat : Des segments de tous ces groupes subalternes ont participé aux soulèvements. En effet, leur participation collective a contribué de manière significative à l’éviction des dictateurs du pouvoir. Lorsque les autocrates ont été renversés et que le contrôle de la police et de l’État a diminué pendant un certain temps, ces groupes subalternes ont acquis un pouvoir considérable. Ils ont commencé à s’organiser, à faire campagne et à formuler des demandes radicales. Par exemple, les paysans pauvres des zones rurales ont demandé des terres, de l’eau d’irrigation, un allègement de la dette et la syndicalisation. Les travailleurs des villes se sont battus pour de meilleures conditions, la sécurité de l’emploi et des syndicats indépendants ; les chômeurs ont lancé des campagnes extraordinaires pour obtenir des emplois ; les femmes ont lutté pour des lois visant à renforcer l’égalité des sexes et contre le harcèlement sexuel. En outre, nombre de ces groupes, en particulier les pauvres des villes, ont entrepris des actions directes ; ils ont tenté d’acquérir ce qu’ils considéraient comme leurs droits. Cela s’est traduit par la saisie de terrains pour construire des maisons, le squat d’appartements à moitié construits ou la revendication de logements publics. Il y a donc eu une remarquable mobilisation sociale à la base de la société par les groupes subalternes pour améliorer leurs conditions de vie. Mais la situation a changé lorsque les nouveaux gouvernements post-révolutionnaires se sont consolidés. Ces gouvernements ont recommencé à exercer leur contrôle depuis le sommet et ont essayé de reprendre certains des acquis que la base avait obtenus par les luttes. Pourtant, beaucoup de choses avaient déjà changé, ce qui explique que certains acquis n’ont pu être retirés.
I.R. & Y.B.A. : D’après le Arab Barometer[3], 16 % de la population tunisienne et 8 % de la population égyptienne sont descendus dans la rue pour manifester. Vous comparez ce résultat à la faible mobilisation de la population française (uniquement 2 %) lors de la Révolution de 1789. Peut-on réellement comparer ces événements compte tenu de leurs contextes socio-historiques différents ?
Asef Bayat : Bien sûr, les protagonistes du printemps arabe et de la révolution française, mais aussi les contextes socio-historiques dans lesquels ces deux événements se sont produits sont différents – après tout, nous parlons de « refolution » pour le premier et de « révolution » pour le second. Cependant, il est très instructif de comparer les taux de mobilisation et de participation des gens à ces deux événements historiques. Cette comparaison nous donne une perspective utile pour considérer les soulèvements arabes. L’objectif principal est de montrer qu’en général, une petite minorité participe réellement aux soulèvements révolutionnaires ; ce sont ces petits segments de la population qui provoquent les révolutions pouvant entraîner des changements spectaculaires dans la société. En citant le taux de participation à la Révolution française (le taux était encore plus faible dans la révolution américaine), je voulais montrer à quel point la participation populaire en Tunisie et même en Égypte était stupéfiante. La vérité est que le nombre de participants tout comme la fréquence des soulèvements populaires ont considérablement augmenté ces dernières années au niveau mondial.
I.R. & Y.B.A. : Selon vous, en temps normal les groupes subalternes auraient tendance à lutter séparément pour leurs intérêts sectoriels. Toutefois, vous observez une convergence de ces luttes, phénomène que vous qualifiez dans votre ouvrage d’émergence d’une « révolution comme mouvement ». Pouvez-vous revenir sur les facteurs qui ont rendu cette convergence possible ?
Asef Bayat : L’émergence de ce que j’appelle la « révolution comme mouvement » ou du « soulèvement » si vous préférez, auquel participe un groupe relativement important de personnes résulte d’un processus délicat. Le fait est que les individus qui participent à une révolution ne constituent pas une entité homogène ; ils sont composés de divers groupes sociaux ayant des intérêts et des positions différents et parfois contradictoires. Même les « groupes subalternes » – par exemple, les pauvres urbains, les jeunes marginalisés, les femmes ou les minorités sociales – sont différenciés en fonction de leurs intérêts et de leurs relations particulières avec la structure du pouvoir (même si, parfois, il peut y avoir un chevauchement, une situation que l’on a appelée l’ « intersectionnalité » – par exemple, être simultanément pauvre, jeune et femme). En temps normal, ces groupes luttent souvent séparément pour leurs intérêts sectoriels. La magie de la révolution réside dans le fait que ces groupes divers se réunissent tous dans un moment de nature « transcendantale » pour constituer un ensemble uni, « le peuple ». Ce « peuple » fait l’expérience d’un moment fugace d’unité et d’égalité exceptionnelles pour lutter pour un objectif plus grand – quelque chose de plus grand que ses intérêts sectoriels, comme la justice, la dignité, la liberté. Mais comment en viennent-ils à imaginer un intérêt partagé pour un tel bien supérieur ? Comment se fait l’unité réelle et la constitution du « peuple » ? Ici, l’esprit du moment et le sentiment de « résonance » sont essentiels. Ainsi, quelque chose se passe « là-bas », et certaines personnes « ici » sentent que cela résonne avec leur situation. Certains groupes peuvent réagir aux brutalités policières ou protester contre la pénurie d’eau dans une partie du pays, mais ces actes peuvent trouver un écho auprès d‘autres personnes dans d’autres parties du pays. Mais le mode et le réseau de communication jouent un rôle crucial dans la construction de ce sentiment partagé, de cette douleur collective, et d’un objectif commun.
I.R. & Y.B.A. : Lorsque vous évoquez la question des mouvements des femmes, vous notez que l’impact des ONG de développement travaillant sur des questions de women empowerment a causé la dissociation entre les questions de genre et les luttes populaires. Comment expliquez-vous cette situation et en quoi elle fusionne avec ce que l’on appelle le féminisme d’État ?
Asef Bayat : Les activités des femmes à travers les ONG ne sont pas nouvelles au Moyen-Orient. Les associations dirigées par des femmes ont une longue histoire – certaines étaient impliquées dans les luttes anticoloniales, d’autres dans l’éducation et d’autres encore dans les œuvres de charité. Beaucoup étaient explicitement de nature politique. Mais dans la période de l’après-guerre froide et sous les régimes autocratiques post-coloniaux, de nombreuses ONG de femmes ont travaillé dans le cadre du paradigme « genre et développement » et la plupart du temps en association avec le « féminisme d’État ». Souvent soutenues par des fonds de développement étrangers, elles ont concentré leurs activités sur des « questions de développement », telles que la génération de revenus, l’éducation, la formation, etc. Mais elles sont restées largement à l’écart des politiques d’opposition. Si ces associations ont aidé les femmes dans certains domaines, elles sont restées largement sanctionnées par l’élite ou les institutions gouvernementales et sont généralement restées complices de la répression par les régimes de la dissidence ou des mouvements féminins d’opposition. Comme l’ont noté certains observateurs, nombre de ces ONG ont fait office de « machine antipolitique[4] ».
I.R. & Y.B.A. : Comment analysez-vous la disparition de la question socio-économique au profit de la question identitaire et du maintien des politiques néolibérales dans les gouvernements post-révolutionnaires ? Pourquoi ces derniers n’ont pas pris acte des échecs du système néoclassique et néolibérale prérévolutionnaire ?
Asef Bayat : C’est certainement dû à une vision socio-économique du monde qui prédominait dans la classe politique au moment où les soulèvements ont eu lieu. Mais cette vision ne se limitait pas aux pays arabes. Elle était le produit d’un changement idéologique dans le monde après l’effondrement du camp socialiste et la fin de la guerre froide, lorsque les idées dominantes de socialisme, d’État-providence, de justice sociale et de révolution ont cédé la place aux idées de droits et de responsabilités individuels, de société civile contre l’État, d’identités horizontales, de réforme libérale et de marché. Certes, les classes politiques et les gouvernements post-révolutionnaires du monde arabe ont parlé du chômage des jeunes, de la pauvreté et de la nécessité du développement. Mais ces discours n’ont pas dépassé le stade de la simple rhétorique, sans projeter de vision stratégique ni de politiques systématiques pour y remédier. Pour la classe politique, il semble qu’il n’y ait pas d’alternative aux politiques de marché néolibérales déjà en place, sans compter que ces problèmes de pauvreté, de chômage et de disparité ont été exacerbés par ces modèles socio-économiques.
I.R. & Y.B.A. : Selon vous, les « refolutions » arabes ont été marquées par l’écart entre la radicalité des revendications des groupes subalternes et la vision non radicale, réformiste, voire légaliste, de la nouvelle classe politique post-révolutionnaire, qui a rejeté ces revendications jugées extrémistes, utopiques et illégales. Qu’est-ce qui, d’après vous, engendre cet écart entre les aspirations de la population et la réponse politique apportée ?
Asef Bayat : Eh bien, je pense que le néolibéralisme (à la fois comme politique économique et comme forme de gouvernance) suit le double effet de la radicalisation du subalterne, d’une part, et de la déradicalisation de la classe politique, d’autre part. Les politiques néolibérales ont été en grande partie responsables de l’aggravation des disparités, ainsi que de la précarité, de l’incertitude et de l’exclusion croissantes de larges segments de la population, qui se sont alors sentis moralement indignés et ont aspiré au changement. Il faut imaginer que tout cela se produisait sous des régimes autocratiques répressifs qui favorisaient ce type de machine économique. Dans le même temps, la pensée néolibérale postule qu’il n’y a pas d’alternative à ce qui existe, rien de mieux que ce type de capitalisme sauvage ; et que tout ce qui a été tenté comme alternative a peut-être échoué. Par conséquent, la classe politique montre peu d’intérêt pour la poursuite d’une vision viable d’un ordre alternatif. Le résultat est l’écart entre les aspirations des subalternes et les politiques réelles de la classe politique.
I.R. & Y.B.A. : Après dix années de désillusion provoquées, entre autres, par des dérives autoritaires des contre-révolutions, peut-on réellement considérer que les révolutions sont terminées ? Cette question se pose aujourd’hui avec d’autant plus d’acuité que la guerre en Ukraine accentue les crises économiques et alimentaires dans de nombreux pays arabes laissant planer le spectre d’une « révolution des affamés ». Devant ce constat, n’est-il pas prématuré de conclure à l’échec des révolutions ?
Asef Bayat : C’est un point intéressant. Comme vous vous en souvenez peut-être, quelques années après la première vague de soulèvements arabes au début des années 2010, beaucoup pensaient que les révolutions étaient terminées. Mais peu de temps après, nous avons assisté à une résurgence des soulèvements révolutionnaires en Algérie, au Liban, en Irak, en Iran et au Soudan, jusqu’à ce que l’apparition de la pandémie de Covid-19 mette fin aux protestations. Il est difficile de déclarer la fin des soulèvements une fois pour toutes. Il existe encore des raisons d’exprimer ouvertement la dissidence populaire, simplement parce que les causes sous-jacentes des révoltes n’ont pas été traitées de manière adéquate. Au contraire, la pandémie et les effets possibles de la guerre en Ukraine pourraient ajouter de nouvelles dimensions à la dissidence populaire. Jusqu’à présent, nous nous sommes concentrés sur le niveau politique – le niveau de révolte collective et de demande de changement politique. Le fait est que les effets révolutionnaires ne sont peut-être pas encore terminés dans le domaine social, dans les domaines des subjectivités, des normes, des valeurs, des relations de genre et des relations hiérarchiques en général. De ce point de vue, le regard que l’on porte sur ces révolutions peut changer. En fait, ce sont les questions que j’ai essayé de mettre en évidence, de documenter et de discuter dans mon dernier livre, Revolutionary Life.
Notes :
[1] Responsable de la recherche et de la planification scientifique du CAREP Paris.
[2] Stagiaire Assistante de recherche au CAREP Paris de janvier 2022 à juin 2022.
[3] Pour aller plus loin, voir : https://www.arabbarometer.org
[4] James FERGUSON, The Anti-Politics Machine, Development, Depoliticization, and Bureaucratic Power in Lesotho. Cambridge, Cambridge University Press, 1990.