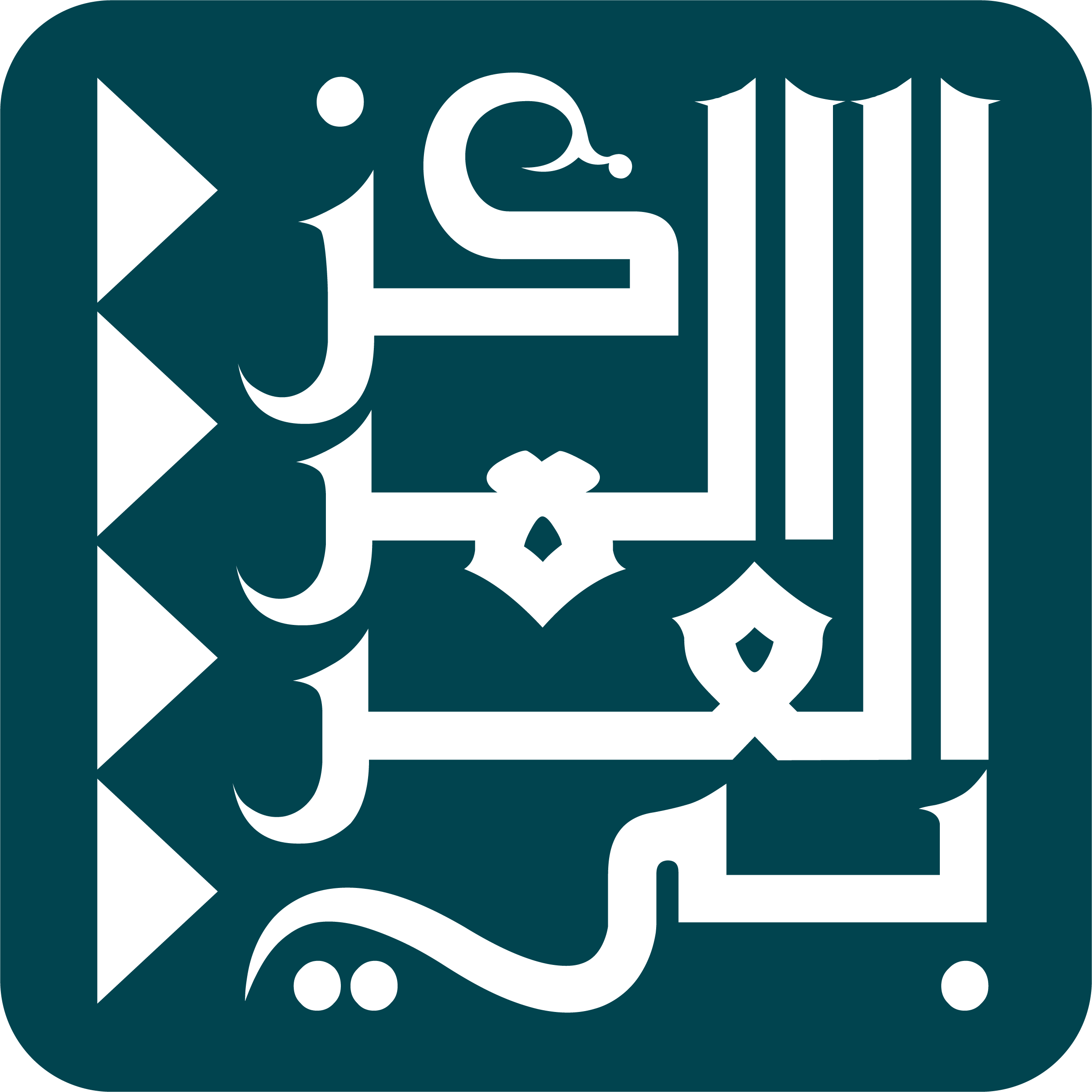Par Sonia Dayan-Herzbrun
Philosophes, sociologues et politistes[1] s’interrogent sur les formes nouvelles que prennent aujourd’hui les rassemblements politiques, horizontaux, sans leaders, où les corps se mettent en scène et s’expriment. Même si leurs analyses incluent, au départ, les révolutions arabes, leur questionnement part du « Nord », et finalement s’y limite. On peut, au contraire, prendre les révolutions arabes comme point d’ancrage à partir duquel envisager d’autres approches de ces rassemblements contemporains, dans une perspective qui deviendrait celle de la mondialité. Il convient, dans cette perspective, de déconstruire le regard hégémonique porté sur la façon qu’on a dans le « Sud » de s’assembler pour dire « Non ».
Déconstruire le regard « occidental » sur les printemps arabes
Une des questions centrales posées par la philosophie politique contemporaine est celle de l’agir en commun. Comment l’élaboration d’un monde commun est-elle possible alors même que celui-ci « est traversé de divisions politiques manifestement insurmontables[2] » ? Dans la pensée dominante, l’agir en commun, en dépit d’un désordre ou d’un mécompte originaire, suppose un moment d’unité. Il reste celui d’un démos qui est « à la fois le nom de la communauté et le nom de sa division[3] ». Quant au un, même s’il est instable, brouillé, il est ce qui s’instaure dans le moment de l’agir politique[4].
L’adoption du paradigme décolonial conduit, en revanche, à une autre lecture du politique qui pose d’emblée la multiplicité, la « pluriversalité » au cœur de l’action politique.
Je propose ici, pour développer cette approche autour de la question du commun, quelques réflexions en forme d’exode hors de l’espace européen ou euro-américain entendu, certes, comme espace géographique, organisation territoriale, mais aussi comme espace historique, politique, épistémologique. À la vision d’un monde unifié par la globalisation, je propose de substituer celle de mondes multiples dont les horizons symboliques et historiques ont été invisibilisés ou subalternisés par ce que l’on désigne au choix comme l’Occident ou le Nord. Au mieux on les a figés dans des « cultures » hétérogènes les unes aux autres et implicitement ou explicitement hiérarchisées ne méritant de considération que si, et quand, elles réussissaient à mimer les pratiques et les discours du Nord colonisateur. Du Sud global, dans lequel on les englobait, on a décrété que le politique, et avec lui le principe démocratique, était absent, comme par essence.

Sonia Dayan-Herzbrun
Professeure émérite
Sonia Dayan-Herzbrun est professeure émérite de sociologie politique, membre du Laboratoire de changement social et politique (LCSP), du Réseau thématique CNRS « Islam et chercheurs dans la cité », et directrice de la revue Tumultes. Elle est également collaboratrice régulière de la revue En attendant Nadeau. Une partie de ses recherches porte sur les mouvements politiques au Moyen-Orient où elle privilégie la dimension genrée.
L’ensemble des mouvements qui sont apparus à l’aube de 2011, et qu’on a désignés sous le nom de révolutions arabes ou de printemps arabes, sont venus porter un démenti – au moins provisoire – à ces assertions. Ils suggèrent que se projeter dans un monde commun, se penser en sujet du commun, ne peut se concevoir qu’au pluriel et dans le multiple, un multiple qui n’est pas constitué de parties juxtaposées mais d’ensembles mouvants, en relation[5], en translation. Il convient alors de se situer hors de toute construction pyramidale.
La vision que la majorité des médias a transmise, et continue à transmettre, des mouvements politiques et sociaux qui se sont déroulés et se produisent toujours dans le monde dit « arabe et musulman », ne diffère guère de ce qu’expriment les « experts ». Seules les voix de quelques politisés, le plus souvent originaires des pays concernés, viennent mettre de la dissonance dans cette expression d’hégémonie. L’hégémonie étant ici une conception dominante, souvent intériorisée et incorporée par celles et ceux qui subissent la domination[6].
D’une manière assez générale, la singularité des soulèvements populaires de 2011 a été niée. Ils ont été comparés à peu près systématiquement à des événements européens qui ont servi de modèles et de normes. On a ignoré leur dynamique propre, leur inscription dans une histoire, une mémoire, et un rapport à la temporalité qui ne sont pas identiques à ceux qu’ont connus l’Europe ni même l’Amérique du Nord. En France, c’est la Révolution de 1789 qui a servi de premier point de comparaison et d’étalon. Puis la qualification même de « printemps » pour des événements qui se sont déclenchés en plein hiver, porte la marque de cette assimilation ou de cette réduction à des événements européens : le « printemps des peuples » de 1848, ou encore le printemps de Prague (1968). Dans cette histoire, la révolution « n’a pas d’autre option que de choisir ses formes dans une galerie de “modèles » proposés par les États-nations européens ou américains[7] ».
Dimension décoloniale
Au-delà de cette métaphore météorologique, doublée dans le cas de la Tunisie de stéréotypes touristiques (on parlait à son propos de « révolution du jasmin »), on perçoit combien ces stéréotypes ont permis d’occulter ce qui constitue l’une des caractéristiques principales des révolutions arabes, que l’on retrouve en 2019 dans les mouvements qui se déroulent en Algérie ou au Soudan, à savoir leur dimension anticoloniale et même décoloniale[8]. Rien à voir, donc, avec les événements européens de 1968 qui se situent dans la continuité du conflit entre les deux blocs qui entendent diviser le monde. Même si les puissances occidentales avaient renoncé à intervenir quand l’armée soviétique envahit la Tchécoslovaquie où un président élu, Alexander Dubcek, avait tenté d’instaurer le « socialisme à visage humain », le printemps de Prague s’inscrivait dans le cadre de la Guerre froide où l’ennemi était clairement l’Union soviétique contre laquelle des guerres par procuration se menaient sur d’autres terrains.
Lors des révolutions arabes, au contraire, les despotes contre lesquels on s’est soulevé dans les rues ou sur les places de Syrie, d’Égypte, de Tunisie, du Yémen, de Bahreïn ou même de Libye, étaient soutenus par les puissances occidentales dans une collusion bien connue entre les États dits postcoloniaux et les anciennes puissances coloniales. On se souvient qu’en janvier 2011, alors que les manifestations ne cessaient pas, Michèle Alliot-Marie, ministre française des Affaires étrangères, avait proposé publiquement au président tunisien Ben Ali que « le savoir-faire de nos forces de sécurité, qui est reconnu dans le monde entier, permette de régler des situations sécuritaires de ce type[9] ». Cette expression de solidarité ne trouvait pas sa seule origine dans les faveurs personnelles dont la ministre bénéficiait de la part de l’entourage du président. Elle était dans le droit fil de la politique qu’avaient jusque-là menée les divers gouvernements de la France.
Le printemps, c’est aussi le surgissement, l’éclosion. Le choix de ce terme dit ainsi l’étonnement toujours renouvelé devant ce qui semblait ne jamais devoir ou pouvoir se produire. Huit ans plus tard, quand des manifestations populaires aboutissent en Algérie au départ du président Bouteflika, c’est le même embarras et la même hésitation à trouver les mots, identifier des acteurs et proposer des analyses. Outre les complicités déjà mentionnées avec les dirigeants et les groupes qui exerçaient ou tiraient profit de l’autoritarisme, ce qui se manifeste ici c’est bien la négation de l’historicité des colonisés actuels ou anciens, propre à l’orientalisme et plus généralement à la non-pensée coloniale. On se souvient du discours de Dakar du Président Nicolas Sarkozy en 2007[10] : « L’homme africain n’est pas assez entré dans l’Histoire. » L’histoire est avant tout celle des puissances coloniales, et les colonisés semblent n’avoir d’histoire qu’à l’occasion de leur rencontre ou leur confrontation avec les colonisateurs. L’oblitération de l’historicité se conjugue, en effet, avec un déni de subjectivité. Or, avec les révolutions arabes s’est affirmée, sur la scène mondiale, une véritable subjectivité politique qui n’est plus calquée sur celle qu’avait imposée la colonie.
Alors que les printemps arabes s’inscrivent dans une longue histoire de résistance à la colonisation et à l’autoritarisme[11], ils semblent, dans les discours dominants, être sans passé et sans avenir. Le caractère politique des mouvements antérieurs n’apparaît pas, et ils sont considérés sous un angle le plus souvent économique et misérabiliste, ou bien ramenés à des dimensions culturelles ou religieuses. C’est le cas, par exemple, pour les « émeutes du pain » qui ont éclaté en Tunisie pendant l’hiver 1983-1984, ou de la révolte du pain d’avril 2008 en Égypte. Quant à l’insurrection syrienne de la fin de l’année 1981, dans laquelle les Frères musulmans de Syrie ont joué un rôle moteur, et qui s’est achevée, dans l’indifférence internationale, par le massacre à Hama (février 1982) de dizaines de milliers de civils, par les forces de Hafez al-Assad, elle a été largement interprétée comme un conflit entre sunnites et alaouites.
Or le programme politique des frères musulmans de Syrie mettait au premier plan la question de la démocratie et des libertés : « La Révolution islamique en Syrie proclame aussi haut qu’elle le peut la nécessité pour la Nation, d’un rétablissement des libertés, aussi nécessaire que l’air, l’eau et le pain[12]. » Si le passé est nié ou ignoré, la possibilité pour ces mouvements d’un avenir et d’un devenir est très souvent contestée. Non seulement parce que cette perspective rencontre la norme conservatrice qui décrète que non seulement toute révolution mais aussi toute mobilisation sont vouées à l’échec, mais du fait du poids des stéréotypes selon lesquels pour des raisons culturelles et religieuses les pays du monde arabe et musulman ne peuvent accéder à la démocratie. La contre-révolution et la répression d’une violence extrême qui a pu s’abattre sur les mouvements nés en 2011, en Égypte, en Syrie, au Yémen ou encore au Bahreïn, sont alors interprétées comme des échecs prévisibles et non comme des pratiques qu’il aurait fallu condamner sinon empêcher.
Occultation de l’Histoire
Le regard occidental est alors un non-regard, l’écoute, une surdité. Il n’est pas difficile de lister la série d’occultations, de refus de voir, d’entendre, de s’interroger. D’une manière apparemment paradoxale, le monde arabe et musulman est envisagé comme un ensemble indéterminé[13] alors même qu’on ne conceptualise pas les connexions mouvantes qui courent d’un de ses points à l’autre. Or les révolutions dites « arabes » sont, en effet, « ouvertes[14] », sans clôture, aussi bien du point de vue spatial que du point de vue temporel. Ce sont comme des feux qu’on éteindrait ici mais se rallumeraient ailleurs. Quatre ans après, faisant le bilan de ce qui a donné lieu à un affrontement tragique entre la volonté démocratique des peuples et les ambitions impériales[15], Hamid Dabashi écrit : « Ce qui a changé de façon irréversible c’est l’évaluation chiffrée de la volonté démocratique de l’ensemble du peuple, 422 millions d’Arabes et 1,3 milliard de musulmans. Cette évaluation chiffrée de la libération représente la dynamique majeure de notre histoire contemporaine et elle ne sera pas inversée[16]. » La succession, depuis 2011, de soulèvements y compris dans des pays, comme l’Algérie ou le Soudan, que l’on croyait condamnés à l’immobilisme, confirme le jugement du penseur irano-américain. Il est, du reste, loin d’être le seul à avoir cette conviction : « Ce qui se passe aujourd’hui est annonciateur d’une naissance nouvelle des sociétés arabes[17] », dit, par exemple, l’écrivain marocain Mohamed Berrada.
Ces différentes mises en mouvement, qui n’ont cessé de se succéder, se produisent, en effet, comme en écho les unes aux autres, et excèdent les limites temporelles, spatiales et culturelles qu’on a tenté de leur imposer. Chacune s’inscrit dans une histoire propre et en même temps entre en résonance avec d’autres histoires. Ainsi, par exemple, des révoltes du Rif, au nord du Maroc. Elles éclatent à partir de 2016, et résonnent avec l’histoire de cette région largement berbérophone et marginalisée. Des soulèvements s’y étaient déjà produits en 1921 contre les puissances coloniales, l’Espagne et la France, et avaient été durement réprimés. Les bombes de gaz à l’ypérite qui avaient été utilisées contre la population ont laissé leur empreinte sur la mémoire, et probablement aussi sur la santé des habitants[18]. D’autres soulèvements, contre le pouvoir marocain cette fois, ont éclaté de façon récurrente, à partir de 1958, en particulier en 1984. En 2016 ces soulèvements, qui prennent le nom de Hirak (le « mouvement » en arabe), se réfèrent à la fois à cette histoire proprement rifaine, mais aussi à l’épisode marocain des printemps arabes, c’est-à-dire au mouvement du 20 février 2011, étouffé mais célébré chaque année par des manifestations qui reprennent les revendications démocratiques.
Un lien, au moins symbolique, s’établit un peu plus tard avec l’Algérie. Les manifestations de refus collectif du maintien en place du régime qui ont débuté en février 2019, après s’être désignées comme la Protesta, peut-être une référence à la protesta du Mouvement des Indignés de la Puerta del Sol, à Madrid (mai 2011), a maintenant pris le nom de Hirak, comme le mouvement du Rif[19]. On est passé ainsi de l’Europe au Maghreb. Cette circulation du signifiant instaure un espace à la fois commun et diversifié.
Les effets de résonance ne se limitent cependant pas à une zone islamo-arabo-berbère. D’autres soulèvements du même ordre avaient eu lieu précédemment. En Grèce, sur la place Syntagma d’Athènes, en 2008, puis en Iran en 2009, avec le mouvement vert. Dans l’Europe du Sud, en Albanie, en Serbie, des mouvements de contestation ne cessent de se dérouler, largement invisibles dans les médias du fait de ce que certains appellent un « blocus médiatique ». En Asie, sur le continent américain (Occupy Wall Street, septembre 2011), en passant par l’Afrique – le mouvement populaire de 2014 qui, au Burkina-Faso a abouti au départ de Blaise Compaoré, reprenaient les slogans des révolutions arabes – en différents lieux, en différents moments, étouffé ici un nouveau feu s’est rallumé ailleurs. Si l’on prend au sérieux cette aspiration démocratique et ce refus de l’Empire sous ses formes politiques mais aussi économiques, on voit qu’en un sens au moins, la scission binaire entre Occident et Orient, ou entre Nord et Sud, n’est plus opérante, même si on s’obstine à la maintenir.
Penser le Nord à partir du Sud
Peut-être serait-il temps de renverser les perspectives et d’imaginer une autre géographie des mouvements sociaux et politiques. Il n’y a rien là de fondamentalement nouveau. En son temps, par exemple, le mouvement français de libération des femmes du début des années 1970 s’était représenté sur le modèle des mouvements de libération nationale. Les paroles de l’hymne de ce mouvement disaient « nous sommes le continent noir » et son refrain appelait les « femmes esclaves à se lever ». On était encore loin de ce que le black feminism puis le féminisme décolonial ont mis en lumière, des rapports complexes et contradictoires des femmes « blanches » avec la colonisation. Mais l’imaginaire social allait déjà chercher du côté des Suds[20]. Le mouvement français des « Gilets jaunes » qui a débuté à l’automne 2018, faisant couler immédiatement beaucoup d’encre tant il revêtait des formes inattendues, a repris les slogans les plus marquants des révolutions arabes : « Dégage » et « Le peuple veut la chute du régime », comme si l’impulsion au refus venait cette fois-ci du Sud.
« Dégage » (Irhal en arabe) a été le cri même du mouvement insurrectionnel qui s’est propagé depuis la Tunisie de janvier 2011. Le fait qu’il ait été utilisé d’abord en français est intéressant en soi. L’arabe n’utilise pas le « vous » de politesse. L’appropriation du mot français permet le tutoiement et marque le refus de la déférence due aux puissants. Avec ce « dégage », on vide le lieu du pouvoir sans dire par qui on projette de le voir occupé. Il ne s’agit pas seulement du pouvoir purement politique, mais aussi du pouvoir patriarcal. Nombreuses ont été, en effet, les femmes à pousser ce cri ou à l’arborer sur des pancartes et ce faisant à s’affirmer comme sujets. Du même coup elles rendaient caduque la représentation orientaliste des femmes qui les assignait à la passivité. De ce fait la subjectivité politique des insurgé.e.s devenait genrée[21].
Avec le mot « Dégage » le mouvement insurrectionnel, à la fois tragique et festif, se présente comme moment de la négativité, tout à fait à l’opposé d’une conception léniniste – ou si l’on préfère léninienne – de la révolution, où le lieu du pouvoir doit être immédiatement occupé, une fois son détenteur précédent expulsé. Pour que le rêve révolutionnaire puisse se transformer en réalité, écrit Lénine en 1902 dans sa brochure Que faire ? il faut disposer à la fois d’une théorie et d’une organisation constituée d’hommes « dont la profession est l’action révolutionnaire[22] ». En effet, « il ne saurait y avoir de mouvement révolutionnaire solide sans une organisation de dirigeants stable et assurant la continuité du travail[23] ». Mais cette forme organisationnelle, centralisée et hiérarchisée porte, en elle-même, le processus de destruction du mouvement révolutionnaire, puisqu’en comblant le vide, elle se contente de remplacer une structure de pouvoir par une autre. Les révolutions arabes, sans bureaucratie de remplacement toute prête à l’emploi, ne se sont pas auto-détruites, mais ont été attaquées en quelque sorte de l’extérieur. Elles ont été souvent l’objet de répressions plus ou moins sauvages ou de tentatives de diversion, par l’organisation de semblants de consultations populaires ou par la mise en place de mini-réformes ou de simulacres de réformes. C’est ce qui s’est passé au Maroc en 2011 avec l’adoption d’une nouvelle Constitution, ou plus de vingt ans auparavant, en Jordanie en 1989[24]. Les émeutes qui s’y étaient produites dénonçaient « la clique au pouvoir à Amman ». La crise avait été désamorcée par la mise en place d’un processus d’élections libres et la promesse d’un dialogue plus ouvert avec les sujets du roi Hussein qui régnait alors sur le pays[25]. Le pouvoir était exercé de fait, rien n’a été modifié en profondeur ni dans un cas, ni dans l’autre. Ces simulacres n’ont fait illusion qu’aux yeux de ceux qui ne demandaient qu’à se laisser berner et ont servi surtout à justifier les mesures de répression prises parallèlement.
Des révolutions arabes, mais aussi des autres formes de protestations collectives qui se sont propagées à travers le monde, on a dit qu’elles étaient sans leaders, mettant en scène de nouveaux acteurs sans expérience politique, et donc, pour cela aussi, vouées à l’échec. Les figures charismatiques qui surgissent au fil de ces insurrections ne sont donc effectivement pas celles de chefs de parti, mais celles de « martyrs » (chahiid), c’est-à-dire de « témoins » (chahid, mot ayant la même étymologie que chahiid)[26], comme le tunisien Mohamed Bouazizi qui s’est immolé par le feu à Sidi Bouzid, ou Mohsen Fikri, mort à Al Hoceima (Maroc) en 2016, broyé dans une benne à ordure alors qu’il tentait de s’opposer à la saisie et à la destruction de sa marchandise par des agents de la ville. L’existence et les circonstances de la mort de ces petites gens, un marchand ambulant de fruits et légumes et un vendeur de poisson, portent témoignage de la hogra, c’est-à-dire du déni de dignité et de justice. Nasser Zefzafi, considéré comme le leader du mouvement du Rif, et condamné à vingt ans de prison, fait exception. Ancien chômeur, mais appartenant à une famille de militants liée Abdelkim el-Khattabi, le héros du mouvement de résistance rifaine contre la France et l’Espagne, et appartenant à la même tribu, il est investi à la fois comme « amghar » et comme « mahdi ». Sa légitimation est donc double : locale, puisqu’il est reconnu comme chef berbère (amghar) du Rif, et religieuse, voire messianique, puisque le mahdi, c’est l’imam caché et le rédempteur[27]. Cette interpénétration des horizons de sens et des répertoires d’action s’inscrit dans une logique qui ne se laisse pas réduire aux modèles hérités de l’Europe du dix-neuvième siècle.
À la différence de la conception « séculière » qui s’est imposée dans le Nord chrétien[28], le religieux et le politique s’y révèlent indissociables. Les mosquées et les prêches deviennent un enjeu, le lieu et l’occasion d’affirmer un islam révolutionnaire. « Ces mosquées sont à Dieu et non au Makhzen[29] », proclame Nasser Zefzafi dans la mosquée de son quartier, en mai 2017. Ce pour quoi il sera arrêté par la police quelques jours plus tard et accusé d’« entrave à la liberté de culte », puis condamné pour « atteinte à la sécurité intérieure de l’État » et « pour trahison », après avoir été détenu au secret et très vraisemblablement soumis à la torture. L’exigence de dignité que tous expriment, relève également d’un registre où politique et religieux se renvoient l’un à l’autre. Quand un participant au Hirak déclare : « On demande la dignité que Dieu nous a donnée » les connotations du terme dignité, karama en arabe, ne sont pas les mêmes que celle du mot français. La dignité ce n’est pas seulement la reconnaissance des égards dus à toute personne humaine[30] ; c’est aussi un attribut de Dieu, dont un des noms est Karim (le noble ou le généreux[31]). La bataille de Karameh (autre graphie de karama), en 1968, au cours de laquelle le Fatah palestinien, en Jordanie, réussit à repousser une attaque de l’armée israélienne, a longtemps été considérée comme la première étape de la reconquête par les Palestiniens (et les Arabes), de leur honneur et de leur dignité, en dépit des controverses sur l’issue des combats. La revendication de « dignité » s’inscrit dans cette constellation où apparaissent en même temps la réappropriation de l’islam et les luttes anticoloniales.
Outre le fameux « Dégage ! », le second slogan le plus entendu pendant les révolutions arabes, et qui a été repris en Algérie dans le mouvement de 2019, est « le peuple veut la chute du régime ». On a retrouvé ce slogan tagué sur les murs de Paris au moment du mouvement des Gilets jaunes. On est en droit de s’interroger sur ce qui fait ici le singulier du peuple, terme ô combien polysémique et dont on se demande à juste titre de quoi il est le nom[32]. Ce n’est certes pas le déni de la division, mais bien plutôt le sentiment commun de la « hogra », c’est-à-dire du fait de subir l’injustice et de voir sa dignité bafouée. Au-delà des revendications économiques et sociales, c’est bien ce sentiment que partagent toutes celles et tous ceux qui ont participé et participent encore aux mouvements qui se sont propagés d’un bout du monde à l’autre depuis une dizaine d’années. Le régime (d’autres disent le « système ») bafoue justice et dignité, et attente aussi à la possibilité d’un véritable exercice des libertés qui ne se limite pas aux libertés formelles. En ce sens, les révolutions arabes permettent une lecture de divers mouvements dont celui des Gilets jaunes qui n’est pas entravé par la problématique du populisme.
On a donc face à face le « régime » et le peuple, c’est-à-dire les « gens » dans leur diversité, en un moment de coagulation temporaire qui est celui du mouvement insurrectionnel ou protestataire. Les divisions (de classe et de genre en particulier) ne demandent qu’à réapparaître, et c’est ce qui se produit au moindre semblant de victoire, comme on l’a vu en Tunisie. Désigner le « régime » (nizam), c’est-à-dire un pouvoir autoritaire et arbitraire, c’est aussi exprimer que l’on n’est pas dupe de sa personnalisation. L’image de la personne à laquelle ce pouvoir est identifié – celle bien sûr du détenteur visible ou apparent du pouvoir (Abdelaziz Bouteflika, Hosni Moubarak, Bachar el-Assad, Zine el-Abidine Ben Ali, etc.) – n’est finalement qu’un masque derrière lequel se dissimule un État profond dont les composantes et les ramifications ne sont jamais totalement identifiables, avec ses réseaux de clientèles, de mafias, de services secrets, et de polices parallèles. Ce « régime » est caractérisé aussi bien par sa compacité qui le rend impénétrable et résilient, mais aussi par sa rapacité, sa cruauté, n’hésitant jamais à utiliser les moyens de la violence la plus extrême. Les institutions, que la soi-disant communauté internationale feint de prendre au sérieux, sont des fantoches, ou encore, des simulacres de parlement, de Cour de Justice, etc. Ces régimes ne reconnaissent de fait aucun véritable corps intermédiaire. Les partis politiques y sont absents, qu’ils soient interdits, ou qu’ils aient perdu toute crédibilité, parce qu’absorbés eux-mêmes dans cette sphère obscure et compacte du pouvoir. La presse est aux ordres, ou bien elle est elle aussi interdite et les journalistes emprisonnés ou contraints au silence ou à l’exil. Quelques associations sont tolérées mais sous contrôle. L’usage de la « novlangue » se généralise, en particulier en direction de l’international qui feint de croire aux discours de ce pouvoir, pour des raisons qui tiennent à la fois à des alliances politiques et à des intérêts économiques.
Les mots sont importants[33], mais quand ils ne renvoient plus à aucun signifié et qu’ils brouillent la communication au lieu de la permettre, et ceci est vrai au Nord comme au Sud, il faut bien inventer d’autres signifiants. C’est ce qui se passe dans les rassemblements insurrectionnels, avec le chant, la danse[34], les vêtements : gilets jaunes en France, blouses blanches à Rabat au Maroc. En 2014, les manifestants de Hong Kong brandissaient des parapluies. En 2019, ils s’habillent de noir. À Alger en 2019, comme ce fut le cas à Tunis en 2011, les épaules des femmes et des hommes se couvrent de drapeaux, marquant ainsi la réappropriation de la légitimité nationale. On est entre le symbolique et le ludique.
Les rassemblements de protestation et de refus sont donc aussi des performances et des mises en spectacle. Il faut donner à voir, en particulier aux médias du monde entier. Les manifestants brandissent des pancartes rédigées en anglais devant les caméras. À Tunis, en janvier 2011, on pouvait y lire « Game is over », ou encore « Enough is enough ». La pratique perdure. On la retrouve l’été 2019 dans les manifestations qui agitent le Cachemire auquel l’Inde vient de retirer son autonomie. Toute manifestation qui marque une mobilisation collective obéit à un rituel : regroupements sur les places ou dans des rues que l’on « occupe », sit-in sur des emplacements soigneusement déterminés, marches à travers des itinéraires connotés (à Paris, par exemple, les boulevards qui vont de la République à la Nation), etc. Mais les nouveaux mouvements rompent avec ces rituels et en inventent d’autres. Ils parient sur la mobilité grâce aux ressources des réseaux sociaux qui font circuler très vite l’information. Dans le Rif, par exemple, on ne cesse de changer de lieu, à la fois pour dérouter les forces de répression, c’est-à-dire la police et l’armée, mais aussi pour investir tout le territoire, et ne pas se limiter aux centres urbains. Les Gilets jaunes ont adopté des tactiques analogues de mobilité, en choisissant aussi d’être présents dans des quartiers des villes où les manifestations ne passaient jamais, en particulier les « beaux quartiers » parisiens. À Hong Kong, les manifestants de l’été 2019 ont eux aussi choisi la mobilité[35]. La sémiologie des mobilisations change tout autant que sa grammaire.
Dans son livre The Arab Spring, analyse des printemps arabes qu’il produit à chaud, alors que les événements sont en train de se dérouler, Hamid Dabashi fait observer que le « régime » dont les insurgés veulent la chute n’est pas seulement un régime directement politique mais aussi un régime de savoir. Les printemps arabes ont sonné certes la fin du discours colonial mais aussi celle de la « postcolonialité » qui conservait une vision binaire du monde. « Le printemps arabe constitue le moment inaugural d’une récupération du monde que “l’Occident” (nom de code racialisé du capitalisme prédateur) a perverti et détruit[36] ». Ce à quoi on assiste avec ces mouvements qui se propagent tels des foyers d’incendie qui s’éteignent ici et s’allument ailleurs, sans souci des frontières entre un pays ou l’autre, le Nord ou le Sud, l’Orient ou l’Occident[37], c’est à l’éclosion de l’« émancipation épistémique d’une vieille géographie de domination et de déshumanisation – cette géographie que les anthropologues avaient élaborée pour permettre aux colonialistes de gouverner. En revendiquant une sphère publique globale, et en restaurant une capacité d’agir dans l’histoire, on découvre que le monde finalement est une planète, et non un espace bipolaire traversé par un axe Est-Ouest[38] ».
Si l’on adopte ce point de vue qui est celui d’une mondialité où l’on circule d’un territoire à l’autre en observant les imbrications et les mises en abyme, sans chercher à établir un rapport d’influence et sans chercher à subsumer les différents phénomènes sous un facteur unifiant, on peut observer comment se sont propagées de nouvelles formes de refus collectifs et de tentatives de réinvention des modalités d’être en commun. En un sens, le Sud offre comme un miroir grossissant de phénomènes repérés au Nord, mais souvent à l’état encore embryonnaire, comme l’effacement des corps intermédiaires (partis, syndicats), ou la défiance vis-à-vis des médias officiels. Le régime de savoir issu de la colonisation, ou le régime de savoir colonial, avait instauré de grandes coupures et des hiérarchies qui semblaient insurmontables. Les murs ne se sont pas encore effondrés, mais ils s’effritent et des voix longtemps étouffées se font entendre. L’espoir d’un monde authentiquement commun émerge peu à peu, et avec lui la sensation que le désir de dignité, de justice et de liberté ne s’est pas éteint.
Notes :
[1] Voir Judith BUTLER, Rassemblement : pluralité, performativité et politique, Paris, Fayard, 2016, et Michael Hardt et Antonio Negri, Assembly, Oxford, Oxford University Press, 2017.
[2] Étienne TASSIN, Un monde commun, Paris, éd. du Seuil, 2003, page 11.
[3] Jacques RANCIÈRE, Aux bords du politique, Paris, Gallimard Folio, 2004, page 114.
[4] Se référant à Hannah Arendt, Étienne Tassin écrit : « L’agir est le mode sous lequel le politique se déploie » (ouvrage cité, page 11).
[5] Ma référence à Édouard Glissant est ici évidente.
[6] J’utilise ce concept au sens que lui a donné Gramsci. Les références sont multiples. Je citerai ici les Cahiers de prison en rappelant que pour Gramsci les rapports de domination incluent les rapports Nord-Sud, comme il le développe dans son article sur la question méridionale publié en 1926 dans L’Unita. « Les intellectuels sont les “commis” du groupe dominant, destinés à remplir les fonctions subalternes de l’hégémonie sociale et du gouvernement politique, d’assurer autrement dit : 1) le consentement “spontané » des grandes masses de la population à la direction imprimée à la vie sociale par le groupe fondamental dominant, consentement qui naît historiquement du prestige (et donc de la confiance) que tire le groupe dominant de sa position dans le monde de la production ; 2) le fonctionnement de l’appareil de coercition de l’État qui garantit “légalement” l’obéissance des groupes qui ne “consentent”, ni de façon active ni de façon passive » (Cahier 12, dans Antonio GRAMSCI, Cahiers de prison, tome III, Paris, Gallimard, 1978, pp. 314-315).
[7] Je reprends ici les termes que Partha Chatterjee utilise à propos du nationalisme. Cf. Partha CHATTERJEE, The Nation and its fragments, Princeton, Princeton University Press, 1993, page 9.
[8] On peut définir comme anticoloniales les diverses formes d’opposition à la colonisation. La démarche décoloniale telle qu’elle s’est développée à partir de l’Amérique latine, depuis les années 1990, entend rompre avec l’eurocentrisme et se mettre à l’écoute des sujets et des groupes à peu près réduits au silence du fait de la colonisation. Voir : Pluriversalisme décolonial, sous la direction de Zahra ALI et de Sonia DAYAN-HERZBRUN, Tumultes n° 48, Paris, éd. Kimé, mai 2017.
[9] « Michèle Alliot-Marie et la Tunisie, retour sur une polémique », Le Monde, 7 février 2011, consultable sur : <https://www.lemonde.fr/politique/article/2011/02/07/michele-alliot-marie-et-la-tunisie-retour-sur-une-polemique_1476436_823448.html>
[10] Voir : « Le discours de Dakar de Nicolas Sarkozy », Le Monde, 9 novembre 2007, consultable sur : <https://www.lemonde.fr/afrique/article/2007/11/09/le-discours-de-dakar_976786_3212.html>
[11] Voir : Le Moyen-Orient en mouvement, sous la direction de Sonia DAYAN-HERZBRUN et Azadeh KIAN, Tumultes n° 38-39, Paris, éd. Kimé, 2012.
[12] Dans Les Frères musulmans (1928-1982) présenté par Olivier CARRÉ et Gérard MICHAUD (pseudonyme de Michel Seurat), Paris, Gallimard, 1983, page 195. La suite du texte et du programme énumère libertés et droits, dont les droits des minorités, et indique que le régime politique sera fondé sur une assemblée populaire (shura) composée de femmes et d’hommes.
[13] Sur l’émergence et les enjeux des conceptions du « monde musulman », voir : Cemil AYDIN, « Globalizing the intellectual history of the idea of the “muslim world » », in : Samuel MOYN et Andrew DARTORI (dir.), Global Intellectual History, New York, Columbia University Press, 2013, pp. 159-186.
[14] Hamid Dabashi parle d’« open-ended revolutions » in : Hamid DABASHI, The Arab Spring : The End of Postcolonialism, Zed Books, London ; New York, 2012, page 237.
[15] Des États-Unis bien sûr et de leurs alliés européens et moyen-orientaux, mais aussi de la Russie et de ses alliés.
[16] Hamid DABASHI, Can Non-Europeans Think?, London, Zed Book, 2015, page 193.
[17] Mohamed BERRADA, Loin du vacarme, Arles, Actes Sud-Sindbad, 2019, page 249.
[18] D’après les associations le taux de cancers y serait particulièrement élevé, et les moyens de soigner la maladie très restreints (enquête de terrain de février 2019).
[19] La proximité géographique intervient également dans cette circulation des appellations d’un lieu du monde dit arabe à l’autre. La révolution syrienne de 2011 s’est ainsi désignée comme intifada, en lien à la Palestine voisine.
[20] Pas exclusivement d’ailleurs, car la musique de cet hymne était celle d’un chant de la résistance, Le chant des marais. Les branchements imaginaires étaient donc multiples.
[21] Les violences sexuelles que les forces de répression ont fait subir aux femmes, en particulier, mais pas seulement en Égypte avec la pratique par l’armée des tests de virginité,
[22] Lénine, Que faire ?, Paris, éd. du Seuil, 1966, page 168.
[23] Lénine, ouvrage op. cité, page 181.
[24] Pascale EURY, « Jordanie : les élections du 8 avril 1989 », in : Cahiers du CERMOC (1991-2001), Beyrouth, Presse de l’Ifpo, 1991, consultable sur : <https://books.openedition.org/ifpo/5988?lang=fr>
[25] Voir : Tareq TELL « Les origines sociales de la glasnost jordanienne », dans Moyen-Orient : migrations, démocratisation, médiations, sous la direction de Riccardo BOCCO et Mohammad REZA-DJALILI, Genève, Institut des hautes études en développement social, 1994.
[26] Sur l’usage cette notion de « martyr » où religieux et politique ne se distinguent pas, on peut consulter la thèse de doctorat de Kinda CHAIB, Culture du martyre au Liban Sud, entre fabrication de catégories et enjeux mémoriels, soutenue à l’Université Paris 1 en 2017.
[27] Voir : Hamza ESMILI, « Faire communauté. Politique, charisme et religion au sein du Hirak du Rif », dans Mobilisations collectives, religions et émancipation, Tumultes n° 50, Paris, Kimé, 2018. Cette même figure du mahdi a été réactivée à de nombreuses reprises dans les mouvements de contestation ou de révolte des pays à majorité musulmane, et en particulier lors de la révolte du Soudan contre la colonisation britannique à la fin des années 1870.
[28] Voir : Talal ASAD, Formations of the Secular: Christianity, Islam and Modernity, Stanford, Stanford University Press, 2003, 280 p.
[29] Hamza ESMILI, article cité, page 145. Le terme de Makhzen renvoie au Maroc à un mode de pouvoir arbitraire et autoritaire, armé d’un appareil répressif, qui s’exerce en coulisses, dans le secret du palais, derrière la façade du gouvernement officiel. Il correspond à ce qu’ailleurs, en Turquie par exemple, on a appelé l’État profond.
[30] C’est plutôt en ce sens que Sekou Touré invoque la dignité du peuple africain, pour refuser en août 1958, dans un discours célèbre qu’il tient face au Général de Gaulle, le maintien de la Guinée dans la communauté française : « Nous avons, quant à nous, un premier et indispensable besoin, celui de notre Dignité. Or, il n’y a pas de Dignité sans Liberté, car tout assujettissement, toute contrainte imposée et subie dégrade celui sur qui elle pèse, lui retire une part de sa qualité d’Homme et en fait arbitrairement un être inférieur. »
[31] L’icône de la résistance du Rif, dans les années 1920, est, du reste connu sous le nom d’Abdelkim, c’est-à-dire le serviteur du digne, noble et généreux.
[32] Voir : Thomas BERNS et Louis CARRÉ (dir.), « Noms du peuple », in :Tumultes n° 40, Paris, éd. Kimé, juin 2013.
[33] Voir : Pierre TEVANIAN et Sylvie TISSOT, Les mots sont importants, Paris, Libertalia, 2010, 290 p.
[34] Ainsi la dabka, cette danse pratiquée dans tout le Proche-Orient par les hommes qui font cercle en se tenant par les épaules, et qui fut l’une des expressions corporelles de la révolution syrienne à ses débuts. Danser dans les rues, c’était ressentir et montrer que l’on pouvait occuper ces espaces publics auparavant contrôlés par le « régime », mais aussi se laisser aller à la joie des corps.
[35] « La tactique des manifestants a également évolué. Aux grandes manifestations, les organisateurs préfèrent désormais les mobilisations éclair, bloquant simultanément plusieurs carrefours dans différents quartiers, contraignant la police à se montrer extrêmement mobile. La stratégie des manifestants tient en un slogan, inspiré de Bruce Lee : « Je suis l’eau ». (Le Monde, 12 août 2019, à propos des manifestations de Hong Kong).
[36] Hamid DABASHI, The Arab Spring, page 245.
[37] Et par exemple aussi dans ces zones à la frontière de l’Europe, comme la Bulgarie depuis 2013, la Serbie ou l’Albanie, un peu plus tard.
[38] Hamid DABASHI, ouvrage op. cité, page 54.