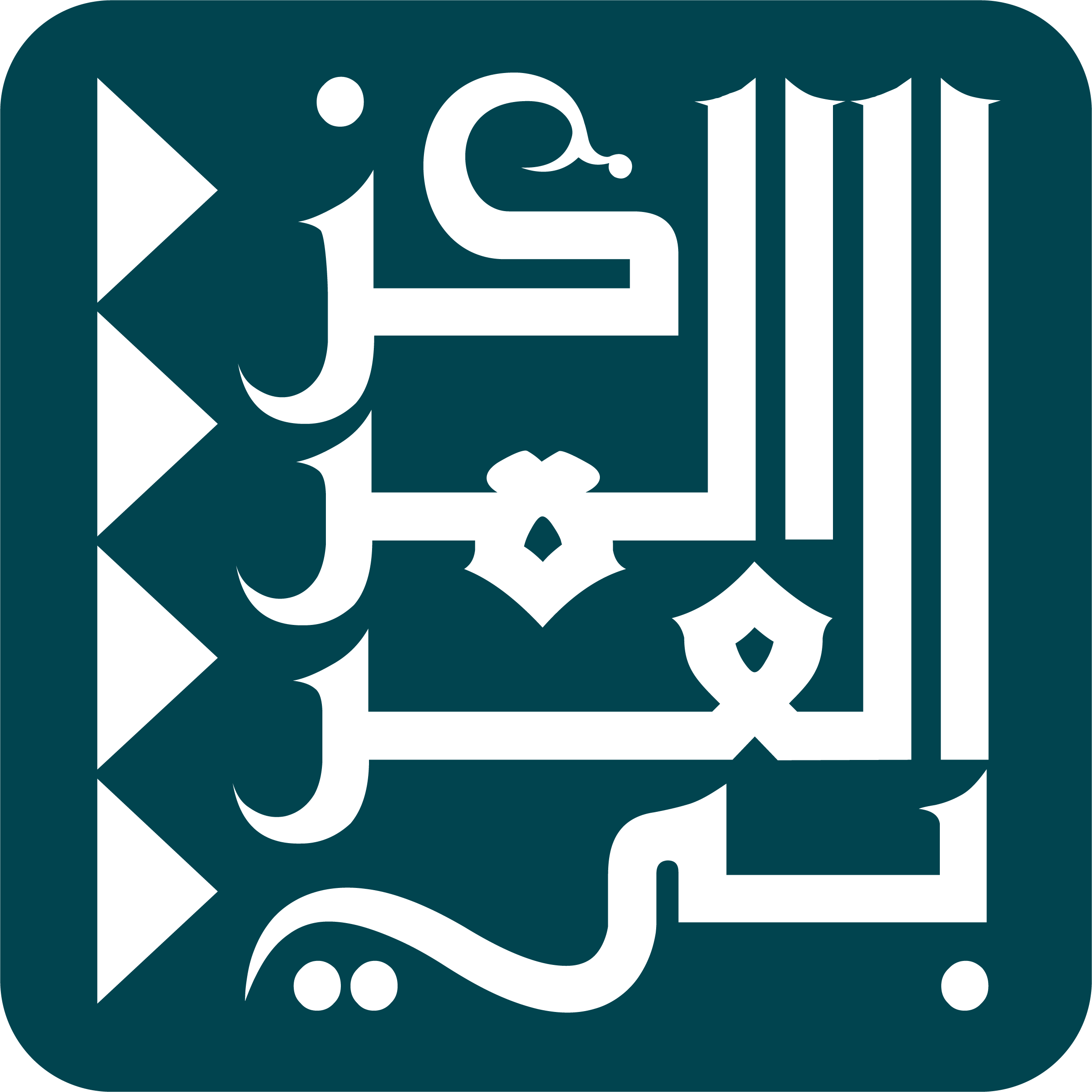Entretien avec Mohammed Berro
Propos recueillis par Racha Abazied
Arrêté à 17 ans en mai 1980 pour avoir distribué une publication interdite, Mohammed Berro passera au total treize années de sa vie dans les geôles du régime d’Hafez al-Assad. Dans son ouvrage Sauvé de la guillotine : huit années dans la prison de Palmyre (en arabe, éd. Jossour, 2021), il revient sur ces huit années passées dans la pire des prisons syriennes : Palmyre (ou Tadmor). Si pour beaucoup, ce nom évoque les splendeurs de la ville antique, rien que sa prononciation à voix basse faisait trembler de terreur les Syriens.
L’ouvrage commence par la citation de Simone Weil « Tout ce qui est soumis au contact de la force est avili, quel que soit le contact. Frapper ou être frappé, c’est une même souillure ». Une citation qui donne le ton de l’ouvrage, le calvaire d’un rescapé de l’horreur et une réflexion sur cette relation complexe entre bourreau et victime que des milliers de Syriens continuent à vivre encore aujourd’hui. À l’occasion de sa venue au CAREP Paris pour présenter son ouvrage, Mohammed Berro a bien voulu répondre à quelques-unes de nos questions.

Mohammed BERRO, Sauvé de la guillotine : huit années dans la prison de Palmyre (en arabe), éd. Jossour, 2021, 383 p.
R. A. : Monsieur Berro, pourquoi ce livre et pourquoi était-ce si important pour vous de raconter votre expérience à Palmyre ? Vous a-t-il fallu beaucoup de temps pour l’écrire ?
M. B. : Ce livre n’est pas un roman. C’est un témoignage. J’ai tenu à y consigner mon expérience carcérale. J’y relate aussi ce que j’ai vu et entendu des autres survivants. Tout est vrai. Ce sont des faits que j’ai souhaité porter à l’attention du monde. J’ai écrit ce livre car j’espère qu’il contribuera à éveiller l’opinion publique et la conscience générale et qu’un jour cela aboutira à traduire ces criminels en justice, au moins pour que ces crimes cessent et que de telles horreurs ne puissent plus se produire. Ce livre a aussi un autre objectif, celui de rendre à ces milliers de victimes une sorte d’hommage pour ce qu’ils ont enduré, pour que leur mémoire ne soit pas perdue. Pour que ceux qui ont péri ne soient pas tués deux fois, une fois par ce régime de terreur et une seconde par l’oubli.
Raconter toutes ces histoires et les garder vivantes était aussi important pour moi. Je cite d’ailleurs dans mon livre mon ami et poète Rami qui dit : « Rien, même pas une ombre ne peut t’abriter de ta mémoire, car elle brille comme le soleil » et moi j’ai écrit pour que les souvenirs ne m’échappent pas. Le travail était certes très difficile, mais vous savez, pendant les vingt-trois années qui ont suivi ma libération, je n’ai cessé de parler de la prison autour de moi, et cela m’a permis de tout mémoriser dans les moindres détails. Pendant le confinement, je me suis enfermé quatre mois pour l’écrire ; consigner les faits d’une traite, noir sur blanc, était bien plus difficile que je ne le croyais. Je pleurais continuellement et fermais la porte pour que ma famille ne m’entende pas.
R. A. : Pouvez-vous revenir brièvement sur votre arrestation et le contexte général au début des années 1980 ?
M. B. : L’ambiance générale était tendue et la surveillance était très soutenue à l’époque. Le régime voulait museler tout le monde et il sévissait particulièrement contre les Frères musulmans, surtout après le massacre de l’École de l’artillerie à Alep[1]. Le régime avait encerclé la ville avec des blindés. Il y a eu plusieurs massacres dans la ville (le massacre du quartier d’al-Masharqa où une centaine de jeunes ont été tués, celui de Bustan al-Qasr où 35 personnes ont trouvé la mort), tous commis au nom de la lutte contre les Frères. Les arrestations, les poursuites et les fouilles dans les maisons allaient bon train. Assad voulait écraser toute dissidence et toute velléité de contestation, et ça s’est durci encore plus après la tentative d’assassinat échouée du 26 juin 1980 qui a visé Hafez al-Assad.
Nous étions un groupe de huit jeunes entre seize et dix-huit ans. On nous avait dénoncés parce qu’on distribuait, ou plus exactement, parce qu’on s’échangeait la revue Al-Nazir. C’était une petite publication clandestine de 16 pages publiée par les Frères musulmans (mais qui n’a rien à voir avec la revue égyptienne du même nom qui s’est arrêtée dans les années 1940). Un soir, ils sont venus m’arrêter chez moi. J’ai été réveillé par la crosse d’un fusil devant les membres de ma famille ébahis, et j’ai été conduit au Centre de la sécurité générale d’Alep par les quatre voitures remplies d’agents venus me cueillir. À ma mère qui essayait, entre pleurs et supplications, de leur dire que je n’avais rien fait et que je n’appartenais à aucun mouvement, il lui avait lancé la formule classique : « On va lui poser deux ou trois questions et on vous le ramène dans cinq minutes. »
Après quelques jours passés à l’isolement, j’ai été transféré dans une cellule commune où j’ai retrouvé mes amis arrêtés avant moi. Je n’avais pas besoin de leur poser de questions pour comprendre ce qu’ils avaient traversé. La terreur, leurs corps tuméfiés étaient explicites, et dans les sous-sols du centre de la sécurité, on entendait les cris d’hommes et de femmes qui se mêlaient à cette odeur si particulière de sang, de puanteur et de sueur. Ensuite, mon tour est venu pour l’interrogatoire et la torture pour confirmer ce qu’ils voulaient, que j’avais bien transmis cette revue. Ensuite, j’ai été transféré dans la Prison centrale d’Alep, et puis à celle de Palmyre dans le désert en août de cette même année 1980. Deux mois plus tard, nous avons été traduits devant un tribunal militaire. À l’époque, l’article 49 venait d’être promulgué. Il stipulait que toute personne appartenant à la formation des Frères musulmans était passible d’exécution.
Mes sept amis ont tous été exécutés. Nous avons été accusés de « dissimulation d’informations mettant en danger la sécurité de l’État ». Le chef du tribunal militaire à l’époque s’appelait Ghazi Kanaan[2]. Et je me souviens encore que ce Ghazi Kanaan m’a tiré par l’oreille et a dit « on va t’exécuter ? toi ? ». C’était peut-être un de ses rares moments d’humanité. Trois jours après le verdict d’exécution, j’ai été rappelé au tribunal. On a révisé ma sentence pour l’abaisser à dix ans de prison car j’avais seulement 17 ans. Bien entendu, des jeunes de 16 et 17 ans comme moi n’ont pas eu la même chance et des médecins légistes avaient trafiqué leurs dates de naissance. Ces tribunaux étaient une mascarade. 150 prisonniers étaient jugés en à peine 80 minutes. Chacun passait moins d’une minute devant le juge qui lisait son nom et annonçait sa condamnation. On n’avait pas le droit d’ouvrir la bouche. Je n’ai pas accueilli l’abaissement de ma peine avec joie. Quand on est à Palmyre, la mort devient une délivrance, notre souhait le plus cher pour échapper à la souffrance et on l’appelle de tous nos vœux.
R. A. : Vous avez été transféré à Palmyre en août 1980, en pleine chaleur du désert, attaché dans un bus tout le long d’un terrible voyage. Vous racontez également l’horreur de la « séance d’accueil » sous les coups des câbles métalliques des geôliers sous le soleil brûlant sans la moindre goutte d’eau. Des sévices qui vont devenir quotidiens ensuite. Sans revenir sur tous les détails de torture que vous racontez dans le livre, aviez-vous conscience, en entrant à Palmyre, que vous alliez passer huit longues années de terreur dans cette prison ?
M. B. : On savait quand on entrait à Palmyre, mais personne ne savait ni quand, ni s’il allait ou non en sortir. Sur la porte d’entrée – c’était une porte métallique, large d’un mètre et noir de crasse – on avait griffonné en blanc en une écriture maladroite « L’entrant est perdu et le sortant renaît ». Ça résume un peu l’idée. Palmyre n’était pas un centre de détention comme les autres. Si je dois décrire ce qui se rapprocherait le plus des conditions de détention de cette prison, ce seraient les conditions des « esclaves ». C’est un lieu où l’on brise l’être et tout espoir et même toute possibilité de vie. Nos conditions de vie étaient celles des animaux enfermés dans des cages exiguës attendant l’abattoir. Nous étions affamés, avions trop chaud ou trop froid, n’avions pas droit à des soins pour soulager nos blessures, ne possédions rien, même pas de cuillère pour manger. L’humiliation, la peur et la torture ponctuaient notre quotidien.
R. A. : Vous êtes entré à Palmyre un mois après le fameux massacre du 27 juin 1980. En avez-vous entendu parler à l’époque ? Avez-vous croisé des survivants lors de votre arrivée ?
M. B. : Oui, je raconte cela dans le livre. Lorsqu’on a intégré notre dortoir, le numéro 14, il restait encore des traces de balles et de projectiles lancés contre les prisonniers qui avaient été exterminés là. Sur les murs, subsistaient encore des choses visqueuses, des restes de sang noircis et de chair humaine qui n’avaient pas été nettoyés. Le sol en béton avait été recouvert par endroits, mais comme certains trous étaient profonds, il était inégal avec des pointes et des creux. Nous n’avions pas de matelas au début et peu de place pour nous allonger. Ils ont fait cela volontairement pour nous empêcher de trouver le moindre repos à nos corps meurtris. Avec le temps, j’ai fini par rencontrer des gens qui étaient dans une aile séparée et qui avaient vécu le massacre. Ce qu’ils m’ont raconté confirme des faits bien connus : les Brigades de la Défense dirigées par Rifaat al-Assad (frère de Hafez) avaient donné l’ordre d’assaut. Entre 800 et 1 000 prisonniers ont été tués en une nuit à coups de balles et de bombes lancées dans les cellules. C’était le lendemain de la tentative d’assassinat manquée contre le président Assad. Les cadavres ont été évacués par des camions militaires pour être enterrés dans le désert. Une opération de représailles et d’intimidation qui sera suivie deux ans plus tard par le massacre de la ville de Hama de 1982, perpétré sous les ordres de cette même brigade.
R.A. : Qui étaient les prisonniers de Palmyre ? Y avait-il beaucoup de Frères musulmans parmi eux ? Et quel climat régnait entre eux ? Les conditions d’emprisonnement créaient-elles des tensions entre les prisonniers ?
M. B. : La prison de Palmyre avait pour but d’exterminer de la manière la plus lente et la plus cruelle toute protestation, mais surtout d’éradiquer le mouvement des Frères musulmans. De là à dire que la plupart appartenaient réellement au mouvement des Frères serait faux. La plupart étaient des gens ordinaires. Beaucoup étaient croyants mais comme la majeure partie de la population syrienne. On ne peut pas dire qu’ils étaient islamistes pour autant. La foi dans ces moments-là est salvatrice, elle permet en tout cas de s’accrocher à quelque chose de plus fort. Le salut final de l’âme peut-être. Sans elle, certains n’auraient certainement pas tenu. Beaucoup étaient instruits et certains faisaient partie de l’élite sociale : médecins, ingénieurs, pharmaciens, professeurs ou des jeunes comme moi à l’époque. Ceux que l’on comptait comme appartenant au mouvement des Frères musulmans représentaient environ 20 %, mais c’est une simple estimation. Quant aux prisonniers de gauche (les Communistes et les membres du Parti du Travail), ils étaient environ 90 enfermés dans une aile séparée. Ils n’étaient pas aussi sévèrement torturés que nous. Seulement lors de leur arrivée, ou à certaines occasions. Pour ce qui est du climat entre les prisonniers, je dirais que, sauf rares exceptions, que c’est l’entraide qui régnait. On soulageait les blessures les uns des autres. On essayait dans la mesure de nos moyens de protéger les plus faibles et d’aider à marcher ceux qui n’arrivaient plus à se lever. Vous savez, nous pensions tous être condamnés à une mort plus ou moins lointaine, dans ces conditions, le sens des choses change et les rivalités ici-bas ne servent plus à grand-chose.
R. A. : Et les geôliers qui étaient-ils ? Quel est leur profil, si l’on peut en dresser un ? Pensez-vous que le pardon est possible pour les survivants ? Pensez-vous qu’un jour, les ex-prisonniers et les ex-geôliers pourraient se côtoyer dans les mêmes lieux de vie ?
M. B. : Le régime a œuvré à créer des monstres dénués de tout sentiment d’humanité. La plupart étaient des gens perdus, qui avaient commis des crimes et qui avaient été entraînés à tuer. Pour être geôlier, il fallait savoir tuer un innocent de sang-froid, c’était une partie de leur initiation. Certains faisaient même du zèle. Au moment des repas ou de la sortie hebdomadaire sous les douches, je devrais plutôt dire « séances de tortures sous jets d’eau ». Un geôlier avait quelque chose de « divin ». Il agissait comme un Dieu. Il avait droit de vie et de mort et rien ne l’assouvissait plus que l’odeur du sang et les cris de douleurs et de supplications. On entendait leur conversation depuis nos dortoirs. Ils se plaignaient d’être des gens « ordinaires » dehors, de simples soldats dans la vie civile. Des gens qui devaient faire la queue pour acheter du pain par exemple. Ils étaient les maîtres à Palmyre et se croyaient tout permis : nous humilier, nous piétiner, etc.
Personnellement, je n’ai aucune velléité de vengeance. De justice, oui, mais de justice collective et non individuelle. J’ai interrogé nombre de mes camarades après ma sortie et je peux affirmer qu’aucun d’entre eux n’a songé à cela. Quant au pardon, je crois qu’on en aura tous besoin. Évidemment le régime a joué un jeu fin. Il a élargi sa machine tortionnaire à un grand nombre de criminels, ils représentent, depuis le régime de Bachar al-Assad, un pourcentage important de la population syrienne et on ne pourra peut-être pas tous les juger. Oui, il faudra peut-être un jour parvenir à vivre ensemble, faire la paix avec nos tortionnaires, mais une fois que la justice sera faite, et les principaux coupables sanctionnés pour leurs crimes abominables, du moins symboliquement. Il faut que ces crimes monstrueux soient reconnus. Sans cela, aucune paix ne sera possible.
R. A : En quoi la prison de Palmyre différait-elle de la prison de Saydnaya, ce lieu devenu célèbre par la suite pour ses tortures et qui a été dénoncé par Amnesty International sous le régime d’Assad-fils ?
M. B. : La prison de Saydnaya dans les années 1980-1990 n’est pas celle des années 2000. Ça n’a rien à voir. Les prisons après 2011 sont toutes devenues des mouroirs et des lieux de terreur. La situation a empiré depuis et des milliers y croupissent encore. À l’époque, c’était un centre d’arrestation. Comparée à n’importe quelle prison civile, les conditions étaient certes terribles, mais pour ceux qui venaient de Palmyre, c’était le luxe. À Palmyre, les séances de torture étaient quotidiennes, au rythme de trois fois par jour et chacune durait une heure environ. Mais pas à Saydnaya. On vivait en communauté, on pouvait échanger. On avait un petit transistor, et des livres et des journaux nous parvenaient de ceux qui étaient autorisés à recevoir des visites (l’autre aile). Par exemple, on avait pour le repas du matin un œuf dur par personne, alors qu’à Palmyre, c’était un œuf pour 6 ou 7, que l’on partageait avec un fil extrait d’un vêtement. À Palmyre, il n’y avait pas de soin, les coups étaient la seule réponse aux plaies et beaucoup mouraient fréquemment. Je me souviens aussi qu’à Saydnaya, nous avions des cours et des débats. On avait une grande soif d’apprendre et parmi nous, il y avait des professeurs, des scientifiques et des personnes instruites.
Je travaille actuellement sur un deuxième livre qui s’intitule L’homme d’après qui raconte les cinq années qui ont suivi Palmyre et que j’ai passées à Saydnaya. Je crois avoir eu de la chance. Saydnaya a été une sorte de sas de décompression ou de réhabilitation à la vie. Je connais des survivants qui sont directement sortis de Palmyre et qui ont été traumatisés, dans l’incapacité de s’adapter à la vie « normale ». Le choc était certainement trop rude.
R. A. : Qu’avez-vous ressenti lorsque Daesh a détruit la prison ? Étiez-vous heureux d’apprendre cela ?
M. B. : En fait, les images et vidéos de destruction que l’on a vues ne sont pas celles de la prison que j’ai connue. Ils ont détruit la partie nommée Sijn al-Hajaneh, nous étions dans l’aile politique. Cette partie n’a pas été détruite par Daesh, mais le régime l’a transformée progressivement en base militaire. Cela revient au même. Cette prison a disparu, et non, cela ne me réjouit pas du tout. Mes amis survivants m’ont dit la même chose d’ailleurs. J’aurais voulu la préserver comme lieu de mémoire. Y amener mes enfants et ma famille, raconter ce qui s’était passé à mes petits-enfants. D’ailleurs, après ma libération en 1993, je suis retourné à plusieurs reprises, pas dans la prison, personne ne peut l’approcher, mais dans la ville, avec une association qui organise des visites archéologiques. J’essayais de m’en rapprocher le plus possible et de me souvenir, on ne peut pas oublier de toute façon, alors il vaut mieux entretenir le souvenir et le préserver. C’est mon devoir envers ceux qui y ont laissé la vie.
Notes :
[1] Le 16 juin 1979 à l’École d’artillerie d’Alep, un officier en service, Ibrahim el-Youssef, musulman sunnite baassiste et membre des Frères musulmans qui se font appeler les « at-Tali’a al-Muqatila » (« l’avant-garde combattante ») avec pour meneur Adnan Uqla, massacre avec ses complices entre 32 et 83 cadets alaouites.
[2] Ghazi Kanaan (1942-2005) deviendra ensuite le chef des services de renseignements syriens au Liban de 1982 et 2002. En octobre 2004, il devient ministre de l’Intérieur de la Syrie dans le gouvernement de Mohammed Naji al-Otari.