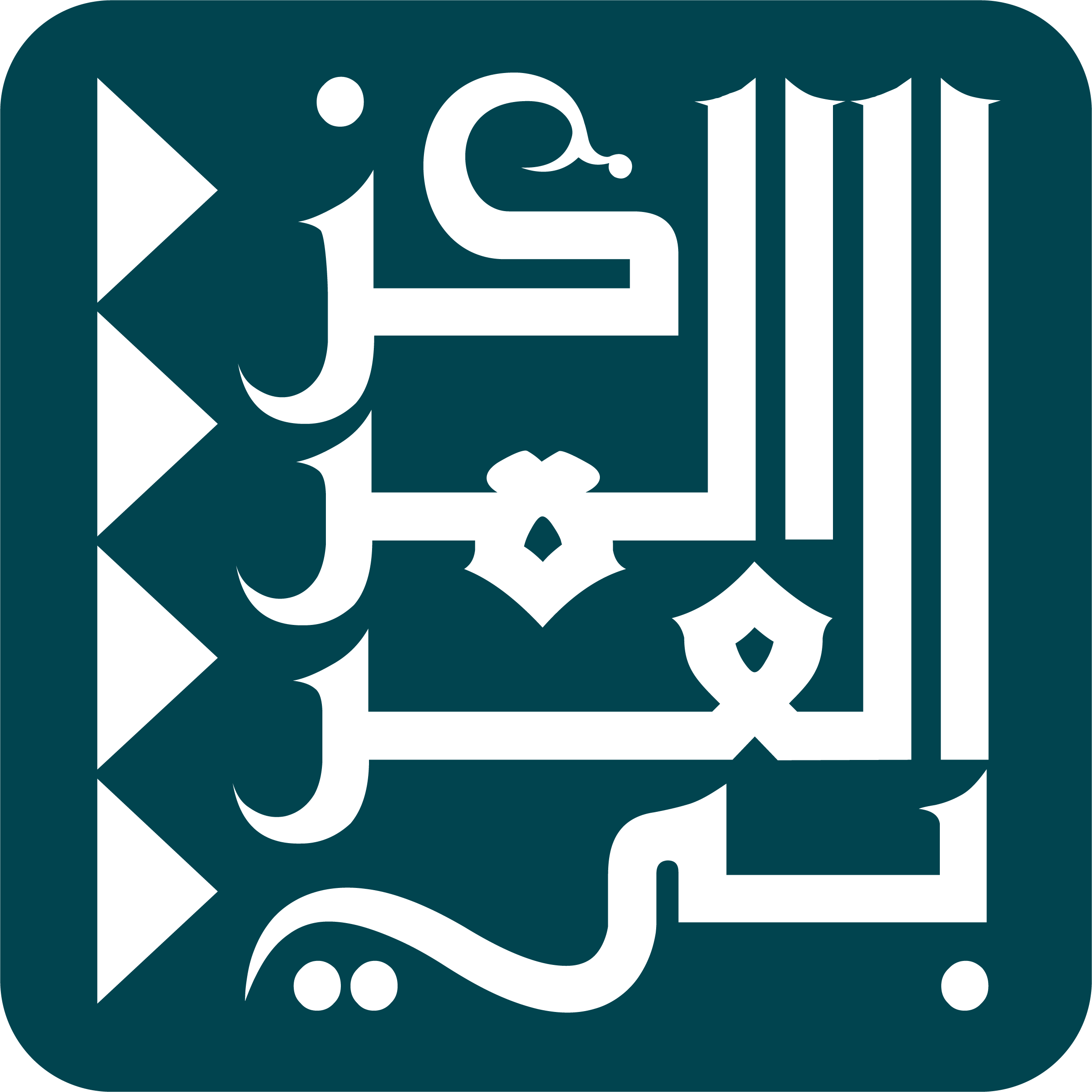Par Moussaab Hammoudi
Est-ce que les élections présidentielles algériennes se tiendront le 18 avril 2019 ? L’actuel président Abdelaziz Bouteflika est candidat à sa propre succession pour un cinquième mandat, mais devrait faire face à plusieurs défis dont son état de santé critique sinon symptomatique de la crise que traverse la politique algérienne. En effet, au-delà de la santé du président, le handicap se situe au niveau des structures de l’État puisqu’il y a ingérence du pouvoir militaire dans l’exercice de la politique.
La politique est un paysage composé de formations multiples et diverses. Cet article s’interroge sur le fonctionnement de la vie politique algérienne à la veille des élections présidentielles de 2019. Quel rôle les formations politiques jouent-elles sur la scène politique algérienne ? Quelle est la place de l’armée dans le paysage politique ? Comment l’Algérie est-elle perçue à cet égard sur la scène internationale ?
Si les observateurs se focalisent essentiellement sur les problèmes de santé du président Bouteflika et sa capacité à gouverner le pays, les partis politiques ne se portent guère mieux. En effet, de tous les régimes autoritaires de type militaire du monde arabe, les partis politiques algériens sont les plus inactifs et sclérosés.
Les partis politiques : des strapontins à la solde de l’armée
Crée en 2014 pour s’opposer à un quatrième mandat d’Abdelaziz Bouteflika, la plateforme de Mazafran, coalition de circonstance de plusieurs partis politiques transcendant leurs clivages idéologiques, peut être considérée comme la dernière tentative politique d’initier un changement démocratique. Depuis, force est de constater que l’action politique est délibérément dénuée de toute vocation mobilisatrice. Les partis politiques algériens rejettent, en pratique, l’idée de mobiliser les citoyens. De fait, leur exercice de la politique se limite aux pratiques clientélistes : il n’engage que les chefs de partis politiques, ne cherche aucun encrage sur le terrain et est en rupture avec la réalité sociale. Ils semblent n’aspirer qu’à une chose : servir le pouvoir central.
Moussaab Hammoudi
Chercheur
Après un double cursus en littérature comparée et finances, Moussaab Hammoudi se spécialise dans les sciences politiques. Il est actuellement doctorant à l’EHESS et travaille sur Les régimes autoritaires dans le monde arabe et s’intéresse plus particulièrement au cas algérien.
Il intervient régulièrement en tant qu’analyste dans différents grands médias tels que Al-Jazeera ou France 24.
Dans ce contexte, les leaders de l’islam politique se contentent d’évoluer dans le cadre de ce qu’ils nomment la « légalité », c’est-à-dire dans le périmètre autorisé par le pouvoir central. Ils cherchent à participer à des coalitions, mêmes montées de toutes pièces et souvent à la dernière minute, tout en se livrant à une ardente concurrence interne. Le Mouvement de la société pour la paix (MSP, Frères musulmans) semble être le parti le plus populaire, même s’il n’est crédité que d’environ 4 % des intentions de vote, à en croire les déclarations de son leader Abderrazak Makri. Par ailleurs, la personnalité de ce dernier ne fait pas l’unanimité, même parmi ceux qui partagent ses idées. Ses propositions sont généralement perçues comme douteuses, et il est souvent jugé déloyal lorsqu’il s’agit de dialoguer avec les divers courants politiques. C’est d’ailleurs l’une des raisons de sa mésentente avec l’autre figure de l’islam politique algérien Abdallah Jaballah du Front de la justice et du développement (FJD). De ce fait, il leur est impossible, à chaque échéance électorale, de présenter une liste commune.
Amar Ghouldu, parti Tadjamou Amel Al Djazaïr (TADJ), dissident des Frères musulmans, récupéré par le pouvoir central, incarne quant à lui la « loyauté inconditionnelle au président ».
Louisa Hanoune, éternelle porte-parole et secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT, communiste). Sans assise électorale, elle cultive le silence et ne semble pas troublée par ceux qui la qualifient de leader obsolète ou de bras civil à la solde de l’ancien patron du Département du renseignement et de la sécurité (DRS), le colonel Mohamed Mediène dit Toufik.
Les formations secondaires, dépourvues de tout ancrage social, jouent tantôt la carte de l’ambiguïté – c’est le cas de Rachid Nekkaz du Mouvement pour la jeunesse et le changement (MJC) – tantôt celle des différences ethniques – comme Naïma Salhi du Parti de l’équité et de la proclamation. Soufiane Djilali du parti Jil Jadid souhaite quant à lui arriver au pouvoir de façon populaire et démocratique, mais il estime que la population est culturellement non démocratique, ce qui laisse douter de la sincérité de sa démarche.
De manière générale, toutes les formations politiques blâment la potentielle défaillance des électeurs. De même, ils dénoncent l’absence de projets, le mutisme à l’égard de la crise de légitimité politique, la crise des institutions étatiques, la politique sécuritaire et la relation entre le militaire et le politique. La question économique est quant à elle complétement éludée par les partis politiques comme par les citoyens.
Pour ce qui est des candidats indépendants, le général-major Ali Guediri, proche du colonel Toufik, était le premier à se porter candidat. Militaire converti en politicien, sa candidature s’apparente à une tentative de règlement de compte entre clans militaires via la politique. On compte également d’anciens hommes d’État qui se manifestent à chaque échéance et dont le comportement est à interroger : Ali Benflis (ancien ministre, chef de gouvernement et candidat à la présidence), l’ancien Premier ministre Mouloud Hamrouche, ou encore l’ancien Premier ministre Abdelmadjid Tebboune. Des citoyens sans envergure viendront allonger la liste pour parachever ce simulacre de démocratie.
L’incapacité de la classe politique à proposer une alternative à Abdelaziz Bouteflika tient à sa résignation à ne pas proposer de solutions objectives de sortie de crise, en privilégiant la périphérie du travail politique plutôt que le centre. Il semblerait que la seule ambition des formations politiques soit d’intégrer, d’une manière ou d’une autre, le pouvoir central.
La mobilisation civile : des obstacles insurmontables
On ne peut appréhender la mobilisation civile de 2019 sans comprendre celle de 2014. À la veille de cette dernière, les mouvements d’opposition ont connu une telle implosion que le pouvoir central n’a même pas eu à faire acte de répression à leur égard. Il a rompu avec les pratiques d’infiltration et de répression des années 2000 et s’est donc contenté de laisser les mouvements, polarisés et inexpérimentés, s’égarer et buter sur leurs propres limites. Le résultat ne s’est pas fait attendre : les formations politiques ont pratiqué en leur sein une discrimination à base idéologique (« islamistes » vs « laïcistes »), tandis que le militantisme professionnalisé qu’elles utilisaient pour attirer des militants sans affiliation partisane ou ayant peu de convictions politiques leur a été fatal, parce qu’il avait reproduit les schèmes de l’autoritarisme central. Prématurément, toutes les formations se sont fragmentées de l’intérieur. Sitôt nées, sitôt délitées.
La mobilisation actuelle porte la marque de cet effritement politique. La mondialisation des rapports familiaux a impacté le rôle de l’individu dans l’espace public, en diversifiant les orientations politiques au sein d’un même foyer, n’a pas eu pour effet réanimer la situation.
Quelques initiatives sont restées sans suite. Ainsi, le collectif Nabni fondé en 2001 s’est heurté à l’obligation de déterminer sa nature, social ou politique, et n’a pas pu développer son projet. Le mouvement Mouwatana est un regroupement hétéroclite de politiciens et de magistrats dont le parcours intrigue, parce qu’il s’agit d’anciens membres du Conseil national de transition (CNT), tristement réputé pour avoir été, entre 1994 et 1997, la vitrine civile de l’armée après le coup d’État de 1992. Parmi les instigateurs de ce mouvement, on compte Zoubida Assoul magistrat, puis conseillère du président du Conseil de la nation, Soufiane Djilali et Ali Benouari (ancien ministre du Trésor). Mouwatana souffre de son image publique : une formation civile relevant de l’« État profond ».
Les initiatives individuelles sur les réseaux sociaux sont beaucoup moins significatives actuellement qu’en 2014. Et plus elles se font rares, plus elles se voient infliger des mesures restreignant leurs libertés allant jusqu’à l’emprisonnement.
L’armée : le pouvoir de la fortune
Malgré les dénégations répétées du chef d’état-major et vice-ministre de la Défense, le général Ahmed Gaïd Salah, l’armée reste l’acteur majeur de la scène politique algérienne. Plusieurs indicateurs en témoignent, dont la répartition du budget de l’État par département ministériel qui fait de l’armée le premier bénéficiaire (loi de finance 2018). La loi de finance 2019 prévoit même d’augmenter ce budget qui passera de 9,43 milliards de dollars (24,95 % du budget) à 10,36 milliards de dollars. La Défense s’approprie donc le quart du budget national de gestion, dépassant de loin les enveloppes allouées aux ministères civils.
L’Algérie est le troisième importateur mondial d’armement conventionnel russe, et le premier importateur à l’échelle du continent africain, avec des commandes conséquentes dont les sous-marins du projet 636 Warschawjanka et classe Kilo, ou encore le système de défense antiaérienne S-400Triumph.
Toutefois, les rapports d’expertise sont sceptiques concernant le bénéfice à tirer de ces dépenses. Le Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité, qui étudie les dynamiques d’exportation d’armes des États membres de l’UE vers les pays du Maghreb, a relevé que l’Algérie est le pays qui consacre le plus de ressources financières au secteur militaire sur le continent africain, alors que ses capacités sont « faibles et non concurrentielles » en matière de conception et de production d’équipements militaires[1].
Le rapport conclut que la priorité accordée au secteur de la défense dans les arbitrages budgétaires explique l’influence de l’armée dans la politique du pays.
Le Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) souligne dans son rapport annuel de 2018[2] que la dépense militaire algérienne a diminué en moyenne de 16 % entre 2014 et 2017, alors que le prix du pétrole a chuté de plus de 45 %. Dans le même temps, la dette totale a augmenté d’environ 154 % du produit intérieur brut (PIB). La différence entre les recettes et les dépenses a donc été principalement financée par la dette.
Ainsi, le poids stratégique du secteur de l’armement pose question, d’autant plus que l’Algérie refuse de s’impliquer militairement dans des conflits tels que la crise en Libye ou la guerre au Sahel.
Bien qu’elle s’en défende, l’armée reste au cœur du processus politique. Elle demeure donc un acteur majeur des élections à venir. Toutefois, et la nuance de taille, elle ne semble pas être en mesure d’apporter des réponses aux problématiques nationales, régionales et/ou internationales actuelles, en tout cas pas celles susceptibles de rassurer les partenaires stratégiques de l’Algérie car ses cercles influents se sont affaiblis après des purges fratricides à répétition. Des acteurs militaires de première importance parmi le cercle des « janviéristes » ont été neutralisés. Ce dernier a également pâti de son organisation tentaculaire difficile à maîtriser : de nombreux clans se sont formés en son sein, qui peinent à cohabiter et se disputent des prérogatives octroyées en fonction de leur loyauté et du clientélisme.
Une communauté internationale sceptique à l’égard de l’Algérie
Au niveau international, les organes de l’ONU mettent en doute le sérieux des rapports périodiques et spécifiques qu’ils reçoivent du gouvernement algérien. Le manque de confiance n’a jamais été aussi élevé.
C’est notamment le cas du Conseil des droits de l’homme des Nations unies. En mai 2018, la porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l’homme, Ravina Shamdasani a exhorté le gouvernement algérien à mettre un terme aux expulsions massives de migrants subsahariens et à honorer ses engagements internationaux en matière de promotion des droits de l’homme. Son sous-comité d’accréditation (SCA) a rejeté la demande du Conseil national des droits de l’homme (CNDH) de récupérer le statut perdu en 2010.
La Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement (CNUCED), dans son rapport mondial sur l’investissement direct étranger[3] a relevé que l’Algérie avait attiré seulement 1,2 milliard de dollars en 2017, ce qui indique une forte chute des flux d’investissements étrangers directs.
Sur le plan des droits humains, le pays a cette année encore été « mal classé » par Reporters sans frontières (RSF)[4]. Il pointe à la 136e place sur 180 pays et régions recensés, alors qu’un rapport judiciaire français a ravivé la polémique sur les circonstances de la mort des sept moines de Tibhirine en 1996, dont le dossier est toujours ouvert. Par ailleurs, un rapport du département d’État américain[5] a estimé que le pays comptait cent soixante détenus politiques dans ses prisons, ce que le pouvoir central nie catégoriquement. Enfin, un rapport de la police française sur les visas a conduit à imposer de nouvelles restrictions sur les migrations légales et/ou économiques.
Les rapporteurs spéciaux des Nations unies sur la torture et les exécutions extrajudiciaires, ainsi que les membres du groupe de travail sur les disparitions forcées sont toujours interdits de visite en Algérie.
Le CNDH ne fléchit pas et cautionne le refus officiel de créer des chaines de télévisions reconnues comme médias algériens, considérant que cette interdiction ne constitue pas une violation aux droits humains fondamentaux.
Dans son rapport annuel de 2018, la timide Ligue algérienne pour la défense des droits de l’homme (LADDH) recense de sérieuses violations des droits humains, regroupées en quatre volets : libertés publiques, politique et juridique, économique et social, et migration et droit d’asile. De manière générale, elle déplore un « recul » des droits de l’homme et dresse un sombre tableau de la situation.
Conclusion
À la veille des élections présidentielles de 2019, force est de constater que rien n’a changé dans la pratique du politique depuis le troisième mandat de l’actuel chef de l’État Abdelaziz Bouteflika. Les partis politiques sont la principale victime de cette impasse politique. Leur incapacité à proposer une vision alternative porteuse de projets politiques concrets tient à deux choses : l’incapacité sinon le refus de régénérer leur leadership et un clientélisme endémique trop accommodant, qui les laisse sans ancrage citoyen. Cette configuration impacte négativement l’imaginaire populaire, ce qui se traduit par une méfiance chronique à l’égard de toute formation partisane.
Les citoyens n’arrivent pas à forger une identité mobilisatrice qui donne sens à une action politique. Le clivage social (« islamiste » versus « laïciste ») est si fort qu’aucun ne se contente de s’opposer à l’autre, mais souhaite l’écarter complétement de la scène politique. La dynamique d’exclusion reste donc la marque d’un clivage social à vocation éradicatrice. Cette polarisation de la société civile entre deux camps est aussi accentuée par une élite politique qui aggrave les « laïcités ». Au contraire, il accentue cette fracture. Seule la chaîne de télévision Al-Magharibia (émettant depuis Londres et Paris) est parvenue à faire office de plateforme de rencontre et discussion politique. L’initiative est bonne, certes, mais les débats s’apparentent à une naïve partie de poker menteur.
L’armée envoie quant à elle des signaux contradictoires. Elle rythme la vie politique dans tous ses aspects, en s’imposant comme la colonne vertébrale du pouvoir et en réduisant le paysage politique (partisan ou civil) à des permutations horizontales molles, alors que les luttes intestines internes la menacent.
Sur le plan économique, la situation du pays inquiète car il a du mal à diversifier ses ressources, continuant de tirer profit de la rente malgré la baisse du prix du carburant. Compte tenu de l’opacité qui le caractérise[6] (voir l’affaire Eni/Sonatrach[7]), il est difficile de suivre les prestations et les rendements de ce secteur où règnent l’informalité et l’arbitraire bureaucratique. Sur le plan financier, la monnaie non convertible est sans cesse dévaluée. Le recours à la « planche à billets » engendre une inflation qui accentue cette dévaluation, ainsi qu’une baisse du pouvoir d’achat. Les sociétés des deux hommes d’affaires les plus influents du pays, Ali Haddad (président du Forum des chefs d’entreprises, FCE) et Issad Rebrab (PDG de Cevital, premier groupe privé) ne font pas partie du circuit économique algérien et ne figurent même pas dans les sociétés côtés à la Bourse d’Alger. Cette dernière est d’ailleurs l’une des plus petites places boursières au niveau mondial, avec une capitalisation de 133 millions d’euros.
Sur le plan des relations internationales, la Russie reste un allié indéfectible. Si les États-Unis observent de loin, la France semble agacée par la posture adoptée par ce régime qui semble en fin de vie. En témoigne le refus du président Emmanuel Macron d’effectuer une visite officielle à Alger, puis la sortie médiatique de l’ancien ambassadeur français en Algérie et ancien directeur de la DGSE Bernard Bajolet, qui a affirmé que le président Bouteflika était « maintenu en vie artificiellement[8] ». Ces propos tranchent avec ceux de l’ancien président François Hollande qui avait affirmé en juin 2015 qu’il était « rare de rencontrer un chef d’État qui a cette alacrité ». Le peu de crédit accordé à l’Algérie par les instances onusiennes révèle son isolement sur la scène internationale.
Dans une telle configuration politique, les issues possibles de ce scrutin peuvent être classées dans deux catégories.
Dans la première catégorie, c’est le pouvoir central qui a l’ascendant. À ce niveau, la reconduction d’Abdelaziz Bouteflika à la tête du pays peut être envisagée. Compte tenu de son état de santé, et de l’absence de consensus sur un successeur au sein du régime, un poste de vice-président sera peut-être créé pour lui suppléer et anticiper une possible vacation du pouvoir. Ce dernier ne sera pas élu mais désigné par consensus, ce qui permettra une éventuelle succession familiale. Cette option nécessitera bien entendu des garanties, telles que le maintien du régime et de ses privilèges, que seul le général Gaïd Salah détiendrait. Elle obéira par ailleurs aux critères de fidélité et de loyauté à la région ouest d’où sont originaires de nombreux fonctionnaires d’État.
La seconde issue possible est l’élection du général-major Ali Ghediri. On pourra y voir alors une vengeance du clan de la DRS sur le clan de l’état-major –de Gaied Salah et Bouteflika- et la configuration du pouvoir s’en verra largement modifiée.
Enfin, troisième scénario possible : suivant la proposition de Makri : un gouvernement d’union nationale est formé afin de gérer une période de transition. Il est envisageable si les différents clans militaires décident d’adopter une solution commune et pacifiée.
Dans la deuxième catégorie, ce sont les citoyens qui auront l’ascendant. Partant du principe que la réaction des citoyens est imprévisible, une réaction populaire pourrait balayer les calculs du pouvoir central d’un revers de main. Souvent, les revendications de la rue ne sont pas complexes. Dans le cas algérien, et compte tenu de la nature de l’exercice de la politique, les revendications se résumeront à l’arrêt et l’annulation du scrutin. Des revendications qui peuvent évoluer pour demander le départ du régime.
On l’aura compris, l’articulation entre le politique et le militaire au sein de l’État algérien reste le problème majeur. Localement, la situation semble surnaturelle pour une jeunesse qui sombre dans le nihilisme. Un sentiment qui peut la plonger dans le désarroi, ou qui pourrait l’inciter à revendiquer ses droits.
Notes :
[1] CAMELLO Maria. « Exportations d’armes au Maghreb : quelle conformité avec la Position commune ? », Note d’analyse du GRIP, Bruxelles,17 septembre 2018, p. 5.
[2] Sipri Yearbook 2018, Armaments, Disarmament and International Security: https://www.sipri.org/yearbook/2018
[3] CNUCED, « World Investment Report 2018. Investment and New Industrial Policies », 2018 : https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=2130
[4] Classement 2018 : https://rsf.org/fr/donnees-classement
[5] Le Quotidien d’Oran, n° 5, mars 2017.
[6] El Watan, N° 24, septembre 2018.
[7] El Watan, N° 20, septembre 2018.
[8] Jean Chichizola, « Bernard Bajolet : “Daech est en train de se réorganiser et reste dangereux” », Le Figaro, 20 septembre 2018.