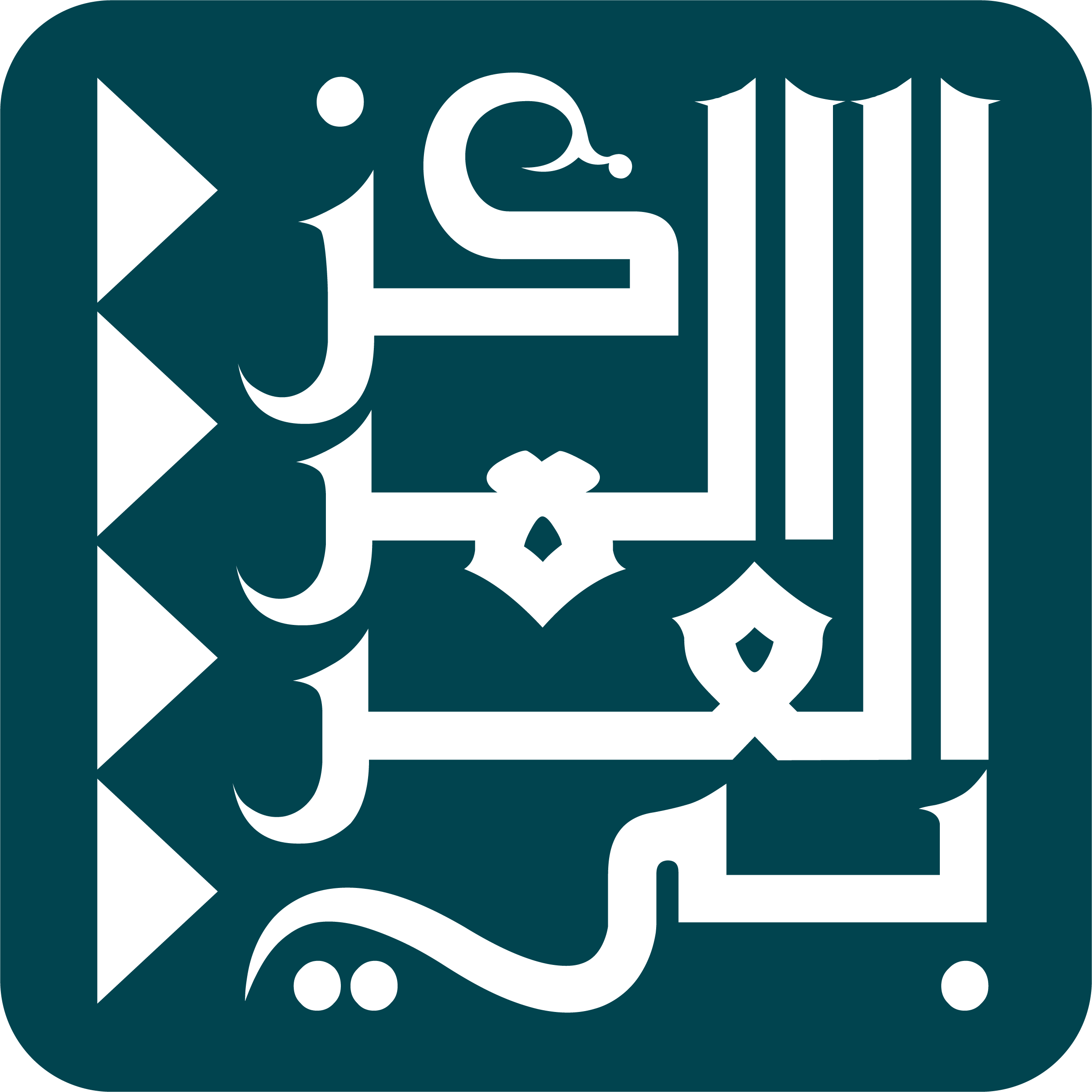Ce papier fait partie du dossier : « Les transformations de l État dans le monde arabe », coordonné par la chercheuse Asma Nouira. Une conférence sur le sujet s’est tenue au CAREP Paris, le 30 mai 2024 : Revoir la conférence.
Bien que le sens commun semble donner une signification précise et sans équivoque au concept de crise, comme étant un moment de rupture, par rapport à l’ordinaire des phénomènes, il n’en demeure pas moins que ce dernier reste, sur le plan scientifique, indéfiniment l’objet d’interrogations, de remises en cause, de nouvelles significations, à telle enseigne qu’il est devenu l’objet d’une science critique qu’Edgar Morin, appelle la « crisologie[1] ». Plusieurs difficultés apparaissent ou font obstacle à l’utilisation rigoureuse du concept de crise. Le premier, c’est que tout vivant, y compris les sociétés, se trouve en perpétuel état de crise. La fin des crises signifie la mort et l’inertie. La conservation et « l’entretien » du vivant physique, comme du vivant mental, consiste en une rectification, une redirection de ces états de crise, un équilibrage des antagonismes propres à toute organisation qu’Edgar Morin appelle « l’antagonisme organisationnel[2] ».
Telle est la fonction principale du politique : éviter la dislocation ou la désintégration, éviter que la désorganisation engloutisse le jeu des antagonismes organisationnels et finisse par agir seule, sans concurrence. La crise est une condition du vivant, à cause précisément de la complexité du vivant. Dans ces conditions, quelle peut être la validité du concept ? Comment pouvoir l’utiliser ? Certains auteurs n’ont pas hésité à affirmer que le concept de crise est inutilisable ou est devenu obsolète[3].
Si nous admettons, malgré tout, que la crise constitue un moment de rupture, un déséquilibre ou une déstabilisation, la deuxième difficulté majeure, consiste à définir l’intensité, à partir de laquelle nous sommes en droit de parler de crise. Autrement dit, si la crise est une rupture dans la continuité des phénomènes ou bien encore une rupture dans l’ordre du désordre, à partir de quel moment, à partir de quelle magnitude de rupture est-on en droit de parler de crise ? Nous nous heurtons ici à un problème sérieux, à la fois épistémologique et pratique dans le dossier du concept de crise. Il faut s’interroger sur l’impact et les effets d’une crise sur le fonctionnement d’une société. Certaines crises sont porteuses d’une édification nouvelle, d’une refondation. D’autres, au contraire, peuvent aggraver la situation de crise et précipiter la dislocation, c’est-à-dire, en fait, l’effondrement de l’État. On le voit dans des pays comme l’ancienne Yougoslavie, la Tchécoslovaquie, l’URSS, l’Allemagne de l’Est, la Libye, le Soudan, le Yémen.
Le moment révolutionnaire de 2011 en Tunisie, constitue-t-il une crise de l’État ? A-t-il été à l’origine d’une ou plusieurs nouvelles crises ? A-t-il réussi à réguler ses propres antagonismes ? Quelle est la nature de l’évènement survenu le 25 juillet 2021 ? Nous allons essayer de répondre à ces questions en examinant tout d’abord la crise fondatrice, c’est-à-dire le segment de temps 2011-2021, pour analyser par la suite la surexcitation de la crise de l’État avec le coup d’État du 25 juillet 2021 et la restauration de la dictature.

Yadh Ben Achour
Yadh Ben Achour est professeur de droit public, ancien membre et vice-président du Comité des droits de l’Homme des Nations unies et ancien doyen de la Faculté des sciences juridiques de Tunis. Après la Révolution, il est désigné président de La Haute Instance de réalisation des objectifs de la révolution.
Parmi ses derniers ouvrages : Aux fondements de l’orthodoxie sunnite (Ceres éd., 2009). La deuxième Fatiha (Ceres éd., 2011). Tunisie : une révolution en pays d’islam (Labor et Fides, 2018). L’Islam et la démocratie : une révolution intérieure (Gallimard 2021). La révolution, une espérance (Fayad, 2022). La question islamique devant le Comité des droits de l’homme des Nations unies (Pedone, 2022). L’Éthique des révolutions (Maison des sciences de l’homme, 2023).
Une refondation du politique accompagnée d’une crise permanente de l’État
L’évènement révolutionnaire de 2011 est en lui-même à la fois, une crise de l’État dictatorial, la source d’une refondation politique et l’origine de la nouvelle crise de l’État en juillet 2021.
La crise de l’État dictatorial
La révolution de 2011 a été principalement une révolution anti-dictatoriale, doublée d’une demande de justice sociale. Dignité, liberté, justice ont constitué les trois piliers du message de la révolution de 2011[4]. Cette dernière constitue une rupture majeure non seulement du régime instauré le 7 novembre 1987, mais également du régime qui l’a précédé, depuis l’indépendance, acquise le 20 mars 1956 et l’instauration de la République, le 25 juillet 1957. La crise de l’État dictatorial était une crise annoncée, notamment par la révolte du bassin minier en 2008. Lors du déclenchement de la révolution, le 17 décembre 2010, rien ne laissait présager que le régime était en fin de vie. Cependant, la désertification de la scène politique, la répression systématique de l’opposition, le harcèlement continu des organisations de la société civile et des défenseurs des droits de l’homme, la pratique systématique de la torture et de la corruption, le muselage de la presse et l’installation d’une frayeur générale sur la société politique avaient fini par user le régime et généraliser l’hostilité à son égard. Il a donc suffi qu’un évènement contingent survienne pour que l’ensemble du modèle explose, suite à ce qui a été interprété comme une fuite de Ben Ali et une démission du pouvoir. Face à l’effondrement de l’État dictatorial, les nouvelles instances issues de la révolution se sont vues contraintes d’improviser des solutions, notamment par la création de la Haute Instance de la révolution[5] et par l’organisation provisoire des pouvoirs publics[6]. Ce faisant, les responsables de l’époque voulaient éviter à la fois : le défi du vide constitutionnel, le défi de l’édification provisoire des pouvoirs publics (résolu par le décret-loi numéro 14 du 23 mars 2011), le défi de l’enlisement politique et constitutionnel (à cause de l’incertitude qui régnait alors aussi bien sur les compétences que sur le mandat de l’Assemblée nationale constituante), et enfin, le défi de la mise en œuvre des principes de la révolution, notamment les questions essentielles relatives à la justice sociale, à la nature du régime, aux libertés et droits de la personne, aux techniques juridiques relatives à la circulation de l’autorité et au rapport entre les grands organes de l’État et enfin à l’État dans son rapport avec la religion, autrement dit la question de « l’état civil[7] ».
La refondation du politique et ses antagonismes
Comme l’écrit Éric Gobe, « Depuis le 14 janvier, le champ politique s’est libéralisé et a été bouleversé[8] ». La refondation du politique est apparue dès les premiers jours de la révolution avec l’occupation de la Place du gouvernement (Casbah 1 et surtout Casbah 2)[9], le front du 14 janvier[10] et l’institution, le 12 février 2011, du Conseil national de protection de la révolution[11], puis avec la mise sur pied de la Haute instance de réalisation des objectifs de la révolution, en février 2011 et de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) qui fut présidée par Kamal Jendoubi. L’instauration d’une Assemblée nationale constituante et l’élaboration d’une nouvelle constitution ont été lancées comme vecteurs principaux de cette refondation. Tout se réalise au nom du peuple et du slogan « Le peuple veut ». Mais ce slogan est devenu un partage entre des tendances politiques contradictoires. Qui est ce peuple qui veut ? Telle est la question fondamentale qui ouvrait la voie à l’ambiguïté. Ce slogan contenait déjà, en lui-même, les germes du populisme qui apparaîtra par la suite.
L’activité de la Haute Instance s’est focalisée sur deux questions : préparer le système électoral sur la base duquel seront élus les membres de l’Assemblée nationale constituante ; libéraliser les grandes lois qui encadraient la vie politique, c’est-à-dire l’organisation des partis politiques et des associations, le régime des médias et de la presse écrite, ce qui fut réalisé avec le vote au sein de la Haute Instance des projets qui deviendront les six grands décrets-lois libérateurs de la révolution[12].
Ce moment de l’édification allait cependant se heurter à un certain nombre d’antagonismes qui expliquent l’échec relatif de l’expérience de l’Assemblée nationale constituante et du gouvernement de la Troïka (Alliance des trois partis majoritaires à l’ANC : Ennahdha, Congrès pour la République, CPR, et Forum démocratique pour le travail et les libertés Takattul).
Les principaux antagonismes sont les suivants :
Le premier opère entre les forces de l’ancien régime maintenues actives au sein du gouvernement, de l’administration, ainsi que de la société politique[13], et même à l’intérieur de l’Assemblée constituante[14], et les forces nouvelles issues de la révolution qui se manifestent par les partis et organisations d’opposition à la dictature de Ben Ali et l’émergence de dizaines de partis politiques nouveaux.
Le deuxième se révèle au sein même des forces nouvelles issues de la révolution ou qui prétendent s’en prévaloir. Il s’agit de l’opposition entre les tendances islamistes, comme Ennahdha qui a remporté la majorité aux élections du 23 octobre 2011 (86 sièges sur 217 à l’ANC), la Pétition populaire pour la liberté, la justice et le développement (26 sièges sur 217 à l’ANC) et les forces de gauche, laïques ou anciennement marxistes.
Le troisième, qui découle des deux premiers, est relatif à la légitimité de l’Assemblée nationale constituante elle-même. En effet, la révolution étant, dans une certaine mesure, une révolution inachevée, la légitimité de l’Assemblée nationale constituante est restée sous le poids de l’incertitude et de la contestation. Par ailleurs, le spectacle des débats constitutionnels souvent excessivement animés avait de quoi déplaire à un peuple habitué au calme souverain des parlements soumis à l’exécutif sous les régimes de Bourguiba et de Ben Ali. Une bonne partie de l’opinion souhaitait un retour de l’autoritarisme. Pour résoudre le choc frontal et dangereux de ces antagonismes, il a donc fallu avoir recours à des moyens coopératifs et consensuels, comme le compromis, Tawâfuq, largement préféré par l’ancien président Béji Caïd Essebssi ou la technique du Dialogue national[15].
Les crises politiques graves vécues par le pays, suite aux assassinats de Chokri Belaïd, le 6 février 2013, et Mohamed Brahmi, le 25 juillet 2013, radicalisèrent dangereusement les tensions. Cette crise déstabilisa les institutions de l’État. Devant l’ampleur de la crise de légitimité des partis composant la troïka et de l’Assemblée, du gouvernement et du président de la République, tous tenus pour directement responsables du climat de violence et des assassinats, l’UGTT adopta, le 29 juillet 2013 une déclaration fortement critique dans laquelle elle demanda la démission du gouvernement et la constitution d’un gouvernement « de compétences », kafâ’ât, la dissolution des islamisantes « Ligues de protection de la révolution », la neutralisation de l’administration, des institutions éducatives, universitaires et culturelles et les lieux de culte, la révision de l’ensemble des nominations, la constitution d’une commission d’enquête sur les assassinats et la violence, l’adoption d’une loi sur la lutte contre le terrorisme, la constitution d’un comité d’experts pour revoir, dans les 15 jours, la dernière version de la Constitution, en vue de l’épurer des dispositions qui portent atteinte au caractère civil de l’État et au caractère républicain et démocratique du régime, la préparation du projet de loi électorale. Cette déclaration constitue un témoignage essentiel de la gravité de la crise qu’a vécue la Tunisie au cours de l’été 2013. En septembre 2013, fut relancé le Congrès national pour le dialogue. Ce dernier fut placé sous l’égide du quartet composé de l’UGTT, de la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’Homme, de l’Ordre national des avocats et de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat. Le 17 septembre 2013, le quartet rendit publique son initiative. Il y insista sur « la méthode du processus consensuel » en vue de préparer des élections et proposa une feuille de route qui deviendra le programme de sortie de crise. Ce processus de sortie de crise déboucha sur l’adoption de la Constitution du 27 janvier 2014.
En fin de compte, le recours aux procédures informelles est la caractéristique essentielle de l’après-révolution. Dans cette situation, la force de la légalité et des procédures juridiques persiste. Mais les procédures informelles, de débats, de tractation et de négociations sont mieux à même de résoudre les crises. Ces processus informels ont réussi non seulement à apaiser les tensions, mais au surplus, à débloquer et accélérer le processus constituant, permettre l’alternance au pouvoir et relever le défi démocratique.
La Constitution de janvier 2014 et les nouvelles crises de l’État
La Constitution de 2014 constitue l’expression de cette refondation du politique. Elle va mettre sur pied, un système représentatif parlementaire et démocratique qui finira par s’éteindre en 2021, victime de ses propres contradictions. L’expression la plus forte de ces contradictions se trouve dans la Constitution elle-même, notamment dans le fameux article 6 qui pose le principe de la neutralité de l’État en matière religieuse et son contraire. En rédigeant la Constitution, nos constituants n’ont pas assez tenu compte des réalités aussi bien sociales que politiques de notre pays. La constituante a mis sur pied un régime hybride et complexe qui se rapproche du régime d’assemblée, entre tous, le plus dangereux. La constituante a ignoré, par exemple, le manque d’expérience et de tradition parlementaire de nos partis politiques, la mentalité prédatrice d’une partie de la plupart des représentants à tous les niveaux, les faibles capacités financières de l’État, la déstabilisation de ce dernier après la Révolution. Ce qu’il faut reconnaître, c’est que ni le peuple, ni la classe dirigeante, n’étaient préparés à vivre l’expérience démocratique. Chacun essayait, à travers cette expérience, de tirer le maximum de bénéfices pour son propre compte. Les résultats sont connus[16] :
- Des coalitions parlementaires instables et fluctuantes.
- Une incapacité du Parlement à exercer normalement sa fonction législative et une tendance désastreuse à se donner en spectacle d’une arène de députés bavards, violents et inutiles.
- Des abus de pouvoir caractérisés du côté de la présidence du Parlement, incapable de sortir de son cercle idéologique et partisan.
- Un hiatus entre le gouvernement et le Parlement, une majorité de soutien au gouvernement n’existant pratiquement jamais.
- Une instabilité gouvernementale chronique (Gouvernement Jomaa, (1 an) ; Habib Essid (1 an et demi), Fakhfakh, moins de six mois) et des délais anormaux pour leur formation. Un dangereux dualisme de l’exécutif entraînant souvent des conflits entre le président de la République et le chef du gouvernement, comme on l’a observé durant la présidence du président Caïd Essebssi et les gouvernements Essid, mais surtout Chahed.
- Et comme conséquence de ce qui précède, une présidentialisation insidieuse du régime constitutionnel, les gouvernements Essid (qui n’appartenait à aucun parti représenté au Parlement), Chahed (qui a été appelé à former le gouvernement par le président), Fakhfakh (dont le parti n’a obtenu aucun siège à l’ARP), de même que les chefs de gouvernement proposés après élections législatives (Jomli) ou démission du chef du gouvernement précédent (Méchichi) étant peu ou prou des créations présidentielles. Dans ce dernier cas, nous revenons en fait à la vieille pratique présidentialiste qui ne correspond nullement à l’esprit de la Constitution. Certains auteurs ont appelé cela une démocrature[17].
- Cette présidentialisation ne peut cependant aller jusqu’au bout de sa course et reste évidemment bloquée par l’omnipotence parlementaire, elle-même paralysée par le chaos parlementaire. Nous nous trouvons donc dans un cercle vicieux constitutionnel.
À cela, il faut ajouter la gestion calamiteuse de l’État, de la part du parti majoritaire. Ce dernier s’est comporté en parti prédateur, délaissant son rôle de représentant de l’ensemble du peuple et en tant que responsable du fonctionnement de l’État. C’est ainsi que nous avons assisté au développement du terrorisme à l’intérieur du pays et son exportation vers l’extérieur, que des mesures financières grevant le budget de l’État ont été prises au profit de ses partisans, comme dans la fonction publique, que des actes d’infiltration partisane des rouages de l’État, comme la justice, la police et l’administration civile ont été relevées. La corruption s’est développée au sein des rouages de l’État, notamment l’Assemblée des représentants du peuple, en même temps qu’elle se démocratisait et se diffusait dans le corps social lui-même. La ligne du tolérable avait été dépassée.
Les élections de 2014 et de 2019, ont nettement révélé que le parti majoritaire perdait de plus en plus sa popularité (69 sièges en 2014, 52 sièges en 2019). Le vote du 15 septembre 2019 qui a porté Kaïs Saïed à la présidence est un vote sanction, contre un système, celui qui a assumé (mais subi également) le mauvais fonctionnement de l’État avec toutes ses conséquences constitutionnelles (notamment l’incapacité d’élire la Cour constitutionnelle), économiques, sécuritaires, électorales, notamment le projet d’amendement à la loi électorale adopté par l’A.R.P. le 18 juin 2019[18] ; celui qui est responsable du clivage moral, social, économique et religieux de la société ; celui qui est responsable de la fuite des élites ; celui qui a aggravé une vie à deux vitesses des services publics de santé et d’éducation ; celui qui a vu le renchérissement bouleversant du coût de la vie, du mal vivre.
Tout cela explique l’élection de Kaïs Saïed, à la présidence de la République et le nouveau cycle de crises qui allait suivre. Kaïs Saïed a pu ainsi mobiliser à son profit toutes les colères contre le parti Ennahdha et plus largement contre le système des partis et du régime représentatif. Il a fait de cette hostilité le moteur central de son action politique.
La restauration de la dictature et l’aggravation de la crise de l’État
Les signes annonciateurs de la dictature
Dès son arrivée au pouvoir, Kaïs Saïed s’est engagé dans une politique de violations systématiques de la Constitution dont il a juré, par serment, de respecter les dispositions. Autrement dit, le coup d’État du 25 juillet 2021, se situait dans une stratégie programmée. Les différentes violations de la Constitution n’ayant pas provoqué d’hostilité massive, le chemin était ainsi tracé pour la continuation de cette politique. Ces violations touchent aussi bien l’esprit que la lettre de la Constitution. Ainsi, violant, l’esprit du régime parlementaire, le président s’est reconnu le droit de désigner des ministres n’ayant pas de soutien parlementaire, comme ce fut le cas, des chefs du gouvernement Fakhfakh et Méchichi[19]. Kaïs Saïed a prétendu être l’interprète exclusif de la Constitution. Ces positions qui ont été prises à la suite des élections de 2019 relèvent de la même intention de personnaliser le régime constitutionnel. S’agissant des violations de la lettre de la Constitution, il convient de rappeler le refus du président de la République de recevoir le serment constitutionnel de ministres ayant obtenu la confiance de l’Assemblée, au motif non démontré qu’ils étaient corrompus, ou encore le refus de promulguer les lois votées par l’Assemblée, aggravant ainsi la crise, née de l’absence de la Cour constitutionnelle, prévue par la Constitution. K. Saïed, lui-même, en novembre 2018, avait affirmé que la prestation de serment était obligatoire pour le président qui était alors Béji Caïd Essebsi. Le 25 avril 2021, le président de la République refuse de promulguer la loi relative à la Cour constitutionnelle qui venait d’être adoptée par l’Assemblée des représentants du peuple. Saïed est donc au premier rang de ceux qui ont empêché la création de la Cour constitutionnelle. Il en a évidemment profité par la suite.
L’assassinat de la Constitution de 2014 et le recours à l’article 80
Le recours à l’article 80 de la Constitution de 2014 qui a servi à enterrer cette dernière et a ouvert la voie à la nouvelle dictature avait été programmé. C’est ainsi qu’une mystérieuse lettre datée du 13 mai 2021 et provenant de la présidence de la République a fuité sur les réseaux sociaux, mettant la présidence dans un insurmontable embarras. À l’époque, j’avais commenté avec une journaliste la diffusion de cette lettre. Par conséquent, mon opinion avait été fixée avant même le recours effectif à l’article 80 de la Constitution, le 25 juillet 2021. J’avais dit en substance : « Pour pouvoir juger cette affaire, il faut d’abord établir avec certitude la matérialité des faits. Ce qui m’inquiète, c’est que cette matérialité n’a pas été niée par la présidence. Quelque chose se tramait donc. Par ailleurs, il est important de savoir qui l’a rédigée, quel est son destinataire final, qui l’a fuitée, pourquoi, dans quel but ? Cela fait-il partie d’un plan d’ensemble ? Tout ce que je peux vous dire pour l’instant, c’est que ce soi-disant recours à l’article 80 de la Constitution est un détournement absolu de l’article 80. Aucune condition de fond prévue par l’article 80 n’existe actuellement… Par ailleurs, ces mesures doivent avoir pour objectif « le retour au fonctionnement régulier des pouvoirs publics » et non pas leur suspension. En un mot, et sans entrer dans le détail de l’analyse juridique, l’article 80 doit servir à sauver l’État et non pas à le détruire[20] ». Ma position ne changea pas par la suite. Dès le lendemain du 25 juillet, alors que les gens apparaissaient en liesse, j’avais expressément affirmé, le matin du 26 à Radio Shems FM[21], qu’il s’agissait d’un « coup d’État contre la Constitution ». Le président a réagi à cette déclaration en disant que certaines personnes qui se prenaient pour des juristes avaient atteint l’âge de la sénilité et qu’il était difficile de les guérir de leur mal. Les réseaux sociaux alliés du nouveau régime ont explosé leur fiel.
La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples a condamné le recours à l’article 80. En ces termes : « La Cour en conclut que l’État défendeur aurait dû envisager d’autres mesures moins restrictives pour traiter ledit différend avant de prendre des mesures aussi drastiques que la suspension des pouvoirs du Parlement et la limitation de l’immunité de ses membres, qui ont été librement élus par les citoyens dans l’exercice de leur droit de participer à la direction des affaires publiques de leur pays. Le fait que l’État défendeur n’ait pas agi de la sorte a rendu les mesures adoptées non seulement disproportionnées par rapport à leurs objectifs déclarés, mais aussi par rapport aux lois de l’État défendeur lui-même[22] ». L’utilisation de l’article 80 était l’expression même de la dictature puisque le président devenait l’autorité exclusive de l’État, sans concurrence, concentrant entre ses mains, l’autorité législative et même l’autorité judiciaire. Cela dépassait l’imagination. À partir de là, il était condamné à jouer la surenchère permanente, notamment avec l’adoption de ce décret scélérat 117 du 22 septembre 2021, qui n’a fait qu’accentuer la crise de l’État et sa marche vers la dictature.
Le décret 117 du 22 septembre 2021 et l’installation définitive de la dictature
Retour au peuple, pour justifier l’injustifiable : démarche classique du populisme de bas étage. Dans le préambule du décret 117 nous lisons : « Si le peuple n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté et d’exercer sa souveraineté en vertu des dispositions constitutionnelles en vigueur, la souveraineté prévaut sur les procédures relatives à son exercice ». Revenir au peuple, pour détruire la constitution : tel est la logique de ce décret qui n’a pas d’équivalent dans l’histoire du droit constitutionnel. Même Hitler, pour s’arroger les pleins pouvoirs, en particulier le droit de légiférer par décret, a eu recours à une loi votée par le Reichstag, celle du 24 mars 1933[23]. Dans le cas tunisien, il s’agit d’un simple décret. Seuls trois juristes ont participé à l’élaboration de ce décret scélérat et l’ont soutenu. Il faut signaler parmi les monstruosités de ce décret, tout d’abord son article 20 qui le place tout simplement au-dessus de la Constitution[24] et ensuite son article 22 qui lui accorde l’initiative des révisions constitutionnelles, ce qui veut dire qu’il l’institue en véritable pouvoir constituant[25].
Ce décret confie l’entièreté du pouvoir exécutif au chef de l’État. Le bicéphalisme de l’exécutif introduit par la Constitution de 2014 disparaît. Le chef du gouvernement devient un simple figurant sur la scène constitutionnelle, dépendant entièrement du président de la République, qui peut, à tout moment, présider le Conseil des ministres.
En réalité, le décret procède à une dissolution de l’Assemblée, puisqu’il confirme la suspension des compétences de l’ARP, la levée de l’immunité de ses membres et l’arrêt des primes et avantages qui leur sont accordés. Le pouvoir de légiférer par décrets-lois est accordé au chef de l’État, après délibération du Conseil des ministres.
L’article 4 § 2 du décret limite le pouvoir législatif du chef de l’État, puisque les décrets-lois en question ne peuvent porter atteinte « aux acquis en matière de droits de l’Homme et de libertés garantis par la Constitution ». Mais les décrets-lois ne peuvent faire l’objet ni d’un contrôle de légalité devant le Tribunal administratif, ni d’un contrôle de constitutionnalité devant la Cour constitutionnelle qui ne verra d’ailleurs jamais le jour. La Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples a jugé, le 22 septembre 2022, que le décret 117 violait aussi bien le droit interne tunisien que le droit international[26]. Aucune suite n’a été donnée à l’arrêt de la Cour. En Tunisie, le droit n’a plus de sens. L’État de droit a totalement disparu. Nous vivons sous le régime du coup d’État permanent, fermement adossé à une distinction totalement erronée entre la légalité et la légitimité, distinction apparue au lendemain même de la révolution de 2011[27].
Le démantèlement des institutions et des autres formes de légitimité
C’est cette distinction qui a permis le démantèlement des institutions et des légitimités issues de la Constitution de 2014 qui est la véritable Constitution de la révolution. Comme nous l’avons remarqué, cette distinction s’est manifestée dans la rédaction du décret 117. Il y est affirmé que lorsque la légalité devient un obstacle à l’expression de la volonté populaire, cette dernière doit prévaloir. Le grand oubli, dans cette illusoire distinction, c’est que personne ne s’est interrogé sur l’espace dans lequel se loge cette volonté, parce que cet espace est tout simplement introuvable. On pourrait le présumer par l’intermédiaire d’élections ou de référendum. Mais poser le principe de la distinction d’une manière abstraite et générale revient à donner le pouvoir aux manipulateurs de cette volonté. Autrement dit, le résultat final, c’est que celui qui détient le pouvoir et le monopole de la parole officielle s’octroie le droit de parler, au nom de cette volonté, de l’interpréter et de la mettre en exécution. Ainsi, le droit constitutionnel est mis au service de « l’homme-peuple », selon l’expression de Sana Ben Achour[28]. Comme l’écrit Michel Camau : « Kaïs Saïed entend libérer l’expression de la puissance du peuple, alors qu’il incarne le pouvoir d’un seul[29] ». C’est ainsi que la volonté personnelle se substitue immanquablement à la volonté générale, grâce à cette distinction fascisante. La consécration de la volonté personnelle constitue l’effet inévitable de cette distinction. Or, ces deux concepts de légalité et de légitimité font partie d’un même tout et le régime démocratique ne peut les dissocier. La légitimité et la légalité constituent les deux piliers sur lesquels il repose.
Par ailleurs, l’État démocratique n’est pas seulement construit sur le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, mais également sur l’autonomie de certaines institutions de contrôle nécessaires pour le maintien du régime démocratique. Or, la dictature ne supporte pas l’indépendance des institutions. Elle conçoit l’État comme un corps unique sous l’autorité d’un chef unique. Pour le nouveau régime, mis en place par le coup d’État du 21 juillet 2021 et le décret du 22 septembre, il fallait procéder au démantèlement des institutions dangereuses pour la dictature. Ce démantèlement concerne essentiellement l’organe provisoire chargé du contrôle de la constitutionnalité des lois qui a été dissous, l’Instance indépendante pour les élections également, remplacée par une instance électorale nouvelle et le Conseil supérieur de la magistrature. Dans le même sillage, la dictature ne supporte pas l’indépendance des magistrats, en tant que tel. Par conséquent, par une série de mesures répressives, attentatoires à leur liberté et leur tranquillité, elle essaye de les mettre entièrement sous le joug du pouvoir exécutif, qui n’est plus évidemment le pouvoir exécutif, mais le pouvoir unique.
Nous ne pouvons entrer dans le détail de ces évènements. Nous rappellerons simplement le remplacement de l’Instance supérieure indépendante pour les élections, qui n’avait pas les faveurs du régime, par une nouvelle instance dépendante soumise à la volonté du pouvoir unique. Nous rappellerons également la révision des modes de désignation de la Cour constitutionnelle, qui n’a pas encore vu le jour ; la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature et son remplacement par un conseil supérieur provisoire dont le fonctionnement demeure bloqué ; le limogeage, en juin 2022, de 57 magistrats, pour cause de corruption, alors même que 47 d’entre eux ont été blanchis par le Tribunal administratif, sans résultats concrets de mise en application des décisions du tribunal. Ces limogeages ont provoqué une grève générale des magistrats qui a duré plusieurs mois. L’ensemble de ces atteintes a été souligné et dénoncé dans une motion publique de l’Association des magistrats tunisiens, datée du 16 avril 2024.
Comme le Conseil supérieur provisoire de la magistrature s’est trouvé bloqué à la suite d’affectations et de mise à la retraite, une pratique totalement illégale et inconstitutionnelle a vu le jour, consistant à procéder au mouvement des responsabilités fonctionnelles à l’intérieur des tribunaux par voie d’instructions administratives (mudhakkarât ‘amal), dont le nombre dépasse aujourd’hui 157[30]. Par ailleurs, les magistrats de l’opposition se trouvent harcelés dans leur mouvement et leur droit à la liberté de circulation. C’est ainsi que sont refusées les autorisations d’absence pour assister aux congrès internationaux, notamment au congrès des magistrats africains qui devait se tenir à Monrovia du 5 au 10 mai 2024. Une déclaration de l’Association des magistrats tunisiens a dénoncé cette pratique, qu’elle juge attentatoire au droit syndical des magistrats[31]. Les juges qui ordonnent les gardes à vue, les mandats de dépôt, le maintien en détention, malgré la déchéance des mandats de dépôt sont devenus des receveurs d’ordre. Les décisions sont prises à l’avance, en particulier par la ministre de la Justice, dont le nom restera gravé dans les annales de la régression de la justice tunisienne. Cette situation a été dénoncée dans le rapport conjoint du 6 mars 2024 par les Rapporteuses spéciales sur l’indépendance des juges et des avocats ; de la Rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression ; de la Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l’Homme et du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’Homme et des libertés[32].
L’État des libertés et droits de la personne
Cette tutelle sur le pouvoir judiciaire a permis au pouvoir unique de l’utiliser à son seul profit, dans un but politique, pour réprimer, harceler ou mettre hors d’état de nuire toute opposition qui constituerait un danger pour la survie du régime dictatorial. Le Code pénal et ses dispositions relatives à la sûreté de l’État, le décret-loi numéro 54 du 13 septembre 2022 et la loi sur le terrorisme constituent le socle sur lequel s’édifie un régime de répression systématique digne des grandes dictatures de l’histoire. Le décret-loi 54 du 22 septembre 2022 s’adosse à la Constitution de 2022 et au fameux décret 117 qui confère les pleins pouvoirs au président de la République. Mais il viole aussi bien l’une que l’autre. En effet, il est contraire à l’article 55 de la Constitution[33] et à l’article 4 du décret 117[34].
Au cours des dernières semaines de mai 2024, le décret-loi 54-2022, adopté en septembre 2022, visant à lutter contre la propagation de « fausses informations et rumeurs mensongères » a été appliqué contre des journalistes (Mourad Zghidi, Bourhan Bsaïs). Des avocats (Sonia Dahmani, Mehdi Zagrouba), des responsables associatifs (Saadia Mosbah) deviennent systématiquement la cible d’attaques armées ou de violences policières. Leurs locaux sont perquisitionnés et saccagés. Il en a été ainsi de la Maison des avocats. Les associations qui reçoivent des fonds de l’étranger et fournissent une aide aux migrants ou cherchent à les loger sont poursuivies et perquisitionnées en vertu de la loi sur la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent. La facilitation de l’accès de réfugiés au territoire tunisien est poursuivie. Deux responsables du Conseil tunisien pour les réfugiés ont ainsi été́ placés en détention préventive pour « association de malfaiteurs dans le but de faciliter l’accès de personnes au territoire tunisien[35] ».
Tout cela, évidemment, est mené sous le slogan : « La révolution se poursuit ». Elle se poursuit, comme Saïed l’a clairement affirmé, contre les traîtres, de tout acabit, quels que soient leurs domaines d’activité, qui ne sont pas d’accord avec le pouvoir en place ou qui ont des contacts avec des puissances étrangères ou même des organisations internationales. La rencontre, avec un ambassadeur ou un attaché d’ambassade devient un crime, alors même qu’aucune loi ne l’interdit. Le nationalisme populiste se déploie avec force à tous les niveaux.
Conclusion
Mais, malgré ce constant appelant à la légitimité populaire, cette légitimité ne se manifeste nullement sur le plan électoral. Tous les recours au soutien populaire, formalisés par des élections ou des consultations débouchent sur un constat : l’abstentionnisme et l’absentéisme. La légitimité dont il s’agit est une légitimité hypothétique, jamais démontrée. Observons les faits. Entre janvier et mars 2022, une consultation populaire électronique est organisée, à l’initiative du président, sur les questions politiques et sociales. Seulement 500 000 personnes (d’après les chiffres officiels) ont participé à cette consultation. Il s’agit d’un échec. En mai 2022, il crée une Commission nationale consultative pour la fondation de la Nouvelle République. Elle est chargée, en principe, de préparer un projet de Constitution qui serait soumis au référendum. Les deux comités de la Commission nationale (affaires économiques et sociales et affaires juridiques) sont contestés. Le Comité des affaires économiques réunit quelques rares représentants des partis ou organisations nationales. Le Comité juridique a été boycotté totalement par les doyens des facultés qui devaient y figurer, et cela à la demande de leurs collègues qui ont signé une pétition en ce sens. Cette commission consultative nationale a donc été un échec cuisant. Malgré cela, elle a poursuivi son travail, préparé une constitution et l’a soumise à Kaïs Saïed. Il n’en a cure. Il rédige lui-même un projet de constitution, d’une étonnante faiblesse technique, de goût et de rédaction, agrémentée de certaines contre-vérités historiques dans le préambule. Ce texte est publié au Journal officiel le 30 juin 2022, avec des erreurs si grossières qu’il a fallu le corriger ou carrément l’amender. Une deuxième version est alors publiée quelques jours plus tard, le 8 juillet, avec 46 modifications ! À ce stade, nous avons quitté toute rationalité, nous sommes dans le pathologique. Le projet est soumis au référendum le 22 juillet 2022. Moins de 30 % du corps électoral participe à ce référendum. C’est encore un échec. Mais le chiffre qui sera évidemment retenu par les autorités est celui des 94 % de « oui ». Le comble est atteint avec les élections législatives de 2023 pour l’Assemblée des représentants du peuple. À peine 11 % du corps électoral participent aux deux tours. Encore un échec !
Sans évoquer l’immensité de la crise sociale et économique, ainsi que l’exacerbation des conflits sociaux déclarés ou latents, suractivés par la politique présidentielle, qui sont hors de notre propos, la crise de l’État dont nous parlons est à la fois une crise du pouvoir, une crise dans l’État et une crise éthique.
Une crise dans l’État dans le sens où les institutions constitutionnelles officielles, après avoir été détruites, ont été remplacées par des institutions chétives et vides qui ne peuvent même pas remplir les maigres fonctions qui leur sont reconnues par la nouvelle Constitution, à cause de l’omnipotence de l’autorité présidentielle, politiquement située au-dessus des institutions, au-dessus du droit, au-dessus de la Constitution. Par ailleurs, cette crise est une crise du pouvoir, en ce sens que l’espace politique se trouve vidé de sa substance et désertifié. Toutes les organisations qui jouaient un rôle important dans la vie politique en Tunisie que ce soit le syndicat national U.G.T.T., les partis politiques, les associations ont été décapitées par la force de la répression, des représailles et de l’exclusion. Remarquons, à ce propos, qu’il est impossible de comprendre ce dérèglement pathologique du régime politique, sans analyser son incarnation, notamment, la « blessure narcissique[36] », l’illusionnisme, le messianisme[37], ou « la politique de la foi ou de la rédemption[38] » ou encore la Missionnary politics[39], le déni du réel, le complotisme, le « donquichottisme[40] ». Finalement, nous sommes revenus à une situation pire que celle qui prévalait sous la dictature de Ben Ali.
La crise éthique se manifeste par un décalage manifeste entre les principes affirmés dans les campagnes et les discours présidentiels et la réalité de l’action politique. Les principes sont connus de tous : l’édification démocratique par la base
(al binâ al qâ‘idi) ; la lutte contre la corruption ; la primauté de la loi et l’égalité de tous devant la loi ; le respect des libertés ; la pureté, l’honnêteté et la sincérité des intentions et des actes politiques.
Les faits concrets démentent totalement ces principes : nous sommes sous le règne de la manipulation de l’opinion ; le pouvoir exclusif, unique et personnel ; l’exploitation de la loi au service du seul pouvoir et de ses intérêts ; le maintien et l’aggravation de la corruption ; le mépris de la loi par les juges chargés de l’exécuter; la nature « flicardière » du régime, le mépris des libertés fondamentales, surtout dans le domaine de la protection contre les arrestations arbitraires ; le déni du réel. C’est cette crise éthique qui est en train de procéder aujourd’hui à un renversement de l’opinion.
Le paradoxe, c’est que malgré les échecs, malgré la perte de popularité révélée par les sondages, le régime semble tenir bon et devient même de plus en plus agressif. Malgré la manifestation des jeunes, le 24 mai 2024, hostile à Kaïs Saïed, qui révèle une vitalité certaine de la société civile en Tunisie, et malgré les défections de figures importantes de ses partisans, Saïed reste apparemment imperturbable. Mais l’embarras et l’incohérence de son discours du vendredi 24 mai et le limogeage ou la mise en réserve du ministre de l’Intérieur et la nomination d’un secrétaire d’État à la sûreté nationale révèle, en même temps que la fuite en avant, une panique certaine. Pour le régime, la descente aux enfers a commencé.
Pour les chercheurs qui ont fouillé l’histoire des révolutions, les crises post-révolutionnaires constituent un élément permanent de toutes les révolutions. Ces dernières, sur l’échelle du temps court, sont suivies par des périodes de rebondissements et de régressions. L’accouchement des révolutions ne se fait jamais sans douleur.
Notes :
[1] Edgar Morin, « Pour une crisologie », In « La notion de crise », Communications, n° 25, 1976. pp. 149–163.
[2] Edgar Morin, op. cit., p. 151.
[3] Natacha Ordioni, « Le concept de crise : un paradigme explicatif obsolète ? Une approche sexospécifique », In Mondes en développement, 2011, 154, pp. 137-150.
[4] Yadh Ben Achour, Tunisie, une révolution, un pays d’islam, Tunis, CERES Éditions, 2016, 2e édition, 2017, et Yadh Ben Achour, Tunisie, une révolution, un pays d’islam, Genève, Labor et Fides, 2018.
[5] Plus exactement, La Haute instance de réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique.
[6] Par le décret-loi numéro 14 du 27 mars 2011.
[7] Sur cette question, voir le colloque organisé par le groupe de recherche sur les systèmes juridiques dans le monde, Juriglobe, dirigé par le professeur, Jabeur Fathally, Faculté de droit civil, université d’Ottawa, « 10 ans de changement politique en Tunisie : défis constitutionnels et promotion des droits de la personne », mercredi 31 mars 2021, et ma communication : « Tunisie : les défis constitutionnels d’une révolution en pays d’islam ».
[8] Éric Gobe, « Tunisie an I : les chantiers de la transition », In L’Année du Maghreb, Dossier : « un printemps arabe », VIII, 2012, URL : http://journals.openedition.org/anneemaghreb/1549 ; DOI: https://doi.org/10.4000/anneemaghreb.1549, paragraphe 22.
[9] Rassemblement populaire sur la place de la Casbah qui aboutira à la démission du gouvernement de Mohamed Ghanouchi, le 27 février 2011.
[10] Réunissant la Ligue de la gauche travailliste, le Mouvement des Unionistes Nassériens, le Mouvement des nationalistes démocrates (Al-Watad), le Courant baasiste, la Gauche indépendante, le PCOT (Parti communiste des ouvriers de Tunisie), le PTPD (Parti du Travail patriotique et démocratique).
[11] Voir sur Casbah 2, Éric Gobe, « Tunisie an I : les chantiers de la transition », In L’Année du Maghreb, Dossier : « un printemps arabe », VIII, 2012, pp. 433-454, URL : http://journals.openedition.org/anneemaghreb/1549 ; DOI : https://doi.org/10.4000/anneemaghreb.1549.
[12] Les décrets-lois numéro 27 du 18 avril 2011, instituant l’Instance supérieure indépendante électorale, I.S.I.E ; numéro 35 du 10 mai 2011, organisant les élections de l’Assemblée nationale constituante ; numéro 87 du 24 septembre 2011, réglementant le régime juridique des partis politiques ; le décret-loi 88 du 24 septembre 2011sur le régime juridique des associations ; les décrets-lois numéro 115 et 116 du 2 novembre 2011, organisant la liberté de la presse et des médias.
[13] Par la création de multiples partis politiques, regroupant d’anciens membres du RCD, malgré la dissolution du RCD, la confiscation de ses biens et son exclusion de la compétition électorale d’octobre 2011.
[14] Par l’intermédiaire de groupes parlementaires, comme la Pétition populaire, dont certains membres ont été des partisans de l’ancien régime, en particulier le président du parti Hachmi Hamdi.
[15] Pratiqué en Tunisie sur l’initiative de l’UGTT, suite à l’assassinat du député à l’ANC Mohamed Brahmi pour résoudre la crise politique qui s’en est suivie.
[16] Les paragraphes qui suivent sont repris de Yadh Ben Achour, « La révision constitutionnelle entre utopie et réalisme », Leaders, septembre 2020, n° 112, p. 14 et p. 15.
[17] Anne-Clémentine Larroque, « Les printemps arabes : un espoir pour la démocrature ? », Pouvoirs, n° 169, 2019/2, éditions Le Seuil, pp. 85 à 96.
[18] Il s’agit du seuil de représentativité électorale de 3 % et des conditions plus restrictives de candidature à l’ARP, Voir Éric Gobe, « Tunisie 2019 : chronique d’une surprise électorale annoncée », L’Année du Maghreb, 23, 2020, pp. 327-353. Mis en ligne le 10 décembre 2020, consulté le 5 mai 2024. URL : http://journals.openedition.org/anneemaghreb/6811; DOI : https://doi.org/10.4000/anneemaghreb.6811.
[19] Le paragraphe 3 de l’article 89 de la Constitution précise que dans l’hypothèse où le gouvernement n’est pas formé dans le délai maximum de deux mois après la proclamation des résultats définitifs des élections, « le président de la République engage des consultations avec les partis, les coalitions et les groupes parlementaires, en vue de charger la personnalité la mieux à même d’y parvenir de former un gouvernement… » Indépendamment de la procédure écrite de consultation initiée par le président, exagérément formaliste (alors qu’il aurait fallu plutôt recourir à une consultation par concertation orale avec les groupes parlementaires), ce dernier s’est reconnu le droit de ne pas tenir compte des avis et propositions qui lui ont été présentés et de nommer des chefs de gouvernement de son choix.
[20] Yadh Ben Achour, entretien avec Hela Lahbib, La Presse de Tunisie, 7 juin 2021, pp. 4 et 5.
[21] Entretien avec Hamza Belloumi, consultable sur : https://www.businessnews.com.tn/yadh-ben-aour–il-sagit-dun-coup-detat,520,110489,3.
[22] C.A.D.H.P., Affaire Ibrahim Ben Mohamed Ben Ibrahim Belguith C. République tunisienne, requête n° 017/2021, arrêt 22 septembre 2022, paragraphe 118. Consultable sur le site de la Cour.
[23] Loi du 24 mars 1933 de réparation de la détresse du peuple et du Reich : Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich vom 24. März 1933.
[24] L’article 20 dispose : « Le préambule de la Constitution, ses premiers et deuxièmes chapitres et toutes les dispositions constitutionnelles qui ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret présidentiel, continuent à être appliquées ».
[25] Sur ce décret, voir Rafaâ Ben Achour, « Tunisie : De l’enterrement de la Cour constitutionnelle à l’enterrement de la Constitution du 27 janvier 2014 », Revue française de droit constitutionnel, 130, 2022, p. 507 et ss.
[26] Site de la Cour : https://www.african-court.org/wpafc/?lang=fr.
[27] Rafaa Ben Achour et Sana Ben Achour, « La transition démocratique en Tunisie : entre légalité constitutionnelle et légitimité révolutionnaire », Revue française de droit constitutionnel, 2012/4, N° 92, pp.715-732.
[28] Sana Ben Achour, « Le droit constitutionnel au service de l’Homme-Peuple », in Nathalie Bernard-Maugiron et Baudouin Dupret (dir.) Droits et sociétés du Maghreb et d’ailleurs, En hommage à Jean-Philippe Bras, éd. Karthala IISMM, 2023, p. 331.
[29] Michel Camau, « Le Phénomène Kaïs Saïed. Puissance du peuple, pouvoir d’un seul », In Nathalie Bernard-Maugiron et Baudouin Dupret (dir.), Droits et sociétés du Maghreb et d’ailleurs, En hommage à Jean-Philippe Bras, Karthala, IISMM, 2023, pp. 267-329.
[30] Voir la motion émanant de l’Association des magistrats tunisiens le 16 avril 2024, intitulé « Déclaration concernant la situation extrêmement dangereuse à laquelle est arrivée la magistrature tunisienne », consultée sur le site de l’Association, URL : https://www.facebook.com/photo?fbid=732478842335489&set=pcb.732478925668814&locale=fr_FR.
[31] Voir la déclaration de l’Association des Magistrats tunisiens, datée du 4 mai 2024, consultée sur le site de l’Association des magistrats tunisiens, URL : https://www.facebook.com/photo/?fbid=743025587947481&set=pb.100067201385778.-2207520000&locale=fr_FR.
[32] Réf. : AL TUN 2/2024.
[33] Article 55. – Aucune restriction ne peut être apportée aux droits et libertés garantis par la présente Constitution qu’en vertu d’une loi et pour répondre aux exigences d’un régime démocratique et en vue de sauvegarder les droits d’autrui ou pour répondre aux impératifs de la sûreté publique, de la défense nationale ou de la santé publique.
Ces restrictions ne doivent pas porter atteinte à la substance des droits et libertés garantis par la présente Constitution, et elles doivent être justifiées par leurs objectifs et proportionnelles à leurs justifications.
Aucune révision ne peut porter atteinte aux acquis en matière des droits de l’Homme et de libertés garantis par la présente Constitution.
Les instances juridictionnelles assurent la protection des droits et libertés contre toute atteinte.
[34] Article 4. – Les textes législatifs sont pris sous forme de décret-loi, ils sont promulgués par le Président de la République qui ordonne leur publication au Journal officiel de la République tunisienne, et ce, après délibération du Conseil des ministres. Lors de l’édiction de décrets-lois, il ne peut être porté atteinte aux acquis en matière de droits de l’Homme et de libertés garantis par le système juridique national et international.
[35] « En Tunisie, la croisade anti-élites du président Saïed », Le Monde, 16 mai 2024, p. 6.
[36] Michel Camau, op.cit., p. 276.
[37] Sana Ben Achour, « Crise politique en Tunisie. Kaïs Saïed a une vision messianique de lui-même », L’Humanité, 27 juillet 2021, URL : https://www.humanite.fr/monde/tunisie/crise-politique-en-tunisie-kais-saied-a-une-vision-messianique-de-lui-meme-715556.
[38] Michel Camau, op.cit., p. 305.
[39] Évoquée par José Pedro Zúquete, « The Missionary Politics of Hugo Chávez”, Latin American Politics and Society, 50,1, 2008, pp. 91-121. Cité par Michel Camau, op.cit., p. 309.
[40] Michel Camau, op.cit., p. 314.