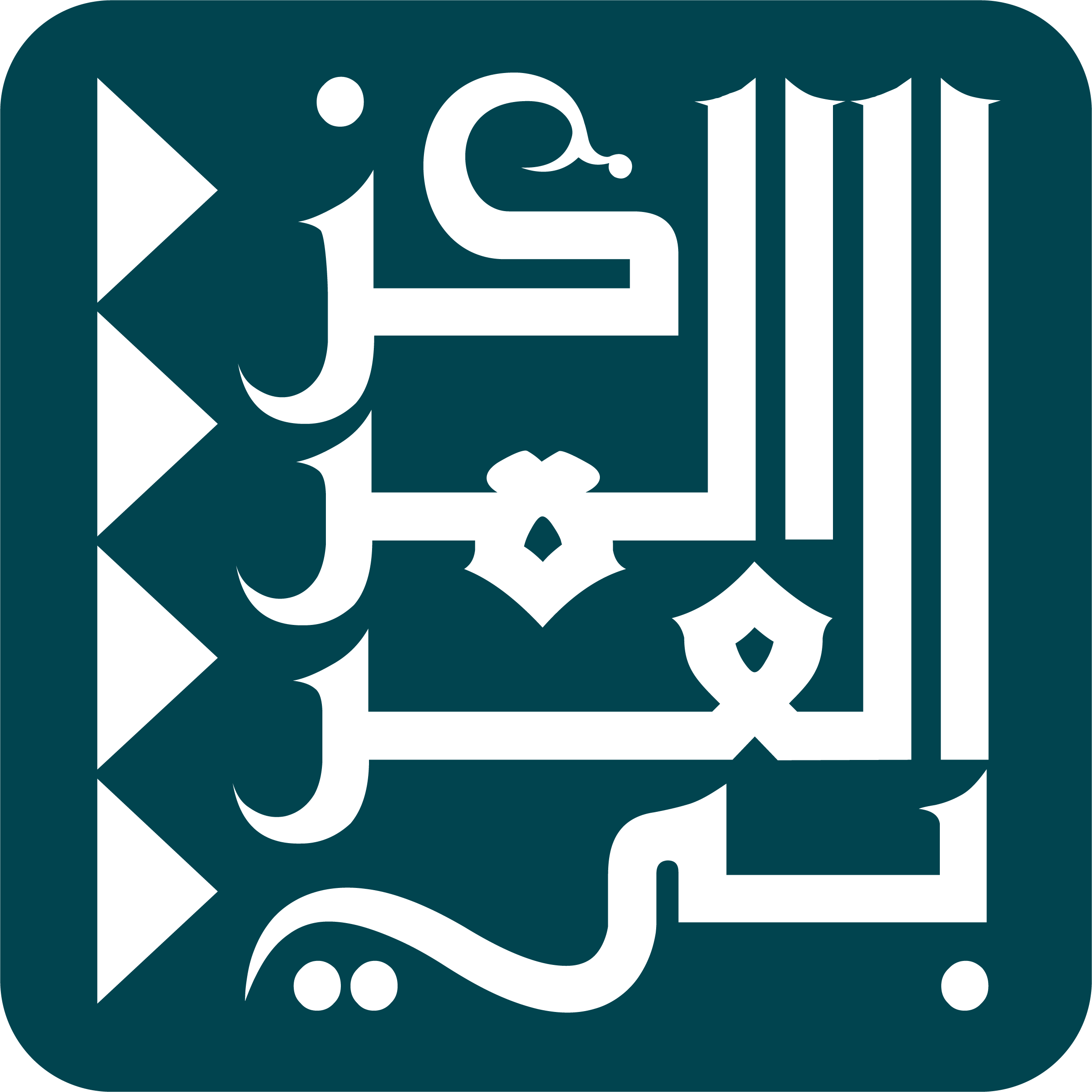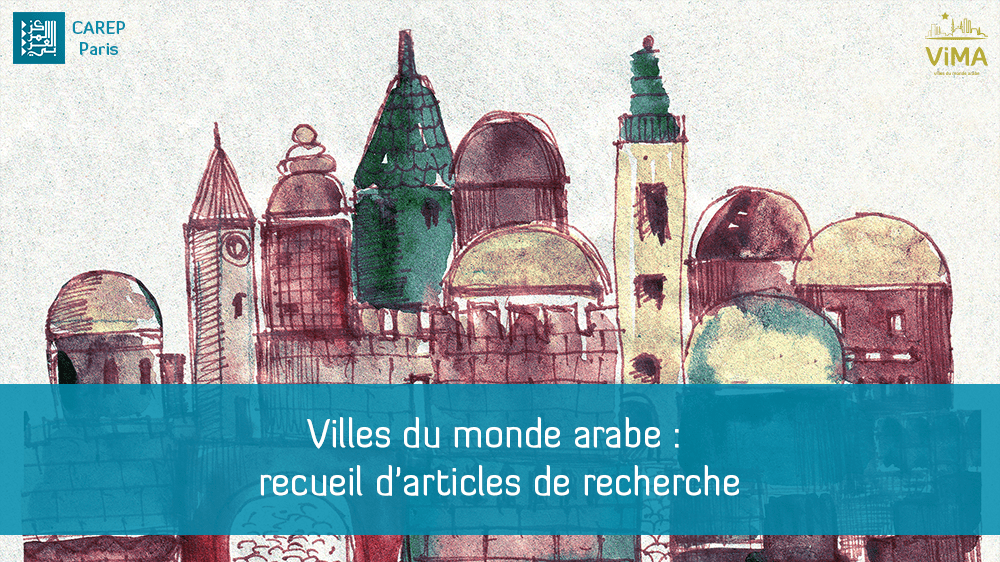Écologie & politique
À l’heure où l’urgence écologique et climatique n’épargne plus les pays arabes, une réflexion sur la coproduction de phénomènes par nos actions et choix politiques s’impose. L’axe « Écologie & politique » propose d’étudier les interactions entre les facteurs socio-politiques et économiques, et les changements environnementaux dans les pays du monde arabe. Car en effet, si on ne peut nier l’urgence du sujet, la cause écologique progresse encore trop lentement dans les pays arabes. L’écologie n’y donne pas lieu à de grands débats intellectuels et est souvent présenté comme un sujet apolitique. Et pourtant, les problèmes soulevés par cette discipline constituent les plus grands enjeux politiques du XXIe siècle.
Supervisé par Isabel Ruck, l’axe « Écologie & Politique » vise à élargir le débat sur ces questions dans le monde arabe en mettant, entre autres, le focus sur les initiatives locales existantes. Dans cette perspective, les productions scientifiques de l’axe s’intéressent aux inégalités climatiques, à l’impact du modèle agro-industriel sur les écosystèmes et l’autonomie alimentaire, à la problématique de l’artificialisation des sols et la gestion des ressources hydriques, ainsi qu’à la décroissance énergétique et la gestion des déchets.
L’axe accueille actuellement deux projets de recherche : ViMA (Villes du monde arabe) et EauRIENT (Gouvernance de l’eau dans le monde arabe), qui seront complétés par d’autres projets prochainement.
Les grands dossiers de l'axe
- Pêle-mêle
- EauRient
- ViMA
- Pêle-mêle
- EauRient
- ViMA
Une cartographie de la course au dessalement dans le monde arabe
15/04/2024Comment le monde arabe est-il devenu le leader mondial du dessalement ? Et pourquoi est-ce important ?
L’agriculture en Palestine : une histoire d’insécurité alimentaire et de résistance
06/02/2024Entretien avec Taher Labadi, chercheur Ifpo, réalisé par Isabel Ruck sur la place de l’agriculture palestinienne dans l’actuel conflit.
Jibal, un engagement pour de nouvelles stratégies alimentaires au Liban
01/12/2023Entretien autour du travail de l’ONG libanaise Jibal qui promeut la justice sociale et environnementale au Liban, notamment au travers de campagnes de sensibilisation et d’action auprès des agriculteurs et de la jeunesse.
La jeunesse marocaine engagée pour le développement durable
18/09/2023Ce travail est le fruit d’une réflexion commune menée pendant les mois de juillet et août 2023 entre les membres de Nechfate et le CAREP Paris dans le cadre de l’axe de recherche « Écologie et politique ».
Journée d’étude : villes durables au Moyen-Orient et en Afrique du Nord ?
24/05/2022Journée d’étude CAREP/CITERES-EMAM, Jeudi, 30 juin 2022 de 9h00 à 17h15
Journée d’étude : eau et agriculture dans le monde arabe
01/06/2021La journée d’étude « Eau & Agriculture dans le monde arabe » vise à proposer une analyse comparative sur les enjeux agricoles et hydriques dans la région. Elle a lieu en visioconférence le jeudi 24 juin 2021.
Dossier de la journée d’étude : les villes dans le monde arabe
17/02/2021Dossier rassemblant les papiers présentés lors de la journée d’étude du 4 décembre 2020 sur les villes dans le monde arabe.
Websérie : les villes du monde arabe
15/05/2020Nouvelle websérie du CAREP Paris consacrée aux « villes du monde arabe ».