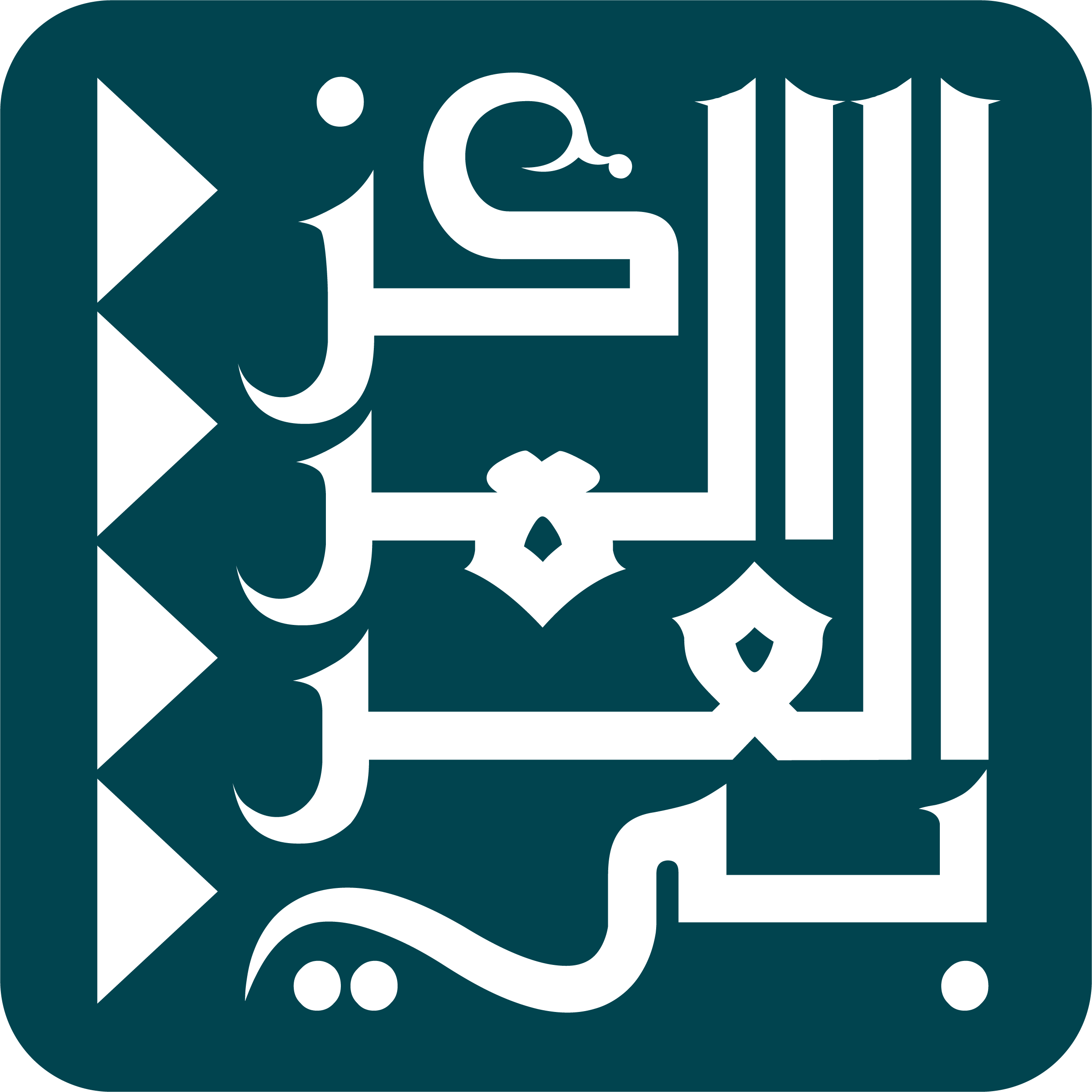Par :
Salam Kawakibi
Directeur du CAREP Paris
Julien Théron
Enseignant à Sciences Po.
La résolution de conflits armés est un domaine dont la pratique et la théorie ont connu des développements conséquents dans les dernières décennies, devenant ainsi un objet d’expérimentations diverses, tant les situations de conflits armés s’inscrivent dans les logiques locales spécifiques. Un certain nombre d’éléments novateurs se sont développés, faisant désormais intervenir comme médiateurs des petits groupes de réflexion, des associations à but humanitaires ou encore des groupes armés plus ou moins liés aux conflits. L’étude de la résolution de conflits est donc en constante progression.
Une des dimensions récurrentes des conflits armés contemporains est la structure complexe de ces conflits, à savoir une diversité de causes et d’acteurs entremêlés qui poursuivent des intérêts divergents par des stratégies induisant des dynamiques antagonistes. Cette complexité, provoquée par l’émergence de conflits armés non conventionnels, a en réalité toujours existé, mais a été, pendant la période moderne, largement recouverte par la souveraineté et la puissance de l’État.
Si l’on exclut la révolte arabe contre l’Empire ottoman, la Première Guerre mondiale est certainement à l’acmé de ce phénomène. Même lors de la Seconde Guerre mondiale, nombre de théâtres d’opération ont fait intervenir des forces non conventionnelles, en jouant sur des oppositions locales spécifiques, comme les oustachis, partisans et tchetniks dans les Balkans. Après la Seconde Guerre mondiale, 75 % des conflits armés ont résulté de guerres civiles, qualifiées par le droit international humanitaire de conflit armé non international[1].
Lors de la Guerre froide, la dualité du bipolarisme était censée gommer toute spécificité en alignant les États sur la politique des deux superpuissances. Pourtant, la plupart des conflits armés, certes inclus dans une logique d’affrontement global entre les deux blocs, relevait de spécificités locales prises dans la nasse de tensions régionales (Indes, Vietnam, Afghanistan, Angola, Proche et Moyen-Orient, etc.), faisant intervenir des acteurs non étatiques[2], et dont les sources de tensions ont parfois été plus ou moins instrumentalisées par des acteurs extérieurs permettant et entretenant le conflit.
La fin du bipolarisme a levé cette superstructure conflictuelle qui s’imposait aux différentes plateformes géopolitiques régionales du monde. Ainsi, après la fin de la Guerre froide, et alors que les conflits armés internationaux ont maintenu la nécessité de médiations classiques[3], les conflits civils ont, par leur impact humain et matériel colossal, pris la première place en termes de conflictualité, comme le font remarquer Wallensteen et Sollenberg[4] ainsi que Bercovitch et Jackson[5]. Ainsi, après le 11 septembre 2001, l’analyse des conflits a dû continuer à se transformer (Yordan)[6] pour correspondre aux nouvelles structures de conflits, et donc à leur résolution.
Il est nécessaire et primordial aujourd’hui de reconnaître l’importance du local dans l’existence de tensions internes. Pour sûr, les tensions locales pourraient dans certaines situations se régler par la communication entre les différents acteurs, ou un statu quo pourrait même être opéré du fait de l’absence de soutien régional et international à une escalade de la belligérance. Il faut donc bien se garder de tout essentialisme localiste des conflits, ce qui peut d’ailleurs aisément glisser vers le culturalisme ou le racisme. Mais il faut également bien reconnaître que les rivalités régionales et les joutes internationales doivent nécessairement se fixer, ne serait-ce que sur un embryon d’antagonisme local afin de le catalyser en conflit armé.
Les spécificités locales, qu’il s’agisse d’une ville, d’une région, d’un pays ou d’une zone transfrontalière sont donc essentielles pour l’identification des causes d’un conflit, sa structuration, et donc sa résolution. Dans ce cadre, la question des minorités a une importance fondamentale car le rapport de force entre les groupes humains, du fait de leurs démographies, mais aussi du fait de leur puissance politique, un groupe minoritaire pouvant être en situation de domination très forte, comme dans la Syrie d’Hafez et de Bachar Al-Assad ou l’Irak de Saddam Hussein.
Ainsi, si la minorité induit classiquement une asymétrie démographique entre groupes constitutifs d’une société, ne faut-il pas également comprendre la notion de minorité comme la résultante d’un phénomène dynamique de minorisation politique des groupes dans les sociétés ce qui pourrait ainsi conduire à une meilleure compréhension de l’émergence des situations de conflit, et faciliter par conséquent leur résolution ?
Afin de répondre à cette problématique, il faut se pencher sur la définition même de la minorité et comprendre la dialectique politique qui aboutit au fait minoritaire. Ceci permet une relecture profonde des conflits dans le monde arabe, considérés comme plus identitaires que politiques, et d’en mieux comprendre les dynamiques internes. Une approche critique du rôle du processus de minorisation dans les conflits peut permettre enfin de comprendre comment il peut s’intégrer à la résolution des conflits en anticipant les situations de conflits, en optimisant leur stabilisation, en les encadrant, en réduisant la conflictualité, en mettant un terme aux hostilités et en stabilisant les sociétés.
Qu’est-ce qu’est une minorité ?
La notion de minorité, courante en relations internationales, reste en réalité assez floue, car il n’y a pas de consensus sur les différents marqueurs qui constitueraient un socle consistant de « facteurs de détermination de minorité ». Il est aisé, au premier abord, de penser à des facteurs de types identitaires comme l’ethnie, la religion ou la langue. Toutefois, une étude appliquée de ces éléments montre la difficulté de la détermination de la minorité, une notion que Paolo Maggiolini considère comme ayant une « élasticité » sémantique[7].
L’ethnie par exemple, est généralement considérée comme un groupe partageant la même base génétique et la même culture. En effet, il est difficile de considérer l’ethnie comme une population génétique fermée, hormis dans des cas spécifiques, comme ceux des tribus indigènes d’Amazonie, des îles Andaman ou de Papouasie. Toute population vivant au contact avec d’autres admet un degré significatif de brassage génétique dans le temps. Il en est naturellement de même pour les questions culturelles. Ainsi, du fait du mélange génétique et culturel du groupe, ainsi que des spécificités internes produisant une diversification au sein même du groupe, il est difficile de considérer l’ethnie comme un ensemble strictement homogène et fermé, et plus encore de considérer différentes ethnies comme des groupes homologues.
Ainsi, il faut reconnaître que les facteurs de détermination identitaires sont contestables et subjectifs, vus de l’extérieur de la minorité, mais également vu de l’intérieur. En effet, un certain nombre d’auteurs insistent sur le fait que la notion de minorité provient en partie d’une autodétermination. Philip Ullah rappelle ainsi que Turner, au début des années 1980, lie la constitution du groupe à une autodétermination comportementale par une « perception stéréotypale du soi et de l’ingroup[8] ». Merino et Tileagă considèrent qu’il s’agit là d’une « question pratique et interprétative », approchant la question de la détermination des minorités comme une « autodétermination » « dépendant d’une approche de proximité auprès de son contexte causal de production et traitant les identités sociales comme une particularité de la manière dont les gens se décrivent eux-mêmes[9] ».
Il apparaît donc essentiel, pour saisir la minorité, de sortir de sa définition usuelle, c’est-à-dire identitaire, mais aussi de considérer qu’une détermination de la minorité peut être auto-générée par le groupe, indépendamment ou non de la question de la stigmatisation extérieure, naturellement.
La question de la détermination induit qu’il faut donc cesser d’envisager le phénomène à travers le seul prisme identitaire et de considérer qu’il s’agit également, et peut-être surtout, d’une construction profondément politique.
Ainsi, si certaines démocraties reconnaissent les minorités nationales dans le but de les protéger, le régime démocratique empêche toutefois en théorie un trop grand clivage minorité/majorité dans la société, et permet donc de prévenir le conflit. Quand elle les reconnaît, c’est donc pour garantir leurs droits et promouvoir la diversité, toujours dans un souci d’inclusion et d’égalité.
En revanche, sous les régimes autocratiques, le fait minoritaire est plus pernicieux. Maggiolini explique ainsi : « Les régimes autocratiques ou autoritaires peuvent être considérés comme minoritaires par définition, bien qu’ils gouvernent par des mécanismes, stratégies et techniques qui, fragmentant et cooptant sélectivement ou excluant des segments entiers de la nation, se légitiment fictivement comme une majorité gouvernante sans avoir besoin de correspondre précisément aux conditions démographiques et sociopolitiques »[10].
Pour comprendre les implications en termes de structuration et donc de résolution de conflits de cette question de la minorisation politique de la majorité par une minorité dominante, que celle-ci soit identitaire (ethnie, religion, langue, etc.), politique (junte, oligarques, réseau de pouvoir) ou bien les deux, il faut sortir d’une approche strictement identitaire et quantitative. C’est pourquoi, il faut élargir la question de la domination politique d’un groupe sur les autres.
En effet, quand John W. Burton explique que « dans des conditions d’oppression, de discrimination, de situations défavorisées et d’isolement, la défense des valeurs est importante en termes de besoins personnels de sécurité et d’identité[11] », il faut moins y voir la prééminence essentialisée de l’identité sur le politique que sa substitution à une bonne gouvernance, les marqueurs identitaires ségrégatifs intervenant « en remplacement » de la cohésion d’une société inclusive et harmonieuse.
Si la minorité est une construction dialectique née du rapport de puissance entre des groupes constitutifs de la société, alors il faut admettre que tout régime autocratique, dont le principe même est l’autoperpétuation de son pouvoir, dispose là d’un outil d’instrumentalisation majeur en ce sens.
La minorité, surgissant ainsi d’une dialectique inter-groupale, est en effet un phénomène extrêmement utile pour les régimes autoritaires, qui peuvent se saisir de cet objet politique pour établir, asseoir et entretenir leur pouvoir en le manipulant au gré des nécessités. Il n’est alors plus question pour le pouvoir, de considérer l’identité des groupes ou même leur réalité démographique, mais plutôt de les manœuvrer au regard de leur utilité stratégique.
La minorisation, une construction politique à fort potentiel conflictuel
Il est intéressant de constater, chez Ryan D. King[12], la manière dont la minorité induit une crainte auprès d’autres groupes de la société, y compris auprès du groupe majoritaire, ainsi que son impact, au travers de la théorie des organisations, sur la législation. Toutefois, une approche critique implique également de discuter la spécificité de cette menace pour deux raisons.
D’abord, si la minorité induit une menace, ou bien une perception de menace, sur les autres groupes de la société, cela ne signifie pas nécessairement que le groupe minoritaire soit en position d’infériorité. En effet, nombre de situations historiques indiquent qu’une minorité peut être en situation de contrôle politique, institutionnel, économique ou sécuritaire, et être par conséquent définie comme « minorité dominante ». Dans ce cas, la minorité dominante ne provoque pas, comme l’indique King, une législation d’endiguement du risque qu’elle présente, mais au contraire, elle crée et applique une législation de protection de sa domination.
Ensuite, face à cette situation de minorité dominante, la majorité se retrouve dans l’incapacité de produire une législation qui la protège. Ainsi, la majorité est démographiquement en situation favorable mais politiquement, institutionnellement, économiquement et en termes sécuritaires en situation de soumission à la minorité dominante. Dans ce contexte, il est donc impérieux de considérer la majorité démographique comme une minorité politique. Or cette notion n’est pas seulement théorique, car la minorité dominante, dans son discours comme dans ses politiques publiques concrétise très clairement l’idée de minorité politique de la majorité. C’est là précisément que se révèle le processus de minorisation.
Ce processus se traduit par une gouvernance qui suit le principe (officiel ou officieux) que la majorité ne compte pas face aux intérêts supérieurs de la nation (qui protègent en réalité la structure de domination minoritaire), autant que par un système bien établi de népotisme, de clientélisme et de corruption, qui sert également cette domination, ou encore par une symbolique infantilisante vis-à-vis de la majorité qui, soit ne saurait pas gouverner correctement, soit présenterait un risque pour les minorités démographiques si elle était au pouvoir et donc, du point de vue biaisé de la minorité dominante, confirme nécessairement la majorité dans son état minorisé.
Il faut comprendre par là que la rébellion de la majorité démographique, en situation de soumission politique par une minorité relève précisément de ce que Ted Gurr, qui a analysé la théorie psychosociologique de frustration-agression, nomme la « privation relative », qui peut conduire progressivement à un « potentiel pour une violence collective » en fonction de « l’intensité et [du] scope de la privation relative parmi les membres d’une collectivité[13] » et, devrait-on rajouter avec John Nagle, de la possibilité circonstancielle du recours à une entité extérieure qui puisse lui permettre la rébellion, voire la sécession[14].
Les travaux d’Abdul R. JanMohamed insistent sur la réaction d’un groupe opprimé face à l’hégémonie[15]. Bien que JanMohamed étudie cette opposition conflictuelle au travers de la domination coloniale, on peut aisément transférer ce même principe à la domination, au sein d’un ensemble national, d’une majorité sur les minorités ou d’une minorité sur la majorité.
Or, dans son ouvrage majeur, Understanding Conflict Resolution, Peter Wallensteen explique que selon une approche classique de la résolution de conflit, la dynamique est alors celle de l’affrontement. L’action d’un groupe perçue comme déplaisante par un autre groupe provoque une réaction antagoniste, suivant un processus bien connu d’« image miroir[16] ». Ceci s’inscrit nécessairement dans la fabrication de la minorité, puisque, comme le souligne Cheryl L. Thompson, la détermination de la minorité se fait par un processus d’« autodéfinition par opposition[17] ». Pour éviter le conflit, il faut que les groupes constitutifs de l’ensemble national ne soient pas, ou ne se sentent pas, minoritaires.
Minorités et conflits dans le monde arabe
Un enseignement intéressant provenant des révolutions arabes est l’idée que la majorité, dans son processus d’autodéfinition, probablement du fait de son avantage démographique, ne procède pas comme la minorité en limitant son autodétermination à elle-même. Les révolutions arabes ont démontré en effet que, certainement du fait de la force sociale que représente la majorité démographique, il n’existe pas de « complexe minoritaire ontologique » chez la majorité.
De ce fait, la majorité, dans son processus politique d’autodétermination groupal, lorsqu’elle se mobilise contre son état de soumission et entre ainsi en conflit avec la minorité dominante, s’écarte elle-même d’une autodétermination restrictive, à savoir par des facteurs de détermination comparables à ceux des minorités, pour englober un ensemble plus large de la société, associant différentes minorités. Ce phénomène confirme l’hypothèse de l’existence d’un « facteur politique » fondamental dans l’autodétermination du groupe, qui dépasse les facteurs identitaires dont le rôle est pourtant réel.
Ainsi, si l’on a établi plus haut une autodétermination politique de la minorité qui se dresse à l’encontre d’une majorité oppressante, la majorité produit, au travers de sa mobilisation sociale et contre sa position de minorité politique, un ensemble groupal qui la dépasse et se revendique plus largement, jusqu’à agréger, symboliquement mais aussi pratiquement, la nation tout entière. Dans ce cas, la majorité démographie, minorité politique oppressée, tente de dépasser le conflit pour revendiquer un ensemble sociétal respectueux de tous, qui se veut universaliste, dépassant ainsi les ségrégations réelles ou factices entre majorité et minorité pour se positionner comme un seul, unique et cohésif ensemble national.
Commençons toutefois par traiter des exemples qui pourraient à juste titre apparaître comme contradictoires avec cette idée.
Si l’on considère le conflit armé non-internationalisé en Irak en 2006-2007, il faut reconnaître naturellement que la majorité démographique arabe chiite n’a pas cherché à représenter un ensemble national véritablement équilibré, tout en se revendiquant comme un ensemble national communautariste, et en se prévalant de la domination de l’État irakien du fait de sa majorité démographique, dont l’autodétermination identitaire est fondée à la fois sur l’ethnie (arabe) et la religion (Islam chiite duodécimain). C’est le processus inverse de majorisation, suivant lequel une majorité autodéterminée par des facteurs identitaires cherche à se placer en situation de domination politique.
La situation s’est par ailleurs rapprochée en un sens de celle existant au Liban, à savoir que chaque autodétermination identitaire va de pair avec une volonté de chaque minorité, cette fois-ci, d’incarner l’ensemble national, mais au travers d’une situation de domination qui est vue comme légitime. Dans ce cas, la minorité identitaire tente de se majoriser politiquement. Les autres groupes sont vus comme soit des allogènes, soit des traitres intérieurs qui ne méritent pas de gouverner, et doivent donc être minorisés politiquement, ce qui produit naturellement, par réaction, les mêmes processus de majorisation chez eux.
Un autre exemple est celui des Kurdes lors de la révolution syrienne. Le conflit armé a vu une autonomisation de cette minorité démographique, constitutive de la nation syrienne. En réalité, les personnalités kurdes syriennes en contact avec la Coalition nationale syrienne (CNS) ont émis quelques revendications, se positionnant en tant que minorité identitaire et politique à la fois vis-à-vis du régime et de l’opposition, et conditionnant leur participation à la CNS à la reconnaissance du particularisme kurde. Or, il faut émettre trois remarques à ce propos.
Tout d’abord, les manifestations qui ont emporté le pays en 2011 étaient toutes composées de groupes nationaux, majoritaires ou minoritaires, y compris des Kurdes. Par ailleurs, une partie des revendications kurdes conditionnant leur participation à la CNS s’est faite en partie vis-à-vis de marqueurs identitaires pré-révolution qui répondaient à la minorisation de tous par la doctrine baasiste, contredisant une inclusion considérée comme égalitaire, à savoir, par exemple, l’élimination du terme « arabe » dans « République arabe syrienne », ce qui a été refusée par la CNS. Pour autant, les structures politiques kurdes n’ont pas toutes été favorables à une spécification de leur communauté dans l’ensemble national. Enfin, quoi qu’il en soit, le parti aux commandes au sein de la communauté avait déjà adopté, avant la révolution, comme l’a expliqué Jordi Tejel Gorgas, une « stratégie identitaire passant de la “dissimulation“ à la “visibilité“[18] ». Il a donc adopté une stratégie de défense du particularisme plus que de réunion nationale, pour des raisons dont il est difficile de déterminer la part d’autodétermination identitaire et de réaction historique à la minorisation politique par le régime.
Il est donc clair au regard de ces deux exemples, irakien et syrien, que le phénomène de transfert psychosociologique de la majorité vers l’ensemble national n’est pas automatique. Il en existe toutefois un certain nombre qui est tout à fait pertinent.
Le premier reste très certainement celui de la révolution syrienne. Le peuple syrien a démontré dès le début de la révolution une appétence pour le dépassement du communautarisme identitaire, révélant une réelle dynamique politique nationale. Hormis la participation de différentes communautés aux manifestations et l’inclusion des personnalités au sein des instances révolutionnaires, les slogans eux-mêmes ont clairement appelé à l’unité de la nation[19].
Bien entendu, il est aisé d’objecter que la guerre a induit une communautarisation exacerbée, polarisant alaouites et chrétiens d’un côté, dont ont été issues des milices participant aux « Forces de défense nationales » pro-Assad, les Kurdes des Unités de protection du peuple, l’Armée libre syrienne, majoritairement arabe sunnite, puis des éléments salafistes djihadistes. Pourtant, la révolution syrienne a été détournée de ses objectifs, précisément par un phénomène de minorisation. Comme le démontre Georges Fahmi[20], le conflit originel était précisément de nature exclusivement politique et unitariste, rassemblant majorité et minorités dans un même ensemble national, politiquement minorisé par le pouvoir. Même la militarisation de la révolution n’a pas induit immédiatement une logique multicommunautaire au sein de l’ASL. C’est en revanche la dégénérescence du conflit politique en conflit identitaire, suivant une stratégie assumée et avouée à la fois par le régime syrien et par les salafistes djihadistes, qui a fini par l’emporter. Ces deux minorités extrémistes ont associé majorisation politique et destruction physique à toute force se réclamant de la démocratie.
Un autre exemple effectif de transfert majorité-ensemble national est la révolution égyptienne. Comme l’étude lexicale et sémantique des slogans le confirme, à aucun moment les révolutionnaires, majoritairement arabes sunnites, n’ont appelé à la division de la société, à la ségrégation et à la domination sur les coptes. Inversement, la notion unitaire de peuple a été utilisée dans plusieurs des plus fameux slogans, comme l’indique Zoé Carle : « le peuple, opposé au régime, affirme une volonté collective qui passe par l’énallage sur la personne : le “nous“ qui devrait être celui de la foule rassemblée pour demander effectivement la chute des dirigeants devient “le peuple“ »[21]. En ce sens, la communauté copte n’a pas été exclue de la révolution égyptienne de 2011, bien au contraire, elle y était incluse. Le conflit concernait bien la gouvernance politique du régime d’Hosni Moubarak.
En revanche, l’ancien dictateur avait amplement instrumentalisé politiquement le fait communautaire pour se présenter comme protecteur de la minorité, qui n’avait pas, comme l’a montré la révolution de 2011, de détermination politique au regard de l’ensemble national. La spécification identitaire de cette communauté religieuse a été manipulée comme outil politique interne (diffusion d’une image de leader protecteur) et surtout externe (apparaître aux yeux des Occidentaux comme le garant de la sécurité des chrétiens). Toutefois cette stratégie du pouvoir est dangereuse, car la caractérisation répétée de la communauté copte ne fait que spécifier son particularisme identitaire vis-à-vis de la majorité, et, plus encore que de créer une fracture artificielle sur ces principes au sein de la société, elle stigmatise en désignant une altérité tout en soulignant son infériorité. Une telle stratégie, ségrégative et non inclusive, revient donc à mettre à part, voire à mettre en situation de danger, la communauté que l’on dit vouloir protéger.
En sus de diviser les parties de la société pour mieux les contrôler, de tenir l’agenda et la narration politique nationale, cela participe également, in fine, à la manipulation des parties de la société afin de faire diverger toute éventualité de conflictualité de la question première de la gouvernance vers la question de la composition de la société. Ceci revient donc à instrumentaliser les groupes les uns contre les autres, à l’instar de ce qui s’est passé avec la transformation de la révolution syrienne en guerre civile communautarisée. Ce processus de minorisation répond donc à une diversion[22] appliquée à la scène intérieure[23] et induit une fragmentation, phénomène étudié par Cunningham, Bakke et Seymour. La minorisation s’oppose à la cohésion des sociétés, et peut mener jusqu’à la guerre civile[24].
Enfin, il faut également citer un exemple sensiblement différent, car il ne s’agit pas tant d’un transfert d’une majorité à l’ensemble national, mais d’une agrégation de forces minoritaires en ensemble national : la révolution libyenne. Les divisions sociétales entre les clans ont été patiemment et attentivement entretenues par Mouammar Kadhafi dans un processus de minorisation politique jouant sur les structures sociétales spécifiquement libyennes. Ces divisions n’ont pourtant pas joué de rôle prohibitif dans la constitution du Conseil national de transition (CNT), de sorte que l’unité initiale (certes relative et peut-être de façade) des différentes factions armées, correspondant plus ou moins aux clans, a permis ainsi la chute du dictateur.
On peut donc ici considérer que l’ensemble des minorités, de taille et d’importance stratégique très différentes, n’a pourtant pas empêché la constitution d’un mouvement unitaire qui a rempli un objectif politique précis, à savoir la chute du régime. Ceci est d’autant plus remarquable que la notion d’unité n’avait existé qu’avec la clef de voute qu’était le leader libyen, qu’il s’est agi de se constituer en organe politique mais aussi en force militaire coordonnée, et enfin qu’il a fallu coopérer avec une coalition internationale faite d’armées conventionnelles. Par ailleurs, l’unité s’est effondrée et les différentes factions se sont ensuite affrontées à cause de l’absence de structuration institutionnelle de l’État, de soutien en ce sens de la communauté internationale, et de l’exploitation des forces et antagonismes des différents groupes par des acteurs extérieurs.
Dans ces trois exemples, il faut reconnaître la déviation d’un conflit sur la gouvernance politique qui a consacré l’ensemble national. Cette déviation peut être manipulatrice pour faire dévier le conflit (Syrie), conséquentielle par instrumentalisation (Égypte), ou bien dégénérescente par manque de structuration de la gouvernance (Libye). Ces trois exemples montrent donc que la minorisation, engendrée directement ou indirectement par des acteurs internes ou externes, est un élément très important de la naissance et de la structuration des conflits dans les sociétés.
Or, le Moyen-Orient fait toutefois face à trois problèmes conséquents au regard des conflits armés qui agitent la région : ils sont nombreux, leurs causes sont complexes, et ils sont entremêlés les uns dans les autres[25]. Il y a donc nécessairement des enseignements à tirer de la minorisation en termes de résolution de conflits.
Enseignements pour la résolution de conflits
La dialectique politique du phénomène de minorisation entraîne une ségrégation conflictuelle au sein de la société. Or, lorsque que le conflit est passé d’une question de gouvernance à la violence, il est impossible de ne plus considérer les groupes ainsi ségrégués comme une réalité d’antagonisme avec laquelle il faut composer pour résoudre le conflit.
Les approches classiques de la résolution de conflit, mentionnées dans l’article 33.1 de la Charte des Nations unies, comme l’arbitrage onusien, les négociations bilatérales entre États ou l’intervention de médiateurs tiers, qui ont été appliquées avec plus ou moins de succès pour résoudre les conflits armés internationaux, ont dû également s’adapter aux évolutions des conflits décrites plus haut.
Comme Jacob Bercovitch et Richard D. W. Jackson le font justement remarquer, de nouvelles méthodes ont été introduites, citant « diplomatie préventive, intervention humanitaire, répartition des tâches régionales, et commissions vérité », car « Dans les dernières décennies, le principal changement s’est opéré en quittant le conflit interétatique pour en arriver au conflit interne, et à la prolifération de conflits ethniques, religieux, culturels et pour les ressources, qui sont les menaces majeures contre la paix et la sécurité internationales[26] ».
Pour Bercovitch et Jackson, une nouvelle approche de la résolution de conflit est nécessaire, car avec « la prévalence des guerres ethniques et religieuses fondées sur l’ethnicité, les approches ”traditionnelles” de la résolution de conflit ont été rendues largement inefficaces[27] ». On objectera ici que si le diagnostic est exact en termes d’inefficacité des approches traditionnelles, il faut toutefois relativiser, comme cela a été établi, la nature identitaire des conflits afin d’en appréhender plutôt la nature éminemment politique.
Bien sûr, cela n’empêche aucunement de considérer les spécificités identitaires locales dans la mise en œuvre de processus de résolution de conflits. Sørli, Gleditsch et Strand ainsi que Wimmer, Cederman et Min[28] ont en effet souligné la réalité de la représentation ethnique dans les conflits, et Feliu et Grasa[29] comme Fox[30], Svensson[31] ou encore Appleby[32] ont démontré l’importance des spécificités religieuses.
En réalité, tout en reconnaissant l’existence et l’importance du fait identitaire, Sørli, Gleditsch et Strand expliquent que la ségrégation sociétale n’est pas opérante de ce fait-là. Ils estiment en revanche, en contradiction avec le modèle Collier-Hoeffler sur les guerres civiles, et en opposition avec une approche déterministe et essentialiste de la conflictualité au Moyen-Orient, que « le type de régime politique » est de la première importance[33].
Ceci correspond d’une part au « niveau sociétal, lié aux concepts de socialisation, de multiculturalisme et de patrimoine immatériel » et d’autre part au niveau « de nature juridique et politique qui recouvre notamment les droits linguistiques et culturels ainsi que les questions liées aux ressources et aux libertés confessionnelles », dont parle Said Bennis[34].
On suivra ici donc la recommandation de Bercovitch et Jackson, à savoir que de nouvelles méthodes de résolution de conflits, éminemment politiques, sont nécessaires, comme « l’établissement d’ordres politiques justes et démocratiques, la ressuscitation d’États faibles ou faillis, la promotion des droits de l’homme, la création de structures politiques émancipatoires, les commissions de réconciliation et de vérité, les tribunaux internationaux, ainsi que la diplomatie préventive et les systèmes d’alerte avancée[35] ».
Cela n’induit pas nécessairement pour autant que l’origine du conflit soit résolue, ou que la fracturation entre les groupes s’efface, mais au moins que la dispute puisse être transférée du premier ordre (concernant l’objet du conflit) à un ordre secondaire (concernant le moyen de résoudre le conflit)[36], et s’atteler ainsi à la réduction des préjudices inter-groupaux tout en faisant décroître l’hostilité[37].
La cause profonde des conflits répond, elle, en effet, comme l’expliquent Bercovitch et Jackson, à des processus politiques. Toute résolution de conflit contemporain gagne donc nécessairement à se saisir du champ politique en usant des méthodes avancées que ceux-ci promeuvent.
C’est en effet l’établissement d’ordres politiques justes et démocratiques qui peut, conformément à la démonstration établie, prévenir l’établissement et l’instrumentalisation conflictuelle de minorités politiques selon le processus de minorisation. La démocratie permet en effet électoralement l’expression égalitaire de tous, mais aussi éventuellement la création d’entité de représentation, de promotion et de protection de la diversité d’une société afin de prévenir même toute autodétermination minoritaire.
La question de l’État de droit se pose également, et donc celle de la structure des États qu’il faut renforcer institutionnellement et dont l’action doit être plus effective, afin de protéger l’ensemble de la population en termes de droits fondamentaux, indépendamment des différences identitaires.
Enfin, la question de la justice est un point essentiel de la résolution de conflit, car d’une part, tout processus qui s’en détournerait prendrait le risque de s’aliéner une bonne partie de la population qui la réclame, et d’autre part, car la notion de minorité politique exprime précisément la nécessité d’une représentation juste contre l’oppression. Les différentes formes de justice post-conflit, qu’elles soient coutumière, transitionnelle, par commissions ad hoc, nationale, internationale ou mixte doivent donc en ce sens être mobilisées, ce sans quoi la stabilité post-conflit s’en ressent nécessairement. Nier l’importance de la justice post-conflit entretient en effet la défiance intercommunautaire, et donc, selon les processus décrits plus haut, l’autodétermination des minorités, perpétuant ainsi la ségrégation identitaire et politique de la société et permettant à des leaders peu soucieux de l’harmonie de la nation de jouer sur ces divisions dans leur propre intérêt.
C’est également ce processus d’autodétermination qui, exacerbé, pousse la minorité à la scission, ouvrant soit sur l’autonomisation de ses intérêts et la tentative de prendre par les urnes ou la violence la direction de l’État pour elle seule, soit par la réclamation d’un État indépendant dont le territoire serait prélevé à l’État existant. Dans tous les cas, il s’agit de démanteler la structure (politique, légale, territoriale) d’un État qui n’est plus garant de l’égalité de ses citoyens et de l’intérêt général. Il est donc clair que la minorisation politique, qu’elle soit auto-générée ou instrumentalisée, est un processus éminemment conflictuel qu’il convient de prévenir[38] en adressant une réponse politique adéquate[39].
Dans le sens des propos de Bercovitch et Jackson, Ramsbotham, Miall et Woodhouse proposent quant à eux, après avoir procédé à une compréhension avancée des conflits contemporains, de les prévenir, de les contenir, de les terminer, mais aussi de mettre en place des éléments stabilisateurs : reconstruction post-conflit, construction de la paix et réconciliation[40].
En ce qui concerne le monde arabe, ces principes, faut-il le reconnaître, ne sont guère bien appliqués, malgré des avancées dans la compréhension des dynamiques profondes qui engendrent les conflits. On se reportera sur ce point avec grand intérêt sur l’approche dynamique, multi-théâtres et multidimensionnelle développée par Babbitt, Bell, Lempereur, Mandell et Wolf[41], mais aussi sur la manipulation des processus de résolution des conflits comme un moyen de belligérance[42].
Trois situations sont particulièrement intéressantes, suite aux différents événements qui ont secoué le monde arabe depuis la fin du bipolarisme :
- La première est la minorisation à la fois identitaire et politique des communautés (Liban, Irak). Le système politique, officiellement démocratique, est largement identitaire, de sorte que chaque communauté se considère en état de minorité politique, donc de défiance, voire en situation d’autodéfense. Cette situation n’est pas stable puisqu’elle induit des affrontements armés plus ou moins sporadiques, au sein de la société ou de manière trans-étatique. Les communautés minorisées politiquement se retrouvent premiers acteurs des conflits sans pour autant avoir à répondre institutionnellement de leurs responsabilités. Il n’est donc absolument pas étonnant, en ce sens, que le phénomène s’étende régionalement, et que des groupes armés non étatiques identitaires du Liban et d’Irak se soient retrouvés à combattre dans un État tiers, à savoir en Syrie. Cela répond, dans le monde arabe comme dans d’autres régions riches mais complexes, à l’« enchevêtrement entre la géopolitique et la souveraineté[43]».
- La seconde situation est un état de conflit permanent dont l’intensité de la violence physique va du statu quo armé ponctué d’escarmouches au conflit de haute intensité. Dans cette situation (Syrie, Libye, Yémen), les antagonismes des différentes communautés minorisées sont soutenus par des puissances régionales et internationales dont l’évolution du rapport de force fait certes muter le conflit mais sans qu’il n’y ait de pénurie des moyens de belligérance, et donc, de fatigue de guerre.
- Enfin, dans la troisième situation, les antagonismes politiques et sécuritaires ont laissé la place à la restauration d’un ordre politique qui prend les atours d’un régime nouveau mais qui tient en réalité de la restauration de régimes (Égypte, Bahreïn).
Il faut toutefois également mettre l’idée d’un processus conflictuel de minorisation à l’épreuve de la situation des autres pays arabes.
De fait, les trois pays qui ont réussi à maintenir leur système politique malgré les secousses sociopolitiques et en dépit des révolutions arabes sont le Maroc, la Jordanie et le Koweït. Dans ces trois pays, afin de préserver le régime, la couronne a permis une certaine ouverture, que ce soit par la délégation de pouvoir ou le reniement du gouvernement. Au Maroc et en Jordanie, cela a permis de maintenir un statu quo quant à l’état de division réel mais limité de la société (berbères au Maroc, palestiniens en Jordanie).
Un autre scénario s’est présenté en Algérie, ou le régime s’est maintenu, à l’heure actuelle, malgré la chute de président Bouteflika et la persistance de la contestation. On peut toutefois affirmer, dans ce mouvement, l’existence d’un transfert majorité-ensemble national très clair.
En ce qui concerne la Tunisie, mis à part la population noire du Sud, comme le remarque Maha Abdelhamid[44], les minorisations portant sur un fondement identitaire sont moins prononcées, mais il est possible de considérer les prismes : social (couches sociales défavorisées), générationnel (jeunesse), éducationnel (études) ou territorial (cosmopolitisme/périurbain/ruralité). De plus, il faut reconnaître que la minorisation politique de la majorité a également existé sous le règne de Ben Ali, et que celle-ci, en l’absence de minorités identitaires aussi importantes que dans d’autres pays, la minorisation a porté précisément sur l’ensemble national.
Le meilleur exemple de dépassement de la minorisation politique reste probablement l’accord de l’été 2019 au Soudan. En effet, la société soudanaise est constituée de nombreux particularismes ethniques (Arabes, Fours, Zaghawas, Massalits, Nubas, Nubiens, Bedjas, etc.), religieux (musulmans, coptes, animistes) ou encore linguistiques (dialectes arabes soudanais, tchadien, de l’Hedjaz, nubien, tigré, daju, gorane, langues du Kordofan, etc.). De plus, l’enchaînement des régimes autocratiques a induit de multiples minorisations des communautés qui se sont retrouvées dans de nombreux conflits (Sud Soudan, Darfour, Nil Bleu, Kordofan méridional, tensions tchado-soudanaises). Et pourtant, l’ensemble national a dépassé les instrumentalisations ségrégatives et a fait corps sans distinguer la majorité démographique arabe musulmane des autres groupes constitutifs de la société. Ainsi unie, la mobilisation populaire a réussi non seulement à dépasser la minorisation du pouvoir autocratique et à se rassembler, mais aussi à atteindre deux buts considérables : la chute d’Omar Al-Bachir et l’accord de transition démocratique avec la junte. Quelle que soit l’issue de ce mouvement, l’exemple soudanais reste donc un cas d’école pour le monde arabe.
Conclusion
L’approche identitaire des minorités ne permet pas d’appréhender pleinement la question des conflits, car elle fait largement l’impasse sur les processus politiques qui conduisent à la minorisation au sein de la société. La minorisation admet non seulement l’idée d’une autodétermination minoritaire, mais surtout l’instrumentalisation de cette autodétermination normative pour l’ensemble de la société jusqu’au conflit armé.
Au regard de cette minorisation, le fait minoritaire doit donc être appréhendé comme une considération à la fois plus profonde (inscription dans l’habitus psychosociologique des groupes constitutifs de la société considérée), plus étendue (élargir la possibilité de la soumission en minorité des majorités), plus structurante (plus large couverture des tensions sociétales) et plus dynamique (transformation des rapports de force dans le temps).
Au travers de ce prisme d’analyse, on peut donc mieux saisir les racines profondes des divisions sociétales, particulièrement dans les zones de grande diversité, que celle-ci soit ethnique, religieuse, culturelle, linguistique, clanique, tribale, sociale ou encore territoriale. Cette approche critique du fait minoritaire s’applique donc particulièrement bien au Moyen-Orient. Elle induit d’écarter toute possibilité d’essentialisation des tensions conflictuelles dans la région, en recentrant la conflictualité du champ identitaire au champ politique qui est, d’après l’étude heuristique des phénomènes conflictuels énoncés ici, la véritable source des conflits.
Une meilleure compréhension des raisons des conflits permet par ailleurs de mieux appréhender les nouveaux outils de leur résolution, fortement axés sur les structures et la qualité de la gouvernance politique, même reconnus par les institutions militaires[45].
Cela invite également à comprendre comment sociétés peuvent s’organiser elles-mêmes pour répondre à leurs besoins, car « la construction de l’État doit être un processus endogène afin que son produit final soit en paix avec lui-même », explique Mohammed Ayoob[46]. Georges Fahmi souligne par ailleurs en ce sens l’importance du bottom-up pour conduire tout processus de résolution de conflit lorsqu’il dit qu’un « compromis politique doit être non seulement imposé mais aussi chéri par les différents groupes politiques afin d’assurer la stabilité[47] ».
Une telle approche du fait minoritaire est donc fondamentale pour anticiper les conflits, les encadrer, en réduire la conflictualité, les stabiliser, suspendre puis terminer les hostilités, puis stabiliser et harmoniser les sociétés.
Cette démarche nécessite toutefois des efforts conséquents de tous les acteurs du conflit, aux échelons locaux, nationaux, régionaux ou internationaux. Un tel processus peut apparaître illusoire, mais la construction politique inclusive de l’ensemble national qu’ont démontré les différents peuples arabes prouve précisément la pertinence et la nécessité de recentrer la résolution de conflits sur la question politique plutôt que sur la question identitaire.
Notes :
[1] Kathleen Cunningham et Wendy Pearlman, « Nonstate Actors, Fragmentation, and Conflict Processes: Introducing the special issue », Journal of Conflict Resolution, Vol. 56, Issue 1, 2012, pp. 3-15.
[2] Wendy Pearlman et Kathleen Gallagher Cunningham, « Nonstate Actors Fragmentation, and Conflict Processes », Journal of Conflict Resolution, Vol. 56, Issue 1, 2012, pp. 3-15.
[3] Jacob Bercovitch, Resolving International Conflicts: The Theory and Practice of Mediation, Lynne Rienner Publishers, Boulder/Londres, 1996, 290 p.
[4] Paul C. Stern et Daniel Druckman, International Conflict Resolution After the Cold War, Chapitre 22, National Academy Press, Washington, 2000.
[5] Jacob Bercovitch et Richard D. W. Jackson, Conflict Resolution in the Twenty-first Century: Principles, Methods, and Approaches, University of Michigan Press, 2009, p. 6.
[6] Carlos L. Yordán, « Towards Critical Theories of Conflict Analysis: What the “Critical Turn” in International Relations Can Teach Conflict Analysis », Journal of International and Area Studies, Vol. 10, No. 1, June 2003, pp. 59-74.
[7] Paolo Maggiolini, « The Origin and Development of the Idea of “Minority” in the MENA Region: A Multilevel Analysis », in Salam Kawakibi, Politics of Recognition and Denial. Minorities in the MENA Region, EuroMesco Joint Policy Study 11, EuroMesco / Arab Reform Initiative / IEMed, 2018, p. 12.
[8] Philip Ullah, « Self-definition and psychological group formation in an ethnic minority », British Journal of Social Psychology, Vol. 26, Issue 1, March 1987, pp. 17-23.
[9] María-Eugenia Merino et Cristian Tileagă, « The construction of ethnic minority identity: A discursive psychological approach to ethnic self-definition in action », Discourse & Society, Vol. 22, Issue 1, 2011, pp. 86-101.
[10] Picard, 2012, p. 330 in Paolo Maggiolini, op. cit., p. 18.
[11] John W. Burton, Conflict: Resolution and Provention, Macmillan, 1990, p. 37.
[12] Ryan D. King, « The Context of Minority Group Threat: Race, Institutions, and Complying with Hate Crime Law », Law & Society Review, Vol. 41, No. 1, March 2007, pp. 189-224.
[13] Ted Gurr, Why Men Rebel, Princeton, Princeton University Press, 1970, p. 24.
[14] John Nagle, « Does Having a Kin State Lessen the Likelihood of Minorities Engaging in Secessionist Mobilization? An Analysis of the Moderating Influence of Kin States », Nationalism and Ethnic Politics, Vol. 19, Issue 3, 2013, pp. 287-309.
[15] Abdul R. JanMohamed, « Humanism and Minority Literature: Toward a Definition of Counter-Hegemonic Discourse », Boundary 2, Vol. 12, No. 3 – Vol. 13, No. 1, On Humanism and the University I: The Discourse of Humanism, Spring-Autumn, 1984, pp. 281-299.
[16] Peter Wallensteen, Understanding Conflict Resolution, London, SAGE, 2019, p. 39.
[17] Cheryl L. Thompson, « Self-definition by opposition: A consequence of minority status », Psychoanalytic Psychology, Vol 12(4), 1995, pp. 533-545.
[18] Jordi Tejel Gorgas, « Les Kurdes de Syrie, de la “dissimulation” à la “visibilité” ? », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, No. 115-116, décembre 2006, mis en ligne le 09 février 2012, consulté le 03 octobre 2019. URL : http://journals.openedition.org/remmm/3022
[19] Mohja Kahf, « ‘One, one, one, the Syrian people are one’ », The Guardian, 28 mai 2011, consulté le 03 octobre 2019. URL : theguardian.com/commentisfree/2011/may/28/syrian-alawites-protests
[20] « Minorités dans la Région MENA », Rapport du Dialogue Workshop, EuroMesco / Arab Reform Initiative / IEMed, rapport No. 21, 2017, p. 3.
[21] Zoé Carle, « Les slogans de la révolution égyptienne, épure d’une épopée tue ? », Communications, 2016/2, No. 99, pp. 159-169.
[22] Amy Oakes, Diversionary War, Stanford University Press, 2012, 280 p.
[23] Jaroslav Tir et Michael Jasinski, « Domestic-Level Diversionary Theory of War: Targeting Ethnic Minorities », Journal of Conflict Resolution, Vol. 52, Issue 5, pp. 641-664.
[24] Kathleen Cunningham, Kristin M. Bakke et Lee J. M. Seymour, « A Plague of Initials: Fragmentation, Cohesion and Infighting in Civil Wars », Perspectives on Politics, Vol. 10, Issue 2, 2012, pp. 265-283.
[25] Joost Hiltermann, « Tackling the MENA Region’s Intersecting Conflicts », International Crisis Group, 13 février 2018, consulté le 03 octobre 2019. URL : crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/tackling-mena-regions-intersecting-conflicts
[26] Jacob Bercovitch et Richard D. W. Jackson, op. cit., p. 3.
[27] Ibid., p. 8.
[28] Andreas Wimmer, Lars-Erik Cederman et Bran Min, « Ethnic Politics and Armed Conflict: A Configurational Analysis of a New Global Data Set », American Sociological Review, Vol. 74, Issue 2, 2009, pp. 316-337.
[29] Laura Feliu & Rafael Grasa, « Armed Conflicts and Religious Factors: The Need for Synthesized Conceptual Frameworks and New Empirical Analyses – The Case of the MENA Region », Civil Wars, Vol. 15, Issue 4, 2013, pp. 431-453.
[30] Jonathan Fox, « Religious Armed Conflict and Discrimination in the Middle East and North Africa: An Introduction », Civil Wars, Vol. 15, Issue 4, 2013, pp. 407-410.
[31] Isak Svensson, Ending Holy Wars: Religion and Conflict Resolution in Civil Wars, University of Queensland Press, 2012, 232 p.
[32] R. Scott Appleby, The Ambivalence of the Sacred: Religion, Violence, and Reconciliation, Carnegie Commission on Preventing Deadly Conflict, Rowman & Littlefield Publishers, 1999, 444 p.
[33] Mirjam E. Sørli, Nils Petter Gleditsch and Håvard Strand, « Why Is There so Much Conflict in the Middle East? », The Journal of Conflict Resolution, Vol. 49, No. 1, Feb., 2005, pp. 141-165.
[34] Said Bennis, « Questionnements et perspectives de la gouvernance de la diversité culturelle au Maroc », in Salam Kawakibi, Politics of Recognition and Denial. Minorities in the MENA Region, op. cit., p. 69.
[35] Jacob Bercovitch et Richard D. W. Jackson, op. cit., p. 8.
[36] Friedman, R. et Davidson, M., « Managing Diversity and Second-Order Conflict », International Journal of Conflict Management, Vol. 12 No. 2, 2001, pp. 132-153.
[37] John Duckitt, « Prejudice and intergroup hostility », in D. O. Sears, L. Huddy et R. Jervis, Oxford handbook of political psychology, Oxford University Press, New York, 2003, pp. 559-600.
[38] Kathleen Cunningham, Inside the Politics of Self-Determination, Oxford University Press, 2014, 304 p.
[39] Peter Wallensteen, op. cit., p. 203 et 298.
[40] Oliver Ramsbotham, Hugh Miall et Tom Woodhouse, Contemporary Conflict Resolution, Polity Press, Malden, 2011, 480 p.
[41] Eileen Babbitt, Arvid Bell, Alain Lempereur, Brian Mandell et Dana Wolf, Negotiating Conflict in the Middle East and North Africa A System Analysis after the Arab Spring, the Iran Nuclear Deal, and the Rise of ISIS, The MENA Negotiation Report, Harvard Kennedy School Negotiation Project, 2017, 479 p.
[42] Amy S. Hubbard, « Understanding Majority and Minority Participation in Interracial and Interethnic Dialogue », in Mohammed Abu-Nimer, Reconciliation, Justice and Coexistence: Theory and Practice, Lexington Books, 2001, pp. 279-280.
[43] Paolo Maggiolini, op. cit., p.29.
[44] « Minorités dans la Région MENA », Rapport du Dialogue Workshop, EuroMesco / Arab Reform Initiative / IEMed, rapport No. 21, 2017, p. 5.
[45] James E. Rexford, « Conflict and Conflict Resolution: Theory and Practice and the Army in the 21st Century », School of Advanced Military Studies, United States Army Command and General Staff College, United States Army, 2007, 62 p.
[46] Mohammed Ayoob, « State Making, State Breaking and State Failure », in Chester A. Crocker, Fen Osler Hampson et Pamela Aall, Leashing the Dogs of War – Conflict Management in a Divided World, United States Institute of Peace Press, 2007, pp. 112-113.
[47] Georges Fahmi, « The Future of Syrian Christians after the Arab Spring », in Salam Kawakibi, Politics of Recognition and Denial. Minorities in the MENA Region, op. cit., p. 61.